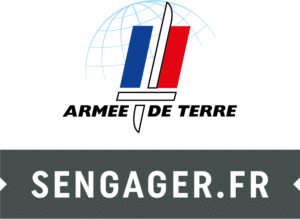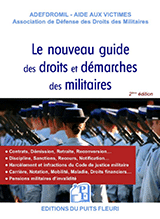FUSIONNER POLICE ET GENDARMERIE NATIONALES ?
Sur l’histoire d’un essai non transformé
Frédéric OCQUETEAU
À la faveur d’un nouveau code de déontologie pour la police et la gendarmerie promulgué en France par un décret du 4 décembre 2013 (Dupic, Debove, 2014 ; Debove, 2013), s’est posée à nouveaux frais la question de savoir dans quelles conditions, circonstances et pour quelles nécessités politiques et professionnelles ce corpus de droits et de devoirs policiers avait fait son apparition dans le Code dit de la Sécurité Intérieure (Mbongo, Latour, 2012). Et plus généralement pour les sciences sociales – bien plus encore que pour la doctrine juridique pour qui on n’aurait affaire qu’à une science des devoirs professionnels (Beigner, 2003) -, la question était posée de savoir comment ce code pouvait réinterroger l’histoire mouvementée d’une institution régalienne censée respecter les libertés fondamentales, bien que toujours ambivalente dans la transparence de son rapport au politique, à ses publics et aux normes de contrôle de son fonctionnement interne.
Précisons d’emblée ce que signifie en France la normativité de la déontologie dans les pratiques de police en suivant l’autorité d’un spécialiste pour qui la déontologie recouvre pratique et sanction, quand l’éthique est interrogation et la morale définition (Vigouroux, 2012, 10). Ni vraiment éthique ni vraiment morale, la déontologie propre aux métiers régaliens ne serait guère plus qu’une question fonctionnelle et professionnelle composée de normes incitatives ou coercitives (Moreau, 2004). Elles seraient enseignées et empiriquement mobilisées à partir de litiges susceptibles d’opposer des fonctionnaires de l’État à leurs tutelles et aux citoyens, litiges que les tribunaux judiciaires et administratifs auraient, en bout de course, pour vocation à réguler et à
pacifier.
Si derrière la jurisprudence pénale et disciplinaire se dégageant des contentieux pour fautes professionnelles, le sociologue des organisations et des métiers de la sécurité prétend interroger d’autres dimensions en les situant dans une démarche compréhensive plus large bien qu’en se tenant au plus près de l’institution elle-même (Gorgeon, 2008 ; Alain, 2011 ; Pécaud, 2011 ; Moreau de Bellaing, 2015 ; de Maillard et al., 2016 ; Mouhanna, 2011 ; 2013 ; 2017), ou en position d’extériorité critique, pour le compte d’ONG proches des citoyens victimes d’abus, de violences ou de discriminations défendant des libertés mises à mal par le maintien de l’ordre (en) public (Jobard, 2002 ; Goris et alii, 2010 ; Fassin, 2011 ; Jobard, de Maillard, 2015, 141-170 ; Lévy, 2016).
L’objectif de la présente étude restera assez différent de ces deux postures trop tranchées. Elle vise à mieux comprendre comment, dans le système d’action concret de la bureaucratie policière et gendarmique française d’aujourd’hui, les nouvelles normes de déontologie codifiées sont justifiées, transmises, comprises et assimilées, mobilisées ou rejetées comme autant de ressources symboliques et juridiques par différents acteurs en charge de les faire vivre tout en défendant leurs intérêts corporatistes ou professionnels bien compris.
L’étude s’attachera surtout à mettre à plat le contexte souterrain et public de l’apparition du nouveau code de déontologie de la police et de la gendarmerie en 2013, l’arrière-plan historique à la fois immobile et agité dans lequel interfèrent différents acteurs ayant un intérêt spécifique à s’emparer du thème de la « déontologie policière » au nom de l’intérêt général. On y rencontrera du personnel politique, des juges, des fonctionnaires de la hiérarchie et de l’exécution, des syndicalistes, des autorités indépendantes et, indirectement, différents publics labellisés comme usagers des
services de sécurité, victimes, auteurs, plaignants, contrôlés, interpellés, suspectés et mis en cause.
Le premier chapitre montre comment une politique de rationalisation systématique des coûts budgétaires dans le domaine de la sécurité a conduit à diminuer progressivement le nombre des fonctionnaires de la sécurité publique. Ce qui a produit deux résultats : un réagencement, au sein des deux forces, des architectures pyramidales internes traditionnelles ; et, quand la conjoncture environnementale a changé (à la faveur notamment d’une menace terroriste et d’une réaction politique en « état d’urgence » et d’exception), une réorientation revue à la hausse des effectifs
opérationnels de la police publique. Ce qui démontre que les « électrochocs » frappant les États-nation protecteurs de leurs populations peuvent conduire à des politiques
capables de s’imposer partiellement aux logiques économiques de la rationalisation des coûts.
Le deuxième chapitre montre, dans une temporalité différente, comment la réforme historique du rattachement de la Gendarmerie au ministère de l’Intérieur, voulue par le politique en 2009, a été largement facilitée par des réflexions et des dispositifs antérieurs constamment orientés vers une même pente : sauvegarder la logique du modèle dualiste institutionnalisé, tout en pensant les politiques de sécurité à l’aune d’une efficacité évaluée en commun de ce que produisent la force militaire et de la force civile en sécurité intérieure. Le rapprochement progressif des deux forces est en effet une vieille histoire d’avancées et de reculs successifs sur trente ans, dont sont retracées les étapes principales : elle fut avant tout logistique, opérationnelle, institutionnelle. La dimension qui a résisté le plus longtemps au rapprochement fut indéniablement identitaire, un abcès de fixation sur la démarcation du vécu professionnel au sein des deux métiers. La résistance obstinée de la gendarmerie explique les raisons pour lesquelles le spectre de sa « fusion » dans une police civile unique ne prendra pas racine en France avant longtemps.
Le troisième chapitre insiste néanmoins sur le progressif « alignement » de la Gendarmerie sur la police et de ses syndicats traditionnellement conçus comme cogestionnaires des carrières de leurs adhérents et des politiques de sécurité générale, dans le domaine « social ». Il revient sur les diagnostics des crises qui ont ébranlé la Gendarmerie au cours des trente dernières années et les raisons ayant favorisé l’innovation de l’ouverture du monde militaire à la reconnaissance d’associations de défense des intérêts des gendarmes par le biais d’instances élues.
Le quatrième chapitre vient en déduction des trois premiers. Il aborde les prodromes et les circonstances politiques plus circonstancielles ayant donné naissance à un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie en 2013, bâti sur les ruines de l’ancien code policier de 1986 et les différents textes de référence de la gendarmerie. Il analyse sur documents et auprès de témoins privilégiés le contexte politico-administratif de la promulgation du nouveau code et les différents positionnements d’acteurs-clés à son endroit. Il montre comment la promulgation fut
rapidement relayée par le souci d’en populariser pédagogiquement le contenu dans les écoles de formation de la police et de la gendarmerie.
Le cinquième chapitre se livre à une interprétation de la mise en œuvre normative du nouveau dispositif et de ses implications institutionnelles principalement dans leurs composantes disciplinaires. L’IGPN (et accessoirement la DGGN), sont interrogées comme instances les plus visibles de la discipline instituée par le nouveau code. Il analyse également l’enjeu de la traduction opératoire du nouveau dispositif de décentralisation de la déontologie de l’IGPN depuis sa réforme récente.
Le dernier chapitre interroge le rôle des différents médiateurs de la déontologie de la police (MIPN) et de la gendarmerie (médiateur militaire) agissant, à côté des instances disciplinaires, dans une optique de prévention des conflits afin de diminuer les tensions liées à la montée des contentieux du travail de l’ordre. Par contraste avec ces instances internes, est sondée la figure du Défenseur des Droits (DDD), autorité administrative indépendante constitutionnalisée que les citoyens peuvent saisir directement. L’autorité du DDD est auscultée dans ses rapports discrets avec l’IGPN et les tribunaux, et dans la symbolique de sa démarcation d’avec les corps d’inspection internes. Elle est toujours à la conquête de sa propre légitimité politique.
Ce rapport n’aspire qu’à être conçu comme la mise à plat historique et sociologique d’un dispositif appelé à s’ancrer dans les têtes et les pratiques, se traduisant progressivement dans les organisations de l’ordre public par de nouvelles normes procédurales autour du comportement des agents. Il ne propose pas d’enquête sur le ressenti des populations cibles quant à leur connaissances des dispositions de la déontologie (gardiens de la paix et gendarmes vs citoyens), car il est encore bien trop tôt pour ce faire (contra, Mouhanna, 2013 ; Roché et alii, 2015).
Plus modestement, il entend poser des jalons et des pistes de réflexions pour des recherches futures, en s’efforçant néanmoins d’apporter un surcroît de connaissances plus étayées sur deux plans : rassembler un maximum d’informations raisonnées auprès d’une littérature grise éparpillée (que les sociologues négligent bien souvent de calibrer et de travailler) ; les confronter autant que possible à des « témoins privilégiés », conçus autant comme d’indispensables pourvoyeurs d’informations factuelles, que des analystes autoréflexifs capables d’évaluer leurs propres expériences, investissements et engagements, sur un objet de débat démocratique aux multiples facettes, la « déontologie policière » (voir Annexe 2)