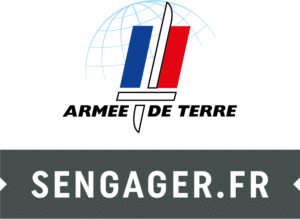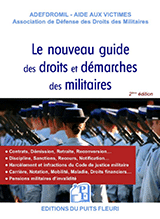Commission de la défense nationale et des forces armées
Présidence de Mme Patricia Adam, présidente
— Audition de M. Xavier Pasco, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, sur les évolutions du secteur spatial de défense
La séance est ouverte à neuf heures trente.
Mme la présidente Patricia Adam. Dans le cadre de notre série d’auditions sur le spatial et ses enjeux stratégiques, après avoir entendu le 17 mai le général Testé, du ministère de la Défense, nous sommes heureux d’accueillir en la personne de M. Pasco un chercheur spécialiste du secteur spatial de défense. En ce domaine, des décisions majeures ont déjà été prises dans l’actuelle loi de programmation militaire, et d’autres seront à prendre lors de la suivante. Les budgets sont significatifs. Il est donc important que les parlementaires intéressés puissent vous entendre et vous interroger sur ces questions.
Je souhaite également la bienvenue au colonel Nicolas, auditeur au Centre des hautes études militaires (CHEM) et à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), qui assistera à nos travaux, comme vient le faire chaque année un officier pendant une semaine.
M. Xavier Pasco, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Je suis très honoré et heureux de venir vous exposer ma vision de l’évolution des usages militaires de l’espace, indicateurs de référence des capacités de notre pays dans le domaine spatial en général.
On constate aujourd’hui une grande disparité des usages militaires de l’espace dans le monde et des moyens sur lesquels ils s’appuient. L’utilisation de l’espace a une histoire courte, assez récente – cinquante à soixante ans, ce qui est très peu au regard de l’histoire humaine –, mais sa dimension militaire a connu d’importantes évolutions au cours de cette période, par étapes.
Avec le recul, deux facteurs expliquent ces changements et cette disparité. D’abord, les besoins de défense, qui ont changé depuis la naissance de l’espace militaire dans les années cinquante. Ensuite, l’évolution technologique.
Je vais m’efforcer de vous retracer ces étapes telles que je les conçois, jusqu’aux emplois militaires actuels de l’espace, dont je vous donnerai un panorama.
J’ai parlé de disparité. Soyons clairs : il existe en fait aujourd’hui – certes un peu moins qu’hier – deux planètes dans l’espace militaire, qui sont les États-Unis et le reste du monde. Dans le domaine spatial en général, sur les quelque 1 300 satellites actifs en orbite, près de 600 sont américains et, sur 100 euros investis dans l’espace militaire au niveau mondial, 75 à 80 le sont aux États-Unis. L’effet cumulé de cet écart au fil des années aboutit à des univers, à des perceptions, à des doctrines d’emploi très différents. Le contraste s’est un peu atténué ; la France, notamment, fait bonne figure dans ce paysage. Mais l’ensemble international reste très contrasté, ce qui entraîne des conséquences militaires et diplomatiques, par exemple lorsqu’il s’agit de négocier des textes internationaux visant à réguler l’emploi du spatial – j’y reviendrai.
L’espace est né dans les années cinquante du fait nucléaire. Les technologies, l’activité et les programmes spatiaux sont d’abord liés à l’essor des technologies nucléaires. En effet, une situation unique s’est fait jour après la Deuxième Guerre mondiale, avec la rencontre des technologies balistiques et des technologies nucléaires. L’une des grandes craintes des deux superpuissances est alors de subir une attaque surprise dévastatrice, un nouveau Pearl Harbor qui serait cette fois fatal. Cela les conduit à réfléchir aux moyens de se surveiller mutuellement pour éviter cette attaque surprise, dont l’idée revient constamment dans les premiers temps du spatial militaire.
Aux États-Unis, on a compris dès les années cinquante, avant même la mise en orbite de Spoutnik en 1957, que le seul moyen d’avoir en permanence l’œil sur l’autre est de disposer de satellites d’observation. Le premier programme est lancé dès 1955. Aux États-Unis et en Union soviétique – deux pays qui vont constituer le club spatial pendant des années –, le développement massif des programmes de satellites est motivé par des considérations militaires et stratégiques.
Cette phase, que j’appelle l’espace stratégique, reste valide aujourd’hui encore. Car plutôt que d’une succession de périodes, il faudrait parler ici d’un empilement de couches, comme en géologie. L’espace stratégique constitue ainsi jusqu’à nos jours le socle de l’activité spatiale militaire. Il est lié à la nécessité de surveiller les arsenaux ou de connaître l’état des technologies liées aux armes de destruction massive. Cette préoccupation a influencé le développement des satellites d’observation – le fameux « satellite espion » –, mais aussi l’écoute ou les télécommunications, que l’on prépare de sorte qu’elles puissent fonctionner le cas échéant dans une « ambiance nucléaire ». Bref, elle a entraîné des évolutions très importantes à l’époque et qui le demeurent aujourd’hui.
L’espace stratégique est donc le socle historique de l’essor du spatial militaire et de sa continuité. Cela vaut des États-Unis, de l’Union soviétique puis de la Russie, mais aussi, d’une certaine manière, de la Chine d’aujourd’hui et de la France : les plans de ciblage et tout ce qui a trait à la gestion du fait nucléaire font de l’espace un outil important.
Il faut donc garder cet aspect à l’esprit, par-delà les évolutions ultérieures. Car ce cadre stratégique n’est pas abandonné, mais il n’est plus le seul socle de référence. C’est que, comme je l’ai dit, l’un des deux facteurs principaux des évolutions en la matière, à savoir les besoins de défense, a changé.
Le domaine spatial est toujours en prise directe sur le contexte géostratégique. Or, avec la fin de la guerre froide et la transformation des relations bipolaires du fait de la disparition de l’Union soviétique, ce contexte a évolué, ainsi que la manière dont les États-Unis conçoivent leur rôle militaire. Au tout début des années quatre-vingt-dix, l’idée est que le pays doit désormais pouvoir combattre simultanément sur deux fronts régionaux majeurs. Les États-Unis – qui, je le rappelle, jouent un rôle moteur en matière spatiale – procèdent alors à ce que l’on appelle une revue de fond en comble et s’aperçoivent que, pour livrer ces conflits, les moyens spatiaux développés pendant la guerre froide ne sont pas nécessairement adaptés. Car il s’agit essentiellement de moyens de renseignement, permettant par exemple de voir le plus précisément possible ce qui se trouve dans un silo à missile ou de comprendre les messages très codifiés envoyés par l’Union soviétique – à l’époque, il suffisait de tracer un chemin avec un bulldozer pour adresser un message politique. Mais lorsque l’on rapproche l’espace du champ de bataille, l’univers devient plus fluide, plus mouvant, ce qui appelle des moyens différents, plus flexibles, par exemple avec un champ plus large, permettant de voir d’autres choses.
Prenons l’exemple de l’alerte. L’alerte précoce est née en même temps que l’observation de la Terre. Elle avait pour but de détecter le tir des missiles intercontinentaux soviétiques – pour les Américains – ou américains – du côté soviétique. Il s’agissait de gros missiles, dotés d’une signature importante et durant longtemps. Sur un champ de bataille où les missiles sont de plus courte portée, et moins visibles car de signature et de durée plus faibles, il faut un instrument technique différent : les moyens développés pour repérer les missiles intercontinentaux peuvent ne rien laisser voir. Cette évolution vaut de tous les domaines : observation, télécommunications, écoute, etc.
Ainsi les États-Unis ont-ils pris conscience de la nécessité de développer de nouveaux moyens spatiaux militaires, outre ceux qu’ils ont conservés pour le renseignement. À cet égard, la première guerre du Golfe fut un test décisif, confirmant aux Américains que les moyens spatiaux dont ils disposaient n’étaient pas adaptés au nouveau contexte militaire et stratégique.
C’est ainsi que, dans les années quatre-vingt-dix, une deuxième « couche » se développe, que j’appellerai l’espace tactique – par une facilité de langage que les spécialistes militaires contesteraient sans doute –, ou l’espace au service du combattant. Chose tout à fait nouvelle, l’observation doit alors permettre de détecter et de suivre des objets mobiles, l’alerte de repérer des Scud et des missiles de 300 à 600 kilomètres de portée, et les télécommunications doivent être utilisables par les forces spéciales – ce qui implique des types de fréquences et de capacités différents. Une évolution analogue affecte tout le spectre des moyens.
Ces changements ont eu des conséquences très importantes, que l’on ne mesure qu’aujourd’hui puisque la durée du cycle de développement des moyens spatiaux est de dix ans, avant leur mise en utilisation pour plusieurs années. En d’autres termes, c’est aujourd’hui que nous voyons les Américains utiliser ce qu’ils ont imaginé développer dans les années quatre-vingt-dix – moyennant quelques améliorations sur lesquelles je reviendrai.
Le programme emblématique de l’espace tactique – du rapprochement de l’espace et du champ de bataille – est le GPS. Il servait alors à guider les munitions par satellite à des fins de précision. De la première guerre du Golfe aux conflits les plus récents, le recours aux munitions guidées par GPS n’a fait que croître. Abstraction faite de quelques variations selon le contexte géographique, les États-Unis n’emploient désormais quasiment plus que des armes guidées, dont la quasi-totalité l’est par GPS.
À l’époque, les États-Unis sont les seuls à développer cette vision, pour adapter leurs moyens à leurs besoins militaires, qu’ils ont eux-mêmes créés en construisant leur projet de politique de défense et internationale au tournant des années quatre-vingt-dix. Il n’en existe d’équivalent ni en Russie, ni en Chine, ni en Europe. La disparité entre les États-Unis et le reste du monde s’accentue à cette période. Les États-Unis parlent alors de l’espace comme d’un multiplicateur de force : dans les années quatre-vingt-dix prévaut l’idée que les systèmes d’armes américains bénéficieront d’une meilleure performance grâce au soutien des moyens spatiaux correspondants.
Il convient de noter que la France d’aujourd’hui a su, elle aussi, adapter ses moyens à ses opérations et qu’elle est l’un des seuls pays, compte tenu de ses ressources, à s’en être montré à ce point capable.
Dans la foulée de cet espace dit tactique ou au service du combattant, les États-Unis amplifient le mouvement et l’on voit apparaître, à la fin des années quatre-vingt-dix et au début des années deux mille, ce que j’appelle l’espace sécuritaire, désormais au service de la sécurité globale. En témoigne parfaitement la place centrale que prend le spatial dans la réflexion de défense et de sécurité aux États-Unis, en lien, naturellement, avec les attentats survenus au début des années deux mille. L’idée apparaît alors d’utiliser des moyens spatiaux devenus flexibles, mis au service des opérations, de la mobilité et permettant de voir des éléments peu codifiés, pour concourir à la sécurité dans son ensemble et au renseignement de sécurité.
Cette idée débouche sur l’émergence de doctrines assez claires et de programmes qui leur correspondent. Il s’agit de recourir de plus en plus à des moyens complémentaires aux moyens militaires, c’est-à-dire à des moyens civils et commerciaux. Pour y parvenir, on injecte alors de l’argent dans de nouvelles entreprises, de sorte qu’il existe aujourd’hui des satellites américains capables d’atteindre trente centimètres de résolution, d’une grande agilité, qui sont principalement destinés au Pentagone. On ne parle plus de multiplicateur de force mais de strategic enabler, c’est-à-dire de catalyseur stratégique – les Américains ont toujours eu l’art des formules. En d’autres termes, les moyens spatiaux ne sont plus censés améliorer les performances des systèmes d’armes : ce sont les systèmes d’armes qui doivent être construits autour des moyens spatiaux et des technologies de l’information qui les soutiennent. C’est cette vision qui sous-tend aujourd’hui les projets américains que j’observe.
Les moyens militaires, civils et commerciaux sont donc combinés afin de moissonner l’information – sachant que, ce qui compte, c’est le renseignement global et l’exploitation de cette information. Dans ce but, beaucoup d’argent public irrigue alors l’industrie et le secteur des nouvelles technologies de l’information, ce qui est censé les rendre d’autant plus compétitifs sur le marché commercial, selon un cercle vertueux. Cette évolution est liée au fait que la menace est perçue comme de plus en plus diffuse, les cibles et les ennemis comme moins codifiés qu’auparavant, de sorte que l’on sait de moins en moins ce que l’on veut regarder. Dès lors, on cherche à multiplier et à diversifier les capteurs, ainsi qu’à compenser le déficit d’information par de meilleures performances technologiques, notamment dans le domaine des technologies de l’information. Aux États-Unis, l’activité spatiale a été très fortement portée par ce credo.
On ne parle plus désormais de système, mais d’architecture, ou encore de système de systèmes. On veut faire collaborer les moyens spatiaux et les moyens non spatiaux. Bref, cette vision revêt une telle importance que, dès les années quatre-vingt-dix, on qualifie l’espace d’intérêt national vital.
En parallèle, d’autres pays que les États-Unis cherchent à se doter du même type d’outils, avec beaucoup de retard et bien moins de moyens. On le voit aujourd’hui en Russie, en Chine et d’une certaine manière en France, où l’on sait que les systèmes spatiaux sont d’autant plus efficaces qu’ils sont intégrés à des ensembles informationnels performants : ils collectent et disséminent une information qu’il faut ensuite traiter et exploiter, ces activités se répondant et exerçant l’une sur l’autre un effet d’entraînement. Ce lien entre l’espace et les technologies de l’information est en quelque sorte à la « couche » actuelle de l’espace sécuritaire ce que le lien entre l’espace et le nucléaire était à la « couche » de l’espace stratégique. Cette puissante connexion donne leur sens aux programmes spatiaux.
Dans l’état actuel de la réflexion, en particulier aux États-Unis, la place centrale accordée aux moyens spatiaux fait de ces derniers un talon d’Achille. Voilà pourquoi les États-Unis ont officiellement annoncé en 1999 que l’espace était devenu un intérêt national vital, ce qui signifie qu’ils peuvent légitimement, en tant qu’État souverain, le défendre par tous moyens.
À cet égard, le statut de l’espace a changé. Lorsqu’il était utilisé pour gérer la dissuasion et la relation bipolaire, l’intérêt mutuel des États-Unis et de l’Union soviétique était de le sanctuariser. L’espace crédibilisait la dissuasion ; il était une condition de l’observation, de la vérification, donc du fonctionnement de la dissuasion. Mis à part quelques épisodes de test, qui correspondaient à des tensions politiques, l’on n’a donc pas assisté au développement d’armes dans l’espace. En revanche, dès lors que l’espace devient un élément du dispositif de défense et du dispositif opérationnel sur le terrain, les stratèges militaires le considèrent comme une cible possible, au même titre que d’autres installations militaires : l’idée de sanctuarisation s’atténue.
Voilà pourquoi la notion de dissuasion spatiale se développe aux États-Unis – dont la puissance militaire dépend beaucoup plus du système spatial que celle des autres pays – et est discutée au niveau international, où l’on évoque beaucoup l’éventualité de codes de conduite afin d’assurer la sécurité collective dans l’espace. Certains pays, dont la Russie et la Chine, défendent quant à eux l’idée d’un nouveau traité interdisant les armes dans l’espace. Bref, la diplomatie s’est emparée de la question et les déclarations se font nombreuses.
On voit aujourd’hui apparaître une quatrième couche qui ne concerne pas seulement les États-Unis, mais aussi la Russie et la Chine, et à laquelle l’Europe devrait sans doute réfléchir : l’espace contrôlé. Il s’agit de développer des moyens permettant de protéger ses propres satellites de manière défensive, voire offensive. Cette vision tout à fait nouvelle contraste avec l’objectif de sanctuarisation inhérent au traité de l’espace de 1967. Sans parler d’une explosion des programmes d’armement dans l’espace, les budgets sont considérables – environ un milliard de dollars par an aux États-Unis. L’héritage de la guerre des étoiles perdure, les Américains n’ayant jamais cessé de travailler sur ces sujets : les armes à énergie cinétique, qui détruisent un satellite par collision ; les armes à énergie dirigée, qui peuvent utiliser des lasers ou d’autres types de particules. Les recherches dans ces domaines sont très nombreuses depuis les années quatre-vingt ; le secteur spatial a aujourd’hui tendance à les reprendre pour en tirer des programmes opérationnels.
C’est en tout cas ce que craignent certains pays, dont la Russie et la Chine, très volubiles sur le sujet, qui prônent un monde sans armes tout en continuant, comme les autres, de développer leurs propres moyens. Les Russes sont assez actifs ; ils se sont dotés de domaines d’excellence, notamment en ce qui concerne l’énergie dirigée, et de capacités assez importantes touchant les satellites manœuvrants. Quant aux Chinois, ils ont montré en 2007 qu’ils savaient détruire un satellite avec un missile au sol. Ce fut un traumatisme au sein de la communauté : pour la première fois depuis des lustres, un pays montrait sa capacité antisatellite – contre son propre satellite, certes. De nombreux débris en ont résulté, qui continuent de tourner aujourd’hui et mettent en difficulté la station spatiale internationale : le nombre de manœuvres nécessaires aux satellites comme à la station a considérablement augmenté.
Entre 2007 et 2009, il s’est passé plus de choses qu’au cours des trois décennies précédentes. Les Américains ont détruit l’un de leurs satellites, mais en orbite plus basse, officiellement parce qu’il risquait d’exploser et de répandre des produits nocifs, en réalité pour répondre aux Chinois. L’année suivante, un satellite américain et un vieux satellite soviétique sont entrés en collision, ce qui a produit encore plus de débris. Aujourd’hui, l’augmentation du nombre de débris inquiète.
En matière militaire, l’espace contrôlé se traduit par deux types d’investissements : dans la recherche portant sur les armes antisatellites ; dans la surveillance de l’espace et la connaissance de la situation spatiale. Ce dernier aspect est aujourd’hui considéré comme d’une grande importance stratégique. La population orbitale augmentant et la compétition orbitale s’intensifiant, plusieurs pays choisissent d’augmenter leur capacité dans ce domaine. On ne peut être un acteur de ce qui apparaît désormais comme un véritable milieu si on ne le connaît pas. Cette connaissance nécessite des radars, des moyens optiques au sol, des moyens radars au sol, éventuellement certains programmes de satellites qui permettent de cartographier depuis l’orbite, en orbite basse ou géostationnaire. Il existe aujourd’hui des satellites de plus en plus petits, offrant un éventail croissant de possibilités ; pour les voir, il faut évidemment davantage de moyens.
Tout cela crée un effet d’entraînement. De ce fait, même si je n’irai pas jusqu’à dire que nous sommes entrés de plain-pied dans la phase d’espace contrôlé, celle-ci prend de plus en plus de substance.
Au total, le premier rang reste occupé par les États-Unis, qui disposent de toute la gamme existante des moyens, du renseignement aux moyens utilisables dans les opérations et par le combattant, ainsi que du meilleur réseau de connaissance de l’environnement spatial. Le pays a des capacités dans tous les domaines. Sur 560 satellites américains en orbite, 150 environ sont militaires. À titre de comparaison, sur 130 satellites en orbite en Russie, les satellites militaires sont une quarantaine. Le rapport est comparable s’agissant de la Chine, qui a 177 satellites en orbite, dont un peu plus de quarante doivent donc être militaires. Viennent ensuite les autres pays. La France est relativement bien placée ; c’est plutôt aux pays équivalents en Europe qu’elle peut se comparer ; elle occupe parmi eux le premier rang.
Au cours des opérations récentes, l’activité spatiale a montré son efficacité. Le général Testé a dû vous le dire. Je pense pouvoir dire que l’espace est aujourd’hui considéré comme une capacité opérationnelle qui permet une utilisation des moyens militaires plus efficace et mieux contrôlée. Je veux parler d’une observation de la Terre agile, flexible, avec un rafraîchissement de l’information de plus en plus performant et des capacités de communications qui passent notamment par le recours aux drones – l’une des principales raisons du développement des satellites américains de télécommunications. Les Américains ont un tel besoin de bande passante, c’est-à-dire de volume de transmission, qu’ils vont le louer à des opérateurs commerciaux comme Intelsat. Les dizaines de drones américains en vol permanent nécessitent, en raison de tous les capteurs qu’ils mettent en œuvre, un débit et un volume de transmissions considérables qui ne peuvent pas être acquis uniquement par des moyens militaires propriétaires, d’où le recours à la location voire à l’achat de capacités.
Tous ces phénomènes connaissent une véritable explosion qui atteste du lien entre espace et technologies de l’information. L’espace s’intègre désormais à des réseaux : il fait partie d’un ensemble d’architectures liées à ces technologies qui est en constant développement et en constante évolution.
M. Jean-Jacques Candelier. Voici quinze ans que la réalisation du programme Galileo a été confiée aux industriels. Nous sommes en 2016 ; toujours rien à l’horizon. Il est prévu que le système soit opérationnel en 2020, mais il y a des retards. N’est-il pas dangereux que nous dépendions à ce point des États-Unis et de leur système GPS ?
Galileo fait-il l’unanimité parmi nos partenaires européens ?
La France peut-elle revendiquer le leadership européen en matière d’industrie spatiale, étant donné sa place dans le monde ?
M. Damien Meslot. Avons-nous suffisamment de moyens pour ne pas dépendre de la puissance américaine ? En prenant nos informations auprès d’une puissance certes alliée, mais dont les intérêts ne sont pas toujours identiques aux nôtres, ne nous exposons-nous pas au risque d’être manipulés ?
M. Xavier Pasco. Notre dépendance vis-à-vis du GPS est indéniable. Or ce système est contrôlé non seulement par les États-Unis, mais par leur ministère de la Défense, alors que Galileo est un système européen civil dont les emplois peuvent être gouvernementaux.
Galileo a eu une histoire difficile et pleine d’aléas, mais il me semble que la situation est désormais sous contrôle. A priori, en 2020, la constellation devrait être entièrement opérationnelle.
Tous les pays européens partagent-ils l’intérêt de la France pour ce programme ? Le signal sécurisé gouvernemental a posé des problèmes et reste un sujet sensible. Certains de nos partenaires, notamment le Royaume-Uni, n’ont eu de cesse il y a quelques années de contester les usages militaires de Galileo que pourrait permettre le recours à ce volet gouvernemental. Selon eux, Galileo étant un programme communautaire, qui dépend de la Commission européenne, et non un élément du « deuxième pilier » qui relève du Conseil de l’Union, il ne saurait avoir aucune dimension militaire. Ce problème, qui a vraiment fait débat, a été résolu par la Commission elle-même, qui a considéré que les usages nationaux de Galileo restaient entièrement du ressort de la souveraineté de chaque pays. De ce point de vue, Galileo demeure par essence un programme civil, avec des fonctions gouvernementales – le Public Regulated Service (PRS) dont je viens de parler – dont les gouvernements peuvent faire l’usage qu’ils souhaitent.
À cet égard, les Américains ont compris plus vite que les Britanniques l’intérêt que présentait pour eux le développement de Galileo, une fois la démarche bien engagée du côté européen : ils envisagent d’utiliser dans le domaine militaire les deux constellations GPS et Galileo, afin d’améliorer la performance globale du système. Quand on sait que l’on va devoir se battre dans des environnements urbains, que l’on aura besoin de précision, de permanence, il est plus intéressant de disposer de quarante-huit satellites que de vingt-quatre.
Tout n’est pas réglé s’agissant de Galileo, mais les gros problèmes sont derrière nous. Les éléments constitutifs de la constellation sont assez régulièrement mis en orbite.
La France peut-elle conserver son leadership, compte tenu de ses objectifs politiques et de sa position prééminente en matière de défense en Europe ? Il me semble que c’est déjà chose faite. Sur 30 000 personnes employées dans le secteur spatial, 12 000 à 13 000 le sont en France ; notre pays maîtrise l’ensemble des technologies stratégiques liées au spatial, qu’il s’agisse de l’accès à l’espace ou de l’observation de la Terre. Quant à Galileo, la France occupe une place de choix dans la conception même du programme, aux niveaux les plus complexes. Certes, le programme étant européen, plusieurs installations clés ne sont pas situées sur le territoire français. Reste que, dans ces domaines, la France a su préserver l’essentiel.
Cela ne signifie pas que personne ne conteste le leadership français. Sans aller jusque-là, l’Allemagne considère que sa place dans le secteur spatial en Europe n’est pas à la mesure de son rôle dans le concert politique européen. Elle s’intéresse de plus en plus au spatial, elle stimule son industrie pour créer des champions nationaux – on peut citer l’exemple de l’entreprise OHB ou de branches très actives d’Airbus Allemagne –, sans aller jusqu’à entrer en concurrence avec nous, sinon peut-être de manière mesurée, sur tel ou tel appel d’offres. Le paysage change un peu, mais la France conserve pour l’instant sa place. Il est bon de garder à l’esprit que celle-ci n’est jamais entièrement acquise.
Chose tout à fait nouvelle, le Royaume-Uni s’intéresse à son tour à l’espace, en particulier à la mise en forme des informations spatiales, à l’intelligence en matière de données spatiales. Cet intérêt s’est manifesté par la création d’incubateurs et de campus avec l’aide de l’agence spatiale européenne, ainsi que par la production de plusieurs rapports au cours des dernières années. Mais il n’existe pas au Royaume-Uni une industrie spatiale dont la taille soit comparable à celle de la nôtre. Les volumes financiers en jeu sont moindres.
Ce goût nouveau, de la part d’un pays qui a toujours été très sceptique vis-à-vis des dépenses spatiales, confirme en tout cas le lien entre l’espace et les technologies de l’information : c’est parce que celles-ci intéressent les Anglais qu’ils accordent à l’espace une considération inédite.
Avons-nous les moyens de ne pas dépendre d’une seule source d’information, fût-elle alliée ? Je pense que oui. Je me ferai ici l’écho de ce que dit à juste titre le ministère de la Défense. Depuis les débuts du programme spatial militaire national, nous consacrons tous nos efforts à notre autonomie en matière d’information, de décision et d’action. Les premiers programmes militaires français sont des programmes d’observation par satellites autonomes qui restent aujourd’hui une priorité – et le demeureront, puisque la composante spatiale optique (CSO) succédera à Hélios. Nous en mesurons chaque jour la valeur. Les Américains le savent très bien et la France leur apparaît comme un de leurs rares véritables partenaires en ce domaine.
C’est autour de l’autonomie d’information et de la souveraineté de la décision politique que s’est construit l’espace militaire français. Aujourd’hui, non seulement cet aspect est préservé, mais l’on est passé à la vitesse supérieure : on l’a vu récemment, nous sommes désormais capables d’améliorer par nous-mêmes la qualité de nos opérations militaires à partir des moyens spatiaux. Ainsi, les deux satellites très agiles, capables de fournir beaucoup d’images par jour, qui composent Pléiades – outil dual dont certaines capacités sont réservées au Gouvernement et au ministère de la Défense tandis que d’autres sont commercialisées – sont devenus essentiels aux opérations militaires, dans lesquelles leur utilisation est très bien maîtrisée.
L’écoute, qui faisait défaut, est maintenant prévue pour 2020 dans le cadre du programme CERES (capacité de renseignement électromagnétique spatiale). Elle contribue elle aussi à la préservation de notre souveraineté.
De toute façon, on ne peut coopérer avec les États-Unis que si l’on dispose de moyens autonomes ; dans le cas contraire, on ne les intéresse pas. En matière de surveillance de l’espace, par exemple, des accords récemment signés permettent à la France et aux États-Unis d’échanger des informations jusqu’alors protégées. C’est que nous avons depuis quelques années nos propres moyens d’information, certes bien moins considérables que le réseau mondial américain, mais suffisamment efficaces pour nous apporter des éléments que les États-Unis ne nous fournissaient pas auparavant. Le fait que nous nous soyons montrés capables de les obtenir seuls a ouvert la voie à la discussion et à la coopération. Sans vouloir parler à la place du commandant du commandement interarmées de l’espace, je pense pouvoir dire que de très bonnes relations se sont ainsi construites.
Mme Geneviève Gosselin-Fleury. J’aimerais vous poser une question sur la Russie. Vladimir Poutine avait fait de la renaissance du spatial une priorité nationale, prévoyant notamment de créer un nouveau site pour remplacer Baïkonour. Il semble que la crise économique ait contraint la Russie à réduire fortement – de 30 % – ses budgets dans ce secteur. Plusieurs grands programmes ont été sévèrement revus à la baisse. Le pays pourrait-il perdre son rang de puissance spatiale ? Quelles pourraient en être les conséquences sur l’équilibre géopolitique ?
M. Jean-François Lamour. Vous avez beaucoup insisté sur le passage de la production des satellites à des fins purement militaires à leur utilisation duale, mais vous n’avez absolument pas évoqué l’industrialisation de la production, en particulier dans le cadre du projet OneWeb. Comment concevez-vous l’utilisation de ce dispositif très novateur, qui bénéficie d’un coût très faible des satellites ?
Vous n’avez pas beaucoup parlé non plus de la maîtrise du lancement des satellites. Nous sommes confrontés dans ce secteur à la concurrence des États-Unis, qui se montrent très novateurs avec SpaceX et l’idée d’un lanceur réutilisable. Bien sûr, nous avons Ariane 6, qui commence à prendre son envol, si j’ose dire, mais avec un peu de retard, semble-t-il. Que pensez-vous de cette capacité américaine ? Est-il indispensable que nous accélérions le rythme de nos recherches afin de préserver l’indépendance sinon française, du moins européenne ?
Enfin, vous avez beaucoup insisté sur la capacité à détecter les satellites, voire les débris. Est-ce à dire que le radar GRAVES (Grand réseau adapté à la veille spatiale) ne suffit plus et qu’il faudrait hâter son renouvellement, ou faire en sorte de disposer d’un GRAVES nouvelle génération dans les toutes prochaines années ?
M. Alain Moyne-Bressand. Les conflits militaires ont évolué : en Afghanistan, en Irak, en Syrie ou en Centrafrique, on a besoin du satellite et du drone. Les Américains viennent d’ailleurs d’éliminer par ce dernier moyen un responsable afghan. Quels sont les liens entre satellite et drone – fruit d’une évolution technologique récente – s’agissant de conflits terrestres qui s’apparentent à des guérillas ?
Par ailleurs, existe-t-il un projet de dépollution de l’espace ?
M. Xavier Pasco. En ce qui concerne la Russie, vous avez raison, Madame : ces dernières années, et très récemment encore, les Russes ont annoncé une révision à la baisse de leur budget spatial fédéral. Mais l’on constate dans le domaine militaire un maintien, voire, dans certains secteurs, un accroissement des capacités. Je l’ai dit, la Russie possède une quarantaine de satellites militaires, et il n’est pas prévu que cette quantité diminue.
Pendant quelques mois, à compter de 2014, les Russes ont eu du mal à maintenir leur système satellitaire d’alerte avancée. Mais ils viennent de lancer coup sur coup deux satellites très modernisés qui revitalisent ce système et ils prévoient une constellation de dix autres d’ici à 2020. De même, après de basses eaux, GLONASS a connu une remise à niveau – par-delà les petits problèmes conjoncturels qu’il connaît en ce moment.
Au total, on sent que les Russes veulent maintenir un système considéré comme faisant partie des moyens modernes de la puissance militaire, et, partant, de la puissance politique.
En parallèle, l’industrie est en train de se réorganiser. C’est un peu un serpent de mer : on y pense régulièrement, mais les liens entre l’agence spatiale russe, le pouvoir et l’industrie continuent de poser problème ; on passe d’une réforme à l’autre, etc. Des concentrations industrielles se sont néanmoins opérées ; Roscosmos, qui est une corporation d’État, est en train d’organiser ce processus autour d’une dizaine de holdings. On s’aperçoit à cette occasion que l’industrie possède des moyens industriels considérables et de puissants effectifs. Les difficultés peuvent venir d’un problème de génération technologique, notamment dans le domaine informatique et électronique.
Quoi qu’il en soit, s’agissant de l’espace de défense, on ne peut pas dire que la puissance russe soit en déclin, loin s’en faut. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problèmes ; simplement, le secteur spatial russe est toujours en train de résoudre des problèmes : c’est en quelque sorte son moteur.
J’en viens à OneWeb – que je n’ai pas évoqué car j’avais centré mon propos sur l’espace militaire –, et plus généralement au new space, pour reprendre une formule à la mode aux États-Unis. Dans le domaine des télécommunications comme de l’observation de la Terre, de nouveaux acteurs apparaissent qui ne viennent pas du secteur spatial et qui imaginent pouvoir construire des constellations de centaines de satellites qu’ils mettraient au service du monde de l’information, notamment de l’internet. Or qui peut le plus peut le moins : ce que l’on peut distribuer sur l’ensemble du globe, on peut le fournir à divers utilisateurs, y compris gouvernementaux, y compris militaires.
Le gouvernement américain est en train de prendre la mesure de ces évolutions – qu’il suscite, d’une certaine manière. La National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) vient d’ailleurs d’ouvrir un avant-poste dans la Silicon Valley, au plus près des startups qui y fleurissent et qui renouvellent l’activité spatiale. De nombreuses interrogations demeurent quant au modèle d’affaires de ces sociétés, car l’espace est un secteur très particulier qui nécessite d’investir beaucoup d’argent au départ, en pariant sur un fort retour commercial.
Quoi qu’il en soit, il est en train de se passer quelque chose concernant l’espace qui aura des conséquences sur nous.
S’agissant du rythme de production des satellites, 14 satellites par semaine sont prévus dans le cadre de OneWeb ; la constellation sera de 700 satellites et c’est Arianespace qui doit les lancer, par lots de plusieurs dizaines. Tout cela est très nouveau pour tout le monde, notamment dans l’industrie spatiale. Airbus a embrayé et va concevoir ces satellites de sorte qu’ils puissent être produits en masse, en l’occurrence aux États-Unis.
Du point de vue militaire, la question se pose de savoir si tous ces moyens vont pouvoir exister. Deux domaines concernés sont au cœur de l’action militaire : les télécommunications et l’observation de la Terre. Certaines sociétés de la Silicon Valley font le pari qu’avec la miniaturisation des satellites – on fabrique aujourd’hui des satellites de 100 kilogrammes nettement plus performants que Spot, développé dans les années quatre-vingt et qui pesait plusieurs tonnes, et nettement moins chers – on pourra créer des constellations qui en compteront des dizaines. L’une de ces entreprises a même lancé plus d’une centaine de petits satellites. Naturellement, ces derniers n’envoient pas une image aussi précise que les gros satellites militaires, mais ils rendent l’espace plus utilisable : l’information est rafraîchie en permanence, et il y a toujours un satellite qui permet d’observer le point que l’on veut voir.
Cette quête de flexibilité, peut-être au détriment de la qualité, doit permettre de créer de l’information qui, mêlée à d’autres données, produira une connaissance utile et intelligente. C’est un pari, dont on commence à prendre conscience en Europe, notamment en France où plusieurs projets pourraient aller dans le même sens. À nouveau, les États-Unis se sont engagés les premiers sur cette voie. Beaucoup d’entreprises vont sans doute y perdre la vie – c’est le principe des startups –, mais pas toutes.
On a connu des projets massifs de ce type dans les années quatre-vingt-dix ; Bill Gates, par exemple, avait imaginé une constellation de 640 satellites de communication. Ces projets ont pris fin lorsque la bulle internet a éclaté. Même si ce risque existe encore, la situation a changé sur deux points. D’abord, la technologie a singulièrement progressé : on sait maintenant faire sur orbite basse des choses dont on était incapable auparavant, notamment dans le domaine des télécommunications, grâce à des antennes mobiles par exemple. Ensuite, et surtout, il existe aujourd’hui un écosystème qui est intéressé dans l’affaire : le web et ses acteurs ne sont plus ce qu’ils étaient il y a vingt ans, non plus que les sommes en jeu. Un élément comme la rapidité et le temps de latence des télécommunications est devenu financièrement quantifiables.
Un autre aspect qui ne doit pas être sous-estimé est l’intérêt de ces projets, notamment de leur usage militaire, pour les gouvernements. Ce sera un élément décisif de leur viabilité, qu’il s’agisse de OneWeb ou des grandes constellations de télécommunications. Google a donné un milliard de dollars à SpaceX pour imaginer une constellation de 4 000 satellites ; Samsung s’intéresse à une constellation de taille comparable. On ne sait pas encore où tout cela va nous mener ; toujours est-il que l’Union internationale des télécommunications (UIT), basée à Genève, enregistre beaucoup de réservations de fréquences. Chacune ne correspond pas nécessairement à un projet, mais cela montre qu’il se passe quelque chose.
Ces éléments sont également liés à l’évolution du monde de l’information. Dans cette affaire, il ne faut pas opposer le privé au public ; les acteurs gouvernementaux conservent un rôle décisif.
La maîtrise du lancement des satellites a toujours été, avec l’observation de la Terre, un sujet de préoccupation central pour notre pays et pour l’Europe. Le problème est que l’Europe a fondé son autonomie d’accès à l’espace sur la performance commerciale de son lanceur, alors que, dans le reste du monde, les satellites gouvernementaux sont tirés sur les lanceurs nationaux. Les États-Unis, en particulier, ne dépendent pas des entreprises qui construisent les lanceurs ; en revanche, ils leur passent des commandes. Il y a aujourd’hui environ 80 tirs par an dans le monde, parmi lesquels une trentaine de tirs commerciaux dont Arianespace représente un peu plus de la moitié, soit 11 à 15 tirs. Les autres tirs sont gouvernementaux, civils ou non commerciaux. C’est un aspect que nous avons toujours eu du mal à négocier en Europe, même si nous soutenons la filière Ariane.
Avec SpaceX, un nouvel acteur apparaît, qui promet de réduire drastiquement les coûts. Aujourd’hui, un tir de Falcon 9 représente 60 millions de dollars ; ce montant, déjà très inférieur au coût de lancement d’une Ariane, d’une Delta ou d’une Atlas, et inférieur à celui des lanceurs russes, pourrait être divisé par deux, à condition de réussir à réutiliser les étages de lancement. Quelques exploits ont déjà été réalisés, la société étant parvenue à récupérer un étage, mais elle n’en est pas encore à le réutiliser. C’est un défi, car le moindre problème en cours de route deviendrait une catastrophe : l’explosion d’un étage réutilisé décrédibiliserait toute l’entreprise.
Celle-ci suscite beaucoup de scepticisme, mais aussi des évolutions. Ariane 6 est ainsi une manière de prendre acte de la nécessité de modifier le système de lanceurs. Toutefois, le projet reste trop incertain pour qu’Ariane soit en danger à court terme, même si nous devons nous en préoccuper. Ce sont ses concurrents nationaux que SpaceX cible principalement, pour les raisons que j’ai exposées. L’entreprise a passé les mois qui viennent de s’écouler en procès contre Boeing et Lockheed Martin – ils forment ensemble United Launch Alliance –, qui détiennent le monopole des tirs militaires. L’importance des volumes de lancement l’incite à rechercher des marchés dans ce secteur pour survivre. SpaceX a obtenu le droit de répondre aux appels d’offres du Pentagone, droit qui lui était contesté, et a remporté des marchés, dont, il y a quelques jours, un marché NRO – un marché renseignement –, ce qui a passablement surpris la communauté spatiale et aurait été inenvisageable quelques mois plus tôt. Cette évolution affecte donc surtout le marché intérieur américain, même si, par effet de rebond, elle aura des conséquences sur la concurrence d’Ariane.
Je l’ai dit, Ariane 6 est une forme de réponse européenne à cette évolution, même si elle arrive avec un certain décalage. Il sera difficile de soutenir la concurrence en termes de prix, mais le prix n’est qu’un élément ; la confiance en est un autre. De plus, les grands opérateurs préfèrent en général ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Cela dit, il faudra éviter une distorsion trop marquée ; de ce point de vue, l’évolution américaine est un bon aiguillon pour l’espace européen.
Quant au radar GRAVES, il existe de plus en plus de petits satellites qu’il a du mal à voir et, selon les spécialistes qui le maintiennent en opération, il faudrait améliorer nettement ses performances pour qu’il puisse continuer d’accomplir sa mission. Le problème se pose également du suivi des débris, pour lequel GRAVES n’a pas été conçu à l’origine, mais auquel il peut contribuer à notre autonomie de connaissance. Le risque qu’un satellite reçoive un débris est évalué sous forme de probabilité, après quoi on choisit de manœuvrer ou non. Une telle décision n’est jamais anodine, car elle conduit à modifier le plan de fonctionnement du satellite et à consommer du carburant, réduisant ainsi la durée de vie de l’engin. Or, sur ce sujet, les informations reçues de l’extérieur risquent d’être orientées. Dans ce contexte, la connaissance de la situation spatiale est déjà essentielle et le sera de plus en plus.
En ce qui concerne le rôle des satellites et des drones dans les nouveaux conflits militaires, on s’aperçoit aujourd’hui que ces deux moyens, que l’on avait tendance à opposer, sont en réalité complémentaires. D’abord parce que les drones projetés au loin sont relayés par des satellites, y compris commerciaux, ensuite parce que les domaines d’observation respectifs des drones et des satellites d’observation se complètent. Ainsi, dans des pays qui ont une grande profondeur stratégique – comme disent les militaires –, on peut difficilement s’informer en envoyant un drone, alors qu’un satellite permet de s’affranchir de la distance. C’est au fil des opérations que l’on saisit cette complémentarité. C’est donc, du moins je l’espère, une logique vertueuse qui est ici à l’œuvre, même si l’on peut être tenté de substituer un moyen à l’autre, surtout en situation de contrainte budgétaire.
S’agissant de la récupération des débris, des programmes d’active debris removal sont à l’étude. On sait que les débris s’autogénèrent du fait du syndrome de Kessler : en entrant en collision les uns avec les autres, ils produisent encore plus de petits débris. Or un débris d’un centimètre peut détruire un satellite. Pour remédier au problème des débris, on cherche d’une part à rendre moins polluante la procédure spatiale, d’autre part à limiter ce phénomène d’autogénération. L’un des moyens proposés par la NASA pour y parvenir, et dont l’efficacité reste à confirmer, consiste à retirer de l’espace cinq gros objets par an – typiquement, des satellites en panne sur des orbites très encombrées – et à les faire se consumer dans l’atmosphère. Cela suppose d’aller chercher le satellite et de le manœuvrer pour l’emmener. Or envisager cette éventualité, fût-ce pour la bonne cause, revient à évoquer un système antisatellite, qui pourrait être utilisé à d’autres fins que la dépollution. Certains s’en inquiètent, de sorte que le sujet est un peu sensible dans les discussions internationales.
Dans ce contexte, un besoin de transparence et de sécurité collective se fait sentir. Détruire un satellite adverse, c’est se tirer une balle dans le pied : en produisant ainsi des débris, on menace ses propres satellites. Tous les pays s’accordent donc sur le fait que la sécurité nationale dans l’espace passe par la sécurité collective. En revanche, ils divergent quant à la manière d’y parvenir : faut-il un traité, un code de conduite ? Comment partager les informations ? Doit-on partager celles qui sont sensibles ?
M. Philippe Meunier. Merci, Madame la présidente, d’avoir pris l’initiative d’organiser cette audition très intéressante.
Monsieur Pasco, vous avez parlé de la course à l’armement de l’espace, ou du moins dans l’espace, ainsi que du tir chinois et de ses conséquences. Dans le cas d’une réponse du faible au fort, combien faudrait-il de missiles pour saturer l’espace de débris ?
M. Nicolas Bays. Vous avez évoqué le lancement de constellations de milliers de satellites. Risque-t-on une saturation des orbites ? Dans l’affirmative, comment y réagir ?
Vous avez par ailleurs beaucoup parlé de satellites orientés vers la Terre ; existe-t-il encore des programmes spatiaux ambitieux d’exploitation de l’espace ?
M. Xavier Pasco. Soyons clairs : dans le cas du tir chinois, c’est un missile « sol-espace » qui est allé détruire par impact un satellite météo chinois. Pour disposer d’armes antisatellites opérationnelles, il faut utiliser un ensemble composé de plusieurs de ces missiles, qui visera plusieurs satellites ; cela nécessite une connaissance parfaite de l’environnement spatial, de l’orbitographie, etc. Mais tel n’était peut-être pas l’objet de votre question, Monsieur le député.
M. Philippe Meunier. Pour la formuler autrement, si on lance un missile dont la tête contient des munitions à fragmentation, on ne touche pas un satellite, mais on sature tout de même l’espace de débris.
M. Xavier Pasco. C’est une possibilité, qui n’est même pas réservée aux pays spatiaux : il suffit d’avoir un missile balistique que l’on tire à la hauteur voulue. Mais ce serait un acte de guerre. On touche ici aux limites d’une vision strictement militaire de la sécurité spatiale. Un pays qui ne disposerait pas de moyens spatiaux peut tout à fait procéder au lancement d’un satellite dans un cadre civil et ouvert ; imaginons qu’un accident survienne, que le troisième étage du lanceur explose dans une orbite très fréquentée et produise des millions de débris. Est-ce une attaque ou un accident ? Comment en juger ? Tous les pays qui ont développé des programmes de lanceurs ont eu des accidents de ce type. Pour les éviter, il faut recourir à des technologies particulières qui permettent de passiver les étages et ne sont pas à la portée du premier venu.
Mais vous avez raison, ce genre d’explosion sur une orbite à 800 kilomètres – l’orbite circulaire la plus stable – crée plus qu’une perturbation : elle nuit directement à des dizaines de satellites et produit des débris dont les plus petits ne sont pas visibles. Les meilleurs systèmes détectent les débris de dix centimètres ; or, pour quelques dizaines de milliers de débris de dix centimètres ou plus, il en existe des centaines de milliers qui mesurent un à dix centimètres. Ces derniers représentent un risque contre lequel il est impossible de se prémunir, car on ne peut pas blinder un satellite contre un débris d’un centimètre.
Il est de notre responsabilité collective de nous limiter en ce domaine. Un acte tel que celui que vous évoquez serait très problématique, mais il n’a pas besoin d’être ouvertement militaire : il peut être dissimulé sous l’apparence d’une explosion accidentelle. Cela confirme la nécessité d’une véritable transparence des activités spatiales et de leur contrôle – une tâche très difficile. L’espace pourrait tout à fait être le lieu d’une guerre asymétrique, sans qu’il faille pour cela tirer beaucoup de missiles.
M. Philippe Meunier. Combien ?
M. Xavier Pasco. Un missile qui explose en faisant des dizaines de milliers de débris crée déjà une perturbation ; a fortiori deux ou trois. C’est le nombre de débris qui compte, non le nombre de missiles. Un seul missile qui se fragmenterait considérablement ferait d’innombrables victimes en orbite basse, indistinctement militaires et civiles. On ne pourrait se protéger contre ces débris. Il faut réfléchir à cette vulnérabilité, qui n’est pas facile à gérer.
Quant au risque de saturation, il est souvent opposé aux entreprises qui veulent déployer de grosses constellations. L’une de leurs principales préoccupations est d’ailleurs de montrer aux régulateurs de l’espace qu’elles sont capables de contrôler ces constellations. Planet Labs, la petite société à laquelle j’ai précédemment fait allusion et qui a déjà lancé en orbite plus de 133 CubeSats – de tout petits satellites qui ne peuvent pas manœuvrer beaucoup –, y travaille sans cesse ; elle a même été signalée cette année aux États-Unis comme l’une des entreprises les plus éco-responsables dans l’espace. Cela suppose un ensemble de techniques de suivi permettant de savoir en permanence où sont les objets et de rester en lien avec le réseau de surveillance de l’espace, pour une gestion totalement transparente.
Aux États-Unis, on commence à entendre dire que le trafic spatial ne doit plus être géré par les militaires mais par la Federal Aviation Administration (FAA), l’autorité de régulation aérienne, et le transfert est en train de s’opérer. Cette évolution est emblématique de la manière dont les Américains conçoivent aujourd’hui l’espace : comme une sorte de commodité.
Le risque de saturation est à l’arrière-plan de ces changements dans la gestion de l’espace ; c’est effectivement un point critique. On ne sature pas une orbite avec des centaines de satellites, mais certaines orbites sont déjà beaucoup plus fréquentées que d’autres – ce n’est pas le cas de l’orbite concernée par OneWeb, qui se situe à 1 200 kilomètres environ. Quoi qu’il en soit, il va falloir appliquer des règles.
Quant à l’exploitation des ressources spatiales, elle fait l’objet de projets et une loi signée par le président Obama fin 2015 autorise des sociétés commerciales à se livrer à cette activité sur des corps célestes. Le problème est que cette loi n’est pas tout à fait conforme aux traités internationaux, notamment le traité de 1967 ainsi que le traité sur la Lune, qui régit les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes – mais que les Américains n’ont pas signé. L’appropriation que suppose cette exploitation des astéroïdes crée une difficulté. C’est aujourd’hui le principal sujet de réflexion des spécialistes du droit spatial, qui organisent conférence sur conférence à ce sujet. Deux sociétés sont en pointe dans ce secteur : Planetary Resources Incorporated et Deep Space Industries ; elles sont en train de construire des satellites destinés à cartographier les astéroïdes et identifier parmi eux les meilleurs candidats à une exploitation industrielle. Ce n’est pas pour demain, mais cette idée commence à occuper les esprits, et des textes propres aux États-Unis – dont l’effet sur les réglementations internationales reste à déterminer – prennent corps à Washington. Mais tout cela est encore très largement prospectif.
Mme la présidente Patricia Adam. Merci beaucoup pour cette audition passionnante.
La séance est levée à dix heures quarante-cinq.
*
* *
Membres présents ou excusés
Présents. – Mme Patricia Adam, M. Olivier Audibert Troin, M. Nicolas Bays, M. Daniel Boisserie, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Isabelle Bruneau, M. Jean-Jacques Candelier, Mme Fanélie Carrey-Conte, Mme Nathalie Chabanne, M. Guy Chambefort, M. Jean-David Ciot, M. David Comet, Mme Catherine Coutelle, M. Bernard Deflesselles, M. Nicolas Dhuicq, Mme Marianne Dubois, M. Claude de Ganay, M. Sauveur Gandolfi-Scheit, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Edith Gueugneau, M. Christophe Guilloteau, M. Francis Hillmeyer, M. Laurent Kalinowski, M. Jean-François Lamour, M. Charles de La Verpillière, Mme Lucette Lousteau, M. Jean-Pierre Maggi, M. Alain Marleix, M. Alain Marty, M. Damien Meslot, M. Philippe Meunier, M. Alain Moyne-Bressand, M. Philippe Nauche, Mme Marie Récalde, M. Alain Rousset, M. Stéphane Saint-André, M. Thierry Solère, M. Jean-Michel Villaumé, M. Philippe Vitel, M. Michel Voisin
Excusés. – Mme Danielle Auroi, M. Claude Bartolone, M. Philippe Briand, M. Laurent Cathala, M. Guy Delcourt, Mme Carole Delga, Mme Geneviève Fioraso, M. Philippe Folliot, M. Yves Foulon, M. Serge Grouard, M. Éric Jalton, M. François Lamy, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Frédéric Lefebvre, M. Bruno Le Roux, M. Maurice Leroy, M. Eduardo Rihan Cypel, M. Gwendal Rouillard
Source: Assemblée nationale