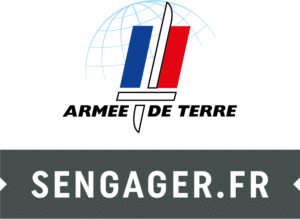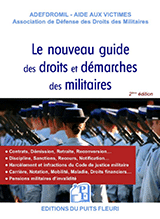L’armée de terre française, comme toutes les organisations militaires, est soumise à la double tension entre les ressources que la nation est prête à lui accorder et les besoins stratégiques de celle-ci, les arbitrages étant effectués par les institutions politico-militaires. Comme après les deux conflits mondiaux, la « paix de 1991 » a été l’occasion d’une transformation radicale de ces interactions avec à la fois une limitation immédiate des crédits alloués aux armées et le début d’une ère d’interventions au loin pour gérer les conséquences de cette nouvelle organisation du monde.
Pour les forces terrestres, l’adaptation du modèle de forces au nouveau contexte a surtout consisté à rendre projetable le corps de bataille issu de la Seconde Guerre mondiale par quelques innovations de structure mais surtout une transformation sociologique et culturelle avec la professionnalisation complète de la composante active et l’adoption des valeurs « nomades » des anciennes troupes d’intervention.
Pendant vingt ans, les forces françaises, et particulièrement les forces terrestres, ont ainsi soutenu une « guerre mondiale en miettes » faite de l’accumulation de multiples tours de quelques mois sur des théâtres d’opérations répartis sur l’ensemble du monde. Ce cycle semble désormais toucher à sa fin à la suite de nouvelles évolutions à la fois du contexte international, de la vision politique de l’emploi des forces et de la situation économique de la nation, imposant immanquablement une redéfinition du modèle.
La fin de la guerre mondiale en miettes ?
Avec la réduction de l’engagement dans les Balkans, en Afrique sub-saharienne, au Liban et surtout en Afghanistan, l’engagement extérieur va atteindre en 2013 son plus bas niveau historique avec une prévision de moins de 5 000 hommes engagés, laissant cette armée désormais « nomade » dans le trouble. Le rétrécissement attendu des conditions préalables à l’action, qu’elles soient diplomatiques (mandat du Conseil de sécurité des Nations-Unies) ou matérielles (aide américaine), ne laissent pas prévoir d’extension de l’engagement dans les années à venir, sauf surprise stratégique ou retour à l’action unilatérale.
Le bilan de l’efficacité des forces terrestres durant ce cycle pose également question. Le système centralisé de la Ve République offre l’avantage de permettre l’engagement rapide des forces mais il expose aussi directement le Président de la République aux résultats de l’action militaire. Il s’ensuit une tentation très forte de l’intrusion politique afin de réduire les risques politiques à court terme, souvent associés aux pertes humaines. Lorsque le chef des armées cède à cette tentation cela se traduit invariablement par des contraintes qui réduisent l’efficacité tactique et donc au bout du compte finissent par induire des pertes humaines qui elles-mêmes justifient une plus grande intrusion. Comme ces pertes sont presque entièrement le fait de l’engagement au sol, le point extrême de cette logique est son remplacement par des actions à distance et/ou indirectes dont l’armée de terre serait largement exclue. Cette logique est confortée par le contraste entre l’engagement en Afghanistan avec ses 710 soldats français tués ou blessés gravement et l’engagement en Libye réalisé sans perte, mais aussi par la tendance générale de nos alliés, américains en premier lieu.
La troisième contrainte est évidemment budgétaire. Après une professionnalisation qui a conduit, à masse salariale constante, à réduire les effectifs de l’armée de terre des deux tiers, la réforme en cours depuis 2008 a tenté de résoudre le problème de financement des programmes d’équipement. La solution choisie a été de réduire encore les effectifs, d’un sixième cette fois, en s’efforçant de ne pas affecter directement les unités de combat. Cette réforme n’est pas encore achevée qu’elle trouve déjà ses limites. Il reste encore plus de 5 000 postes à détruire sans que l’on sache désormais où les trouver hors des unités de combat. C’est dans cette situation de vulnérabilité que se profile un nouveau train de réformes.
Des capacités d’adaptation limitées
Pour faire face à cette crise, le processus d’innovation de l’armée de terre souffre de plusieurs freins. Les régiments sont incités à….
Lire la suite sur le site http://lavoiedelepee.blogspot.fr en cliquant [ICI]