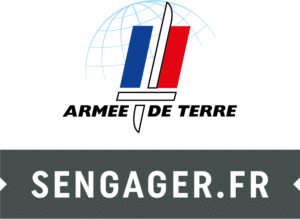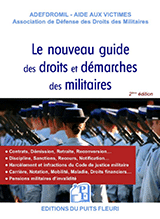Enfin, le dialogue social dans les armées fait l’objet d’une mission d’information parlementaire.
Messieurs MOURRUT et LE BRIS Députés conduisent cette mission en procédant à l’audition de tous les personnels susceptibles d’apporter un éclairage sur les mesures à prendre pour avancer sur ce sujet.
Ainsi l’ADEFDROMIL de Monsieur Bavoil représentée par Jacques Bessy s’est jointe à La Grogne pour se mettre à la disposition de cette mission.
Il n’est plus interdit de voir un jour une commission parlementaire destinée à regarder par le menu ce qui se passe lors des procédures disciplinaires militaires.
La Grogne qui n’a rien à vous cacher vous donne en communication le document qui a servi de base à son audition par cette mission parlementaire.
PREAMBULE
Avant toute chose, nous saluons l’initiative de cette mission d’information que nous considérons comme un véritable événement en soi.
Nous vous souhaitons, Messieurs, pleine réussite dans cette tâche que nous savons si difficile.
LE DIALOGUE SOCIAL DANS LES ARMEES :
Plus que jamais, les manifestations de policiers au pied d’un palais de justice nous rappellent combien il faut être prudent pour aborder un sujet où rapidement le trop sera l’ennemi du bien, où la démagogie ne peut tenir la moindre place.
L’équipe de La Grogne dans la Gendarmerie vous propose d’aborder le problème sur le schéma suivant :
– Une nécessité plus qu’un choix
– Un domaine strict
– Un temps défini
– Les écueils à éviter
– Les conditions d’une bonne réussite
– La situation actuelle dans la Gendarmerie en avance sur le reste de l’armée
– Les adaptations nécessaires
– Les associations – Les syndicats
– La Commission des recours militaires
I – UNE NÉCESSITÉ PLUS QU’UN CHOIX
Loin des comités de soldats des années 70, il convient d’adapter désormais le dialogue social dans les armées à sa réalité.
L’armée d’aujourd’hui est une armée de métier. Les soldats sont des professionnels et pour éviter les débordements que nous avons constatés tant chez le personnel sous-officier, qu’officier, il est nécessaire de créer des canaux légaux de dialogue et d’expression collective, à défaut de se voir imposer, dans l’avenir des structures qui pourraient être fatales à cette institution capitale pour la sauvegarde de notre nation.
Le soldat de métier doit prendre sa place dans la société et la chose militaire ne doit plus être la propriété de quelques spécialistes. L’armée doit se rapprocher de sa population. Elle a tout à y gagner, en terme de budget, certes, mais également en terme de recrutement.
Les abus constatés de certains chefs, dont l’ADEFDROMIL est le témoin quotidien, sont un autre élément qui rendent un progrès nécessaire dans les relations entre les hommes qui composent nos armées.
Enfin, aujourd’hui, la population n’est plus la même. Le soldat est instruit, il est ouvert au monde, ouvert aux conditions de vie de ses concitoyens et comprend mal d’être tenu dans un carcan qu’il pense inadapté. Il y voit de la défiance.
Il est nécessaire de lui démontrer la confiance que le pays a en chacun de ses soldats
II – UN DOMAINE STRICT
En raison de la particularité de la mission du soldat et des conséquences incalculables de l’ouverture irraisonnée du dialogue dans les armées, il convient d’en définir un cadre absolument strict.
Un ordre doit rester un ordre chez les militaires, que ce soit en opération, en entraînement, ou à la caserne.
Le dialogue social doit trouver sa place naturelle pour les évolutions des statuts et pour les propositions relatives à l’amélioration des conditions d’exercice du métier.
Les événements particuliers concernant le militaire dans sa vie de famille, dans le déroulement de sa carrière, mais aussi dans sa défense face à un problème disciplinaire sont également concernés.
L’expression raisonnée des militaires doit être élargie pour que la communauté nationale bénéficie d’analyses et de propositions concernant la chose militaire. Il n’y a là rien de nouveau puisque Charles De Gaulle alors Colonel s’exprimait librement. Il faut revenir sur la frilosité actuelle qui n’est qu’un signe de faiblesse de la doctrine.
III – UN TEMPS DÉFINI
Notre pays le sait, les temps changent rapidement. Nous ne sommes à l’abri d’aucun conflit dans un avenir proche ou lointain. La règle que nous cherchons à définir doit pouvoir être suspendue dans les périodes troubles et au cours d’opérations extérieures.
Il n’est pas question d’engager l’armée dans ce que nous avons vu de l’armée Hollandaise en Afghanistan.
La parole doit également être contrôlée dans les mêmes temps. Les Américains ont fait l’expérience en Irak d’une expression incontrôlée des soldats. Saurons-nous un jour le prix qu’ils ont payé, en vie humaine, des négligences électroniques de soldats inconséquents.
IV – LES ÉCUEILS À ÉVITER
Nous touchons là à la recherche du bon équilibre entre dialogue et discipline.
Le dialogue ne peut être une source de paralysie de l’action, un obstacle aux décisions nécessaires.
Le secret militaire ne doit pas s’en trouver altéré.
Il convient de protéger le chef militaire de dénonciations diffamatoires.
Mais, tout autant, il ne peut plus être envisagé un commandement qui n’a pas de compte à rendre.
Les organes de dialogue et d’expression ne sauraient être des lieux de division entre les différents corps de militaires.
V – LES CONDITIONS D’UNE BONNE RÉUSSITE
Pour réussir dans le projet de construire un dialogue fructueux au sein de l’armée, il est nécessaire dans un premier temps de convaincre les chefs militaires de l’intérêt qu’ils ont à faire vivre ce dialogue et de leur responsabilité dans la réussite de ce qui peut être un nouvel atout pour un commandement réussi.
Non des moindres, les Gendarmes nous le démontrent, il faut également convaincre les militaires du sérieux de l’entreprise et de la détermination du législateur à créer les conditions nécessaires à des échanges sereins et fructueux.
Les objectifs doivent être clairement exprimés, les cadres délimités et une mission devra s’assurer de la mise en place réelle des mesures décidées.
VI – SITUATION ACTUELLE DANS LA GENDARMERIE
Elément moteur en la matière, la gendarmerie a procédé à des innovations en 2010.
Sa direction s’est montrée soucieuse de créer une situation transitoire qui permet au chef de s’adapter au progrès inéluctable tout en protégeant une discipline qui reste extrêmement ferme.
Il semble que le personnel n’aborde pas avec suffisamment de recul la situation nouvelle et qu’il ne voit dans la prudence de sa direction que de la stagnation.
Pourtant:
Le personnel est représenté au niveau du Groupement, au niveau région et au niveau national. Certes il s’agit encore de personnel choisi, mais il l’est dans des collèges de personnels élus.
Il existe des assemblées au niveau départemental et au niveau régional.
Le CFMG reste l’instance nationale.
VII – LES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES
Au delà du mode de désignation des représentants qui pourrait rester tel qu’il est encore pour permettre une transition tranquille, ce sont bien les structures et leurs fonctions qu’il convient de faire bouger.
– Les assemblées doivent avoir un véritable « bureau » élu pour suivre les dossiers
– L’ordre du jour d’une assemblée de présidents des personnels doit être partagé entre la hiérarchie et le bureau de ces assemblées.
– La publication de leurs travaux doit être de la responsabilité du bureau, suivi ou non, mais séparément de l’avis du chef hiérarchique.
– La communication et les échanges entre les assemblées de niveaux différents doivent être organisés.
– Le CFMG ne peut être constitué que de personnels des différentes assemblées. Il doit maîtriser son ordre du jour. Il doit maîtriser sa communication.
La mauvaise répartition des postes d’élus est une chose qui revient souvent dans nos échanges avec le personnel. Les plus nombreux se sentent les moins représentés et la prime à la hiérarchie semble trop importante. Doit-on envisager une représentation des gendarmes (le grade) par des gendarmes et des gradés par des gradés ?
Le problème se posera tôt ou tard. Malgré les inconvénients évidents que cela représente, il sera nécessaire de se pencher sur cette évolution souhaitée.
VIII – LES ASSOCIATIONS – LES SYNDICATS
En France, le fait syndical a mauvaise réputation. C’est également vrai dans les armées et dans la Gendarmerie. Il n’a pas atteint encore la maturité souhaitable pour pouvoir être admis au cœur de nos troupes. Nous l’avons dit en introduction, l’exemple policier ne peut-être suivi, même si la puissance démontrée peut faire envie à quelques uns.
Par contre, le personnel en difficulté doit pouvoir trouver un appui sérieux, un recours possible et non se retrouver seul avec son problème.
Cet appui ne peut être qu’extérieur. Les associations de professionnels, ou en partie professionnelles sont toutes désignées pour jouer le rôle de régulateur auquel la commission des recours militaires a renoncé.
Il est nécessaire de les légaliser et de leur définir un champ d’action, de leur reconnaître leur caractère de représentation auprès des tribunaux.
IX – LA COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES
Une commission qui expédie les dossiers n’a pas sa place. Elle n’a aujourd’hui de fonction que de retarder l’action légale pour assurer l’exécution d’ordres mêmes abusifs.
Il convient, soit de la refondre complètement, soit de la dissoudre.
Elle doit admettre un dialogue contradictoire et les demandeurs doivent pouvoir faire intervenir leurs avocats.
Les auteurs d’abus doivent être reconnus responsables personnellement de leurs actes.
Source: lagrognegend