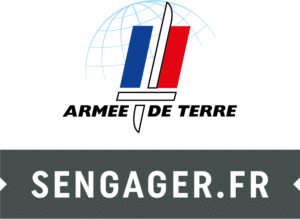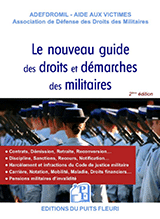L’expression individuelle et collective
L’expression, un droit et une liberté.
« Tout ce que demande un homme est de pouvoir s’exprimer, qu’on lui en laisse le loisir, et qu’on lui donne les moyens de le faire » (François Michelin).
La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun » (Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en date du 7 décembre 1976, affaire HANDSYDE c/Royaume-Uni). La liberté d’expression est reconnue et garantie par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et est considérée comme une liberté ayant valeur constitutionnelle par les juridictions françaises. Au terme de cet article 10 :
– « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. (.) ».
Le militaire est lié par une obligation de réserve, ni plus ni moins que tout agent public d’ailleurs, mais il n’en demeure pas moins un citoyen qui doit pouvoir légitimement s’exprimer librement sur ses conditions de travail, de service, de vie professionnelle, dès lors qu’il n’existe aucune exigence de secret. Certes, la Loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires édicte clairement que : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens » (art.6), mais pour « interdire l’exercice de certains d’entre eux » à la phrase immédiatement suivante. L’évolution naturelle de la société française, et aujourd’hui européenne, rend difficile d’admettre la notion de jouissance virtuelle d’une liberté fondamentale.
Nombreux sont ceux, y compris parmi les plus hautes autorités de l’Etat, qui reconnaissent publiquement que ce statut doit évoluer.
Disserter sur l’amélioration des moyens d’expression des militaires, c’est se hasarder à évoquer les circuits par lesquels le personnel « d’en bas » peut verbaliser ses aspirations, ses états d’âme, mais surtout ses doléances, à destination de ces dirigeants, jusqu’au sommet. C’est aussi, et parallèlement, apprécier les risques inhérents à l’absence ou à l’inefficacité de tels circuits.
L’association : un haut parleur pour exprimer le mal être.
S’il s’agissait de simples entreprises commerciales, le succès rencontré par l’association de défense des droits de militaires (adefdromil) et d’autres associations, suffirait à confirmer la pertinence de leur action, et à en garantir l’avenir. La récente démarche d’interdiction de la première, sous prétexte d’une intuition ministérielle tardive sur sa « nature syndicale », pourrait apparaître comme une reconnaissance supplémentaire d’efficacité gênante.
Il est toujours préférable, dans l’immédiat, de faire taire ceux qui soulèvent les problèmes que de chercher à les résoudre. C’est moins vrai sur le long terme.
Partant de l’idée simple que les militaires méconnaissent leurs droits et les moyens de les faire respecter, l’association étudie les dossiers de ses adhérents, et leur propose les solutions les plus adéquates. Du simple recours hiérarchique au référé administratif, voire à la plainte au pénal, dénouement ultime. Il est fort vraisemblable que la majorité des adhérents n’ont jamais ressenti, ni ne garderont, de vocation « syndicale » à l’issue de leur requête. La présence de militaires d’active et de réserve rassure les plaignants car leur contribution présente un caractère désintéressé, essentiellement basé sur des notions de camaraderie, d’entraide et de fraternité d’armes.
L’approche associative : une force de proposition basée sur l’observation et l’analyse.
Du traitement individuel de cas particuliers, à la proposition d’ébauche de solutions collectives, il n’y a qu’un pas que permet de franchir l’accumulation des dossiers traités. Cette base de données fait apparaître des récurrences dans les thèmes et des constances dans le mode de survenu des conflits.
La plupart des militaires qui poursuivent leur recours devant les instances contentieuses ont surtout l’impression de ne pas avoir été écoutés, que leurs états de service ont été méprisés, et que leur quête de justice a été éludée au profit de la vision hiérarchique ponctuelle des choses. La déception, toujours présente, est d’autant plus forte que l’investissement personnel était antérieurement plus profond. Le mutisme des autorités imprègne les victimes d’une défiance légitime qui ne cessera plus, mais s’amplifiera au fur et à mesure que ces mêmes autorités étayeront, a posteriori, leur décisions d’arguments parfois tirés du néant.
L’autre révélation tenace de l’analyse des cas réside dans un certain mépris des formes réglementaires dès qu’il s’agit de sanctionner. Les autorités n’ont bien souvent qu’une faible connaissance des obligations de motivation de leurs actes faisant grief, et des droits « de la défense ». Trop de procédures sont dévoyées de leur origine à seule fin de court-circuiter d’autres processus mal maîtrisés ou réputés plus complexes. Dans de nombreuses affaires, un psychiatre est mis à contribution pour « éliminer » un « indésirable », avec l’impression fréquente que la démarche répond au double intérêt du psychiatrisé et de l’institution. Mais en négligeant l’effet désastreux qu’aura, in fine, cette forfaiture sur le juge et sur l’opinion publique.
L’association : du rôle « médiatif » à la puissance médiatique.
Impression de toute puissance d’un coté et d’être broyé de l’autre, le « médiateur » réclamé par le rapport COVA-GRASSET aurait eu fort à faire. Cette solution qui fonctionne dans d’autres armées européennes, a été rejetée, privilégiant l’infaillibilité du chef, mais avec le risque d’un surcoût considérable, humain et financier. Il est aisé d’éclairer ce danger avec l’exemple récent de la gratuité des logements en Polynésie française. Ce principe d’équité entre l’habitât domanial et le logement baillé, avait été soulevé par un militaire locataire du second. Face à l’intransigeance des autorités militaires locales, le différent parvint devant les tribunaux. Une médiation « discrète » aurait sans doute fait économiser des millions de francs sur le budget de la défense, sommes considérables que les armées ont du rembourser à partir de 1999, avec quatre années d’arriérés, à la multitude d’anciens locataires concernés par le jugement favorable du tribunal administratif de PAPEETE. Dans un cas plus récent, mais toujours outre-mer, la prise en compte rapide d’une situation manifestement inique aurait évité la médiatisation de l’affaire, une enquête de commandement, le discrédit institutionnel, et sans doute, à terme, la condamnation pécuniaire des responsables.
De ces iniquités dont tous les médias sont avides, naissent des revirements jurisprudentiels contraignants, et parfois des associations dont l’activité ne cesse pas à l’extinction de l’injustice créée. C’est le cas en particulier de « PJPJ » (Police Judiciaire Pour la Justice), créée pour défendre les deux gendarmes maritimes de Toulon (affaire de la DCN), et à qui l’on doit un certain nombre de décisions de justice et d’autres actions encore pendantes.
Un avenir plus submersible que subversif.
Le pire reste à venir. De nouvelles lois, régissant les relations interhumaines dans l’entreprise, s’appliqueront sans exclusive à un monde militaire où ces relations sont restées engluées dans une soumission absolue, et d’un autre âge. De ces futurs conflits, il serait vain d’attendre autre chose qu’une multiplications des affaires, une submersion des services juridiques des armées, et une publicité contre productive en matière de recrutement. Il fallait, il faut, il faudra agir autrement, et si possible en se référant à ce qui fonctionne dans d’autres nations européennes. Citoyen avant d’être soldat, selon le beau mot de Bonaparte, le militaire issu de la nation apportera avec lui des sentiments d’où sont de plus en plus exclus la conscience des devoirs, et de plus en plus présente la perception des droits. C’est un fait de société incontournable. On pourra s’en offusquer et déclamer que tout se perd, prétendre qu’il existe encore des perles rares, dociles, si possible spécialisées et en quantité suffisante, mais le réalisme commande de faire avec l’existant. Le taux de candidature aux différents postes proposés devrait inciter à agir avant qu’il ne soit trop tard, et il serait ridicule de voir disparaître les hommes au moment même où se profile la perspective d’obtenir d’excellents matériels. La refondation passe par l’abandon d’un certain nombre d’interdits qui ne sont plus d’actualité au regard des aspirations de la jeunesse et des défis à relever en matière d’attractivité du métier des armes. Et ce d’autant plus que, « papy boom » aidant, toutes les administrations dont les métiers peuvent sembler équivalents, vont investir sous peu le même bassin de recrutement. Il faudra, sans doute, édulcorer autant que possible les aspects positifs, mais gommer pareillement les aspects rédhibitoires.
L’existant en matière d’expression et de représentation : des infrastructures « normatisées » faussement rassurantes.
Les Conseils de la Fonction Militaire, dont le Conseil Supérieur
(CSFM-CFM) occupent l’espace de la concertation « institutionnelle ». Ces instances aux membres tirés au sort, à l’exception notable des 6 retraités siégeant au CSFM, ne maîtrisent pas l’ordre du jour des deux uniques sessions annuelles (pour un seul thème). Elles sont assez méconnues des militaires comme l’indiquent les rares études objectives réalisées. A l’exception tout aussi notable de celui du CFM Marine, il est impossible de trouver les autres comptes-rendus sur le Net.
Certains états-majors ayant horreur des jeux de hasard, on a pu voir des incitations au volontariat, histoire de forcer un peu la main du destin. Les candidatures transitant par les secrétariats des CFM, il est impossible de savoir si elles résistent toutes à une présélection pour se retrouver dans l’urne. Une fois désignés, les titulaires n’ont pas l’obligation de siéger, et il n’est pas rare de voir des suppléants débarquer dans des débats commencés lors des sessions précédentes. Il arrive aussi qu’aucun des suppléants ne soit disponible et qu’un siège reste vide. On note parfois la présence incongrue d’autorités venues assister aux débats, comme ce sous-directeur des ressources humaines d’un grand service commun, ou cette responsable de la communication, venus assister « pour voir ». Avec un tel public, il est vraisemblable que les « débats » se font plus serein. Des conseillers ont parfois pu se voir reprocher, par leur chef de service, des attitudes dont ces autorités n’étaient pas supposées avoir connaissance. L’immunité « parlementaire » sensée protéger les membres et leur permettre l’exercice d’un « devoir d’expression » reste assez fragile, et l’ancien ministre de la défense avait demandé un relevé des infractions de cet ordre. Demande vraisemblablement restée sans suite.
Ainsi, et à titre d’exemple, certaines affectations outre-mer n’ont d’autre but que d’éloigner les turbulents. Depuis 1999, et pour les conseils qui ont retenu ce critère, une mutation en dehors du ressort géographique au titre duquel le conseiller a été tiré au sort, entraîne le départ de l’impétrant. Cela rend la gestion plus facile.
Enfin, les CFM restant dépendant des autorités, ils courent le risque d’être manipulés sur des objectifs assez éloignés de l’intérêt du plus grand nombre. Il y a quelques années, le CFM d’un service réclamât, tout à fait hors de propos, l’élévation de son président et directeur central au grade de général de corps d’armée. La session suivante, et avec une diligence surprenante, un décret était soumis à ce même CFM et entrait en vigueur dans l’année. Plus récemment, ce même CFM demandait et obtenait une prime conséquente essentiellement réservée aux officiers des grades de colonel et général. Deux exemples d’efficacité quand les choses en valent la peine.
Vers des révisions déchirantes mais revitalisantes.
L’état des lieux et la nécessité d’agir font l’objet d’un consensus total. La collectivité militaire ne peut se borner à n’étudier et ne retenir que les solutions proposées par des autorités dont l’intérêt à agir n’est pas évident, ou dont le temps de service restant apparaît compté. L’idée d’interdire ou de maîtriser l’expression « collective », semble essentiellement imputable au « conservatisme ». L’actualité et la préservation de l’avenir imposent de jouer le jeu de la négociation, de la médiation, de l’exercice le plus large possible des droits et libertés du citoyen, et enfin celui de l’équité.
La nécessité de restaurer la crédibilité des Conseils ira de paire avec celle, plus immédiate d’en légitimer et remotiver les titulaires, et le recentrage de leur activité sur les seuls thèmes de préoccupation du personnel. Il faudra donc finir par admettre l’élection « nationale » de représentants crédibles, d’active ou de réserve, proposés ou non par des associations dans lesquelles ils joueront ou non déjà un rôle en faveur des représentés, et auront pu, éventuellement démontrer des qualités de « négociateurs ». C’est à dire appliquer à l’ensemble des « représentants » ce qui se fait actuellement pour les seuls conseillers issus des associations d’anciens combattants.
Associations de militaires d’active et de réserve: un avenir serein
Qu’il s’agisse de se conformer aux évolutions psycho-sociales de la nation française, ou aux recommandations européennes en matière des droits et libertés reconnus aux militaires, ou simplement d’aplanir les différences persistantes entre les diverses armées européennes appelées à agir de concert, le « toilettage » du statut général des militaires apparaît inéluctable.
Offrir aux personnels des armées l’accès à l’ensemble des droits et des libertés reconnus aux citoyens participe à la fusion nécessaire entre la force armée et le pays, voire l’Europe. A titre subsidiaire, et s’il en partage la jouissance, cela permettra au militaire de mieux comprendre à quel point ces droits et libertés valent la peine d’être défendus.