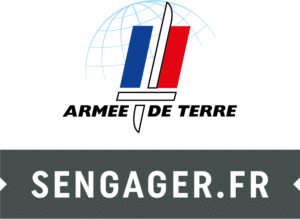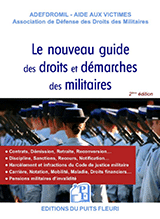Le document orginal peut être lu sur le site de Libération à la page http://www.liberation.fr/page.php?Article=223639
Des militaires défilant sur les Champs-Elysées, mais sous des bannières syndicales ? Pour l’instant, c’est catégoriquement exclu, même si dans les ports, les gendarmeries et les bases aériennes, la question d’une organisation professionnelle des militaires n’est plus totalement taboue. Seule l’armée de terre semble encore échapper à ce questionnement, alors qu’une réforme timide du statut des militaires devrait être présentée en Conseil des ministres durant l’été.
Pour la première fois, un dirigeant d’un grand syndicat, François Chérèque (CFDT), se prononce en faveur d’un syndicalisme militaire (lire ci-contre), comme il l’a fait, fin juin, devant un parterre d’officiers supérieurs de l’armée de l’air sans susciter de réprobation particulière. Si ce n’est celle du chef d’état-major, le général Richard Wolsztynski, bien obligé de rappeler ce que les militaires appellent en souriant «la ligne du parti» : «Pas besoin de syndicat chez nous !» Interrogée cette semaine par l’Express sur le droit des militaires à adhérer à un syndicat, la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, a été catégorique : c’est «non». A la Défense, comme dans les états-majors, on oppose «le devoir de neutralité et de disponibilité» pour refuser aux militaires professionnels français… ce que de nombreux pays européens leur accordent. En Allemagne, il existe l’équivalent d’un syndicat (lire ci-contre), alors qu’au Royaume-Uni, ils peuvent adhérer à un syndicat, avec toutefois de nombreuses restrictions.
Chance. Le statut des militaires, qui date de 1972, exclut catégoriquement l’existence de «groupements professionnels à caractère syndical», comme la possibilité d’adhérer à un parti. Une situation qui cantonne les militaires dans un statut de citoyens de seconde zone. Et qu’il n’est pas question de changer en profondeur, l’Elysée et les différents chefs d’état-major sont clairs sur ce point. Ce statut de 1972 pouvait s’expliquer par le climat politique de l’époque : mise au pas de l’armée après la guerre d’Algérie, confrontation Est-Ouest, contestation antimilitariste avec les comités de soldats. «Mais, aujourd’hui, une armée républicaine doit être ouverte aux vents et marée de la société civile. Là, on laisse le couvercle sur la Cocotte-Minute», affirme un officier supérieur. «La réforme du statut est une chance que nous laissons passer», ajoute l’un de ses camarades, mécontent de ne toujours pas avoir le droit non plus de se présenter aux élections locales. Un général: «Les syndicats dans l’armée ? Il n’y a que deux solutions. Soit on les aura dans une situation de crise, comme avec le mouvement des gendarmes en 2001 et on ne contrôlera rien du tout. Soit on le fait à froid en imposant des règles.» Un colonel de l’armée de terre : «Chez nous, le syndicat n’est ni une attente, ni un besoin… tant que nos chefs écoutent la base et qu’ils sont eux-mêmes entendus par le pouvoir politique.» C’est-à-dire tant que l’armée reste une priorité du budget de l’Etat (lire aussi en page 11)! Sinon, les militaires s’en occuperont tout seuls, comme le capitaine (retraité) Bavoil et son Association de défense des droits des militaires (1).
Concertation. Pour organiser le dialogue social en leur sein, les armées ont mis en place plusieurs structures qui s’apparentent à ce qui existe dans le secteur civil. Ainsi, dans les régiments de l’armée de terre, il existe des «présidents de catégories» (officiers, sous-officiers, militaires du rang) élus, depuis 2001, par leurs pairs comme le sont les «commissions participatives». Globalement, ce système de «concertation» semble donner satisfaction. Au niveau national, en revanche, les militaires sont représentés par des Conseils de la fonction militaire (CFM-terre, air, mer, etc.) et par un Conseil supérieur (CSFM) dont les membres sont tirés au sort sur une liste de volontaires. Le projet de réforme du statut ne prévoit toujours pas l’élection de ces instances. «Si les armées veulent faire l’économie du syndicalisme, affirme la juriste Clara Bacchetta (2), le CSFM doit devenir un véritable organe de concertation, élu et moins soumis à la volonté du ministre.»
(1) www.defdromil.org
(2) Quelle liberté d’expression professionnelle pour les militaires ? Ed. Ihedn/Economica.