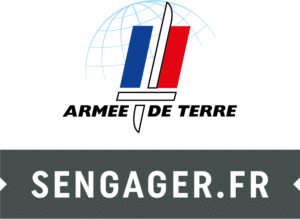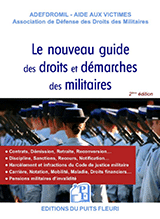1 Le scénario de l’inacceptable
Cette fois-ci, les va-t-en-guerre de la « France d’après », le slogan électoral du candidat Nicolas Sarkozy, ont été entendus. Ce soir, l’Etat va envoyer l’armée au cœur de ce « 9.3 » séditieux. Le décès survenu hier de trois policiers de la BAC de la circonscription, victimes d’un guet-apens dans le quartier des Saussaies, un grand ensemble situé à la jonction du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis, est à l’origine de cette décision, solennellement annoncée par le chef de l’Etat.
Deux jours plus tôt, quatre jeunes d’un quartier limitrophe sont morts après un échange de coups de feu avec les forces de l’ordre, provoquant un déchaînement de violences quasi ininterrompu à l’origine de l’agression des policiers.
L’armée dans les banlieues
Le pouvoir n’a pas hésité. Pour lui, l’heure n’est plus à la politique. La mort des trois policiers a été interprétée comme un rejet de l’ordre public et une déclaration de guerre. Nicolas Sarkozy se doute que ses prédécesseurs n’auraient pas adoré, mais il ne porte pas le même projet de civilisation. Cette intervention de l’armée, il l’a décidée tôt ce matin, en comité secret, lors d’une réunion du Conseil de défense et de sécurité nationale qu’il a présidée à l’Élysée. Où tout cela va-t-il aboutir ? […]
Il est 20 heures. Nicolas Sarkozy repasse à la télévision. Aux journalistes de TF1, France 2 et M6, il explique que c’est l’impuissance à résister à la menace du désordre des banlieues qui a failli mener à la dissolution de la société française, puis il critique ceux de ses prédécesseurs, « partisans de la repentance et de la culture de l’excuse », qui ont ouvert la « voie à un abandon en la croyance des valeurs de la communauté nationale ».
« Cette forme de société a vécu », promet-il. Son intervention tout juste terminée, les premières images de ce nouvel ordre moral gagnent les écrans. Nom de l’intervention : « Opération banlieues ».
Fin de la fiction. À l’heure où j’écris ces lignes (l’été 2010), le « scénario de l’inacceptable » que je viens de décrire relève encore de l’imaginaire. Mais pas de l’invraisemblable : il s’appuie en effet sur des entretiens que j’ai conduits dans le cadre de cette enquête, mais aussi sur des documents parfois confidentiels, des articles parus dans des revues spécialisées et des déclarations politiques faites lors des émeutes de l’automne 2005 – simplement « actualisées » pour tenir compte des prémisses dramatiques de ce scénario imaginaire.
2 Le nouvel outil du président
Pour borner sa domination, il a organisé son pouvoir à la faveur d’un nouvel outil : le Conseil de défense et de sécurité nationale, résultat de la fusion de deux instances, le Conseil de défense et le Conseil de sécurité intérieure.
« Avant que le Livre blanc ne soit validé », explique Patricia Adam, « avant même qu’il ne soit discuté à l’Assemblée nationale puisqu’on n’a discuté de ces questions qu’en mai 2009, déjà en janvier 2008 Nicolas Sarkozy avait mis en place cette nouvelle organisation qu’il préside, bien évidemment. »
Ce Pentagone à la française qui fait l’« éloge de la cohérence américaine » a un atout décisif à ses yeux : « Avec cette doctrine et son organisation », dénonce la députée socialiste, « rien n’empêche aujourd’hui le Président, en cas de crise, de faire intervenir l’armée dans les banlieues, ce qui était impossible précédemment. Or, le Parlement n’a aucun moyen de lui demander des comptes, de demander par exemple l’arrêt de l’intervention des forces militaires. »
Dans son article 5, la loi de programmation militaire affirme que « la stratégie de sécurité nationale a pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter », précisant plus loin que « l’ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale ».
Dans cette représentation, la logique de sécurité, notion éminemment subjective puisqu’elle résulte d’une appréciation individuelle, prime sur celle de défense, bien plus objective puisqu’elle concerne un collectif à défendre face à une menace extérieure très clairement identifiée.
Finalement, en interpénétrant deux logiques différentes, c’est-à-dire en englobant les menaces de toute nature sous un intitulé volontairement flou, le « risque terroriste », la feuille de route sécuritaire sarkozyste rompt avec le contrat social qui est au fondement de la Ve République.
« La dualité police/gendarmerie était une garantie pour la République », souligne le député socialiste Jean-Claude Viollet, spécialiste des questions de défense, qui insiste sur l’un des effets de cette évolution.
« C’était une garantie pour les libertés, pour l’indépendance de la justice qui pouvait librement choisir de confier une enquête à l’une ou l’autre. En outre, la gendarmerie a toujours eu des missions différentes de celles de la police. Elle a une mission de sécurité au quotidien, une mission de défense et de renseignement sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, ces choses sont mélangées. Il y a donc de ce point de vue une difficulté majeure. N’avoir plus qu’une force de sécurité, qui plus est entre les mains du président, c’est une menace pour la République. Je le dis très tranquillement. »
Sans surprise, les effets de cette dérive sécuritaire produisent un écho particulier dans les banlieues populaires. Un extrait déjà cité d’un discours de Nicolas Sarkozy prononcé au Parlement lors des émeutes de l’automne 2005 mérite d’être rappelé :
« Entre le monde de la violence et les valeurs de la République, l’heure de vérité a sonné. L’enjeu est considérable, car si ce n’est pas l’ordre de la République qui règne dans ces quartiers, ce sera celui des bandes ou des extrémistes, et nous n’en voulons pas ! »
Ce réquisitoire n’était pas destiné aux parlementaires. Il avait valeur de profession de foi. Déjà, il annonçait ce que serait la démocratie française cédant à son autorité : un territoire en guerre contre ces banlieues, ce que m’a confirmé le colonel Michel Goya dans un témoignage précieux :
« J’étais un des conseillers du chef d’état-major des armées pour le nouveau Livre blanc. On voyait bien que le pôle d’attraction, le cœur du débat, c’était l’Intérieur. On était dans l’obsession du terrorisme et, du coup, on a concentré tous les moyens de sécurité au sens large sur cette menace. Les banlieues faisaient partie de ces présupposés, ce qui est idiot. »
3 Le spectre de la bataille d’Alger
Ainsi réinterprétée, faut-il en conclure que la bataille d’Alger énoncerait en termes de doctrine une conduite de la guerre urbaine en harmonie avec la perspective d’une intervention dans les banlieues françaises ?
Une nouvelle fois, une observation du colonel Durieux se révèle utile, qui m’a confié en novembre 2009 que des restrictions morales se levaient au sein des armées depuis le milieu des années 2000 :
« Aujourd’hui, le choc post algérois s’est estompé. La plupart des officiers en service n’étaient pas nés au moment du putsch d’Alger. Simultanément, il n’y a plus la pression de la dissuasion nucléaire. Je pense que les officiers ont plus envie d’agir sur la société. Ils sont plus libérés. Il y a un vrai débat pour savoir à quoi sert une armée. »
Le même m’a expliqué sans détour :
« Il y a un débat assez fort sur une intervention dans le cas d’une crise nationale dans les banlieues. J’ai des camarades, des amis qui soutiennent qu’un jour ou l’autre ce sera inéluctable. »
En 2010, ce dernier stade est toujours contesté, voire non admis. Moralement d’une part, car une grande partie de l’armée refuse l’idée même d’intervenir contre des citoyens français ; politiquement d’autre part, car l’utilisation d’une stratégie belliciste pour accomplir une besogne de police déplaît fortement : « Ce n’est pas le rôle des militaires que de régler un problème social ou d’y apporter une solution politique », affirme le colonel Bernard.
« C’est pourquoi le fait d’en être arrivé en 2005 à un couvre-feu est le signe d’un échec. Premièrement, parce que c’est une restriction des libertés ; deuxièmement, parce que vous donnez des pouvoirs exorbitants à la force qui l’impose. J’avais été surpris par ce couvre-feu, comme citoyen et comme militaire. Est-ce que c’était la seule voie possible pour pacifier ? On ne peut pas défendre l’idée que la stabilisation dans tel ou tel pays ne doit pas être uniquement répressive, c’est-à-dire militaire, et faire abstraction en France du volet politique au sens large du terme.
Si la réponse qui a permis de faire baisser le degré d’insécurité, c’est faire de l’urgence… Pour moi, la réponse n’est pas seulement sécuritaire. Il faut s’intéresser aux germes de la violence. »
Ce malaise républicain qui sourd dans l’armée depuis la dérive sécuritaire des « années Sarkozy », s’exprime également, en termes parfois plus vifs, dans les rangs de la gendarmerie nationale.
4 « Est-ce que le métier de l’armée de terre, c’est de faire du contrôle de foule ?
A la remise en question par les gendarmes des fins visées par les responsables politiques en banlieue et du poids relatif de l’autre composante opérationnelle de la sécurité intérieure, s’est ajoutée une autre mise en garde, plus inattendue, exprimée dans les moments informels de mon séjour à Saint-Astier en janvier 2010, ces temps de conversation -pendant les repas, l’apéritif ou le café de 10 heures, les quarts d’heure d’attente entre deux manœuvres, etc- où l’“ enquêté ” s’exprime un peu plus librement.
Comme nous discutions la militarisation de la police, les échanges dérivèrent assez vite sur l’émergence d’un nouveau protagoniste dans la “ gestion ” des banlieues : l’armée de terre. La seule évocation de celle-ci irritait nos interlocuteurs. “ On a mis quasiment un siècle et demi pour en sortir en juillet 1921 [date de création de la gendarmerie mobile]”, a tenu à me rappeler le lieutenant-colonel Mézières.
“Dans une démocratie, ce n’est pas à l’armée d’assurer la fonction de maintien de l’ordre, quels que soient les paramètres spécifiques à notre époque. Rien ne justifie ce retour de l’armée comme acteur sur le territoire national, même si certains brandissent la menace que la France est au bord de l’explosion.”
Un écho direct de ce que m’affirmait à Paris, un mois plus tôt, le colonel Lejeune, à la Direction générale de la gendarmerie nationale :
“ Il n’est pas question d’envoyer la troupe face au peuple de France. Pour faire du maintien de l’ordre, on envoie aujourd’hui des policiers professionnels, qu’ils soient gendarmes ou CRS, et c’est largement suffisant. ”
A leurs yeux, ce qui ne va pas, c’est l’intrusion militaire dans leur champ de compétence, qui rompt avec le partage des légitimités, comme me l’a explicité sur un mode ironique le colonel Quenelle, commandant du centre de Saint-Astier :
“ L’armée de terre dit qu’elle ne peut pas déployer un bataillon supplémentaire en Afghanistan, de quoi vient-elle se mêler en voulant aller dans les banlieues ? Ce n’est pas son métier. Moi, il m’a fallu vingt bonnes années pour commencer à comprendre ce qu’est le maintien de l’ordre.
J’imagine mal un fantassin à qui on va dire : ‘Ben tiens, on va te faire une petite formation avec un bouclier et puis un casque et tu vas descendre dans les banlieues résoudre les problèmes’. ”
Mise au point ou avertissement ? Plutôt l’expression d’une opposition à ce que les gendarmes voient comme un futur où l’armée pourrait se projeter.
5 Tous les moyens sont prêts
La volonté d’en finir avec ces quartiers se traduit sur le terrain par un investissement disproportionné des postures sécuritaires….
Lire la suite sur le site http://www.rue89.com en cliquant [ICI]