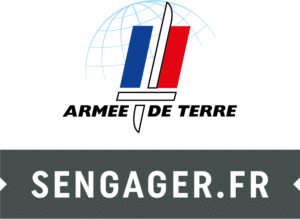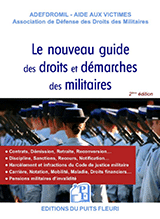Préambule
Le militaire s’intéresse rarement au Code des Pensions d’Invalidité et des Victimes de Guerre (CPMIVG) avant de ressentir dans sa chair les stigmates d’un traumatisme ou d’une maladie dont la responsabilité incombe possiblement à l’institution. Le problème est que, à ce moment là et au travers des commissions de réforme pension invalidité des militaires (CRPMI), le ministère de la défense semble rechigner à admettre une quelconque responsabilité. Mais surtout à lâcher l’indemnisation correspondante.
Depuis sa fondation, l’ADEFDROMIL travaille sur quelques unes des nombreuses demandes de pension militaire d’invalidité (PMI). Une étude de cette base de données originale montre bien des récurrences et des constantes, tant du côté du frêle requérant que du « mammouth » institutionnel. Les interrogations du premier sont parfois malhabiles, les réponses du second sont toujours surprenantes, voire décevantes.
Fort de ces constatations, de l’attitude souvent bienveillante des juges et de quelques succès, l’association intervient en conseillant les impétrants, ou parfois même leurs avocats, dans le lent processus juridico-administratif qui débute précisément au moment de l’évènement vulnérant et se termine de façon plus incertaine, et bien des années plus tard, par une éventuelle indemnisation.
Le principe d’indemnisation des infirmités séquellaires
Première légende à détruire, le principe de la compensation d’une infirmité « du travail » par une rente en espèce ou un capital n’est pas une exclusivité du monde combattant.
Qu’il soit pêcheur de morue à Terre Neuve, sous-marinier nucléaire, employé d’EDF, parachutiste, poinçonneur des Lilas, tout « salarié » est protégé par des systèmes de prise en charge médicale, de soins gratuits, et d’indemnisation des séquelles d’accidents ou de maladies survenues du fait du travail.
C’est un peu moins vrai pour les maladies professionnelles.
La multitude des régimes d’indemnisation n’est pas un problème en soit, mais l’éclectisme n’est pas non plus un gage de simplicité, ni et surtout, d’équité.
Dans certains cas le militaire sera nettement avantagé, par exemple avec son système de calcul du pourcentage d’invalidité résultant d’infirmités multiples, et qui peut atteindre plusieurs fois 100%, au gré du jeu des « surfixes ». Le civil lui, sera limité par une bien compréhensible impossibilité de dépasser 100% d’invalidité pour un même individu.
Dans d’autre cas, la balance s’inverse et l’adjudant chef quittera le service actif, sourd comme un pot, sans avoir pu mettre en évidence « un fait précis de service », là où son homologue civil bénéficie du principe des maladies professionnelles, c’est-à-dire de présomption d’imputabilité au bout d’un certain délai d’exposition. Bruit = surdité d’apparition progressive et insidieuse en quelques années.
Le principe spécifiquement militaire du « temps » considéré
Le CPMIVG distingue deux périodes :
Le temps de guerre, où s’applique une présomption d’imputabilité. A l’intérieur de cette période, et concernant toute pathologie, c’est au ministre de la défense d’apporter la preuve que l’infirmité éventuellement résiduelle n’est pas imputable au service. Ce qui, par exemple, sera impossible dans le cas d’une maladie apparue quelque temps après l’exposition à un « toxique » dont on connaît mal les effets. Le temps « hors guerre », qui peut porter tout autre nom : maintien de l’ordre, OPEX, intervention extérieure, etc. Dans ce cas beaucoup plus fréquent et général, c’est au militaire d’apporter la preuve que l’infirmité résiduelle d’une pathologie, traumatique ou non, est imputable au service. Ce qui est tout aussi impossible dans le même exemple d’une maladie apparue quelque temps après l’exposition à un toxique dont on connaît mal les effets.
Cette distinction est loin d’être innocente. Prenons la récente « guerre du Golfe ». Si « guerre » avait eu lieu, les victimes du « syndrome » du même nom auraient été indemnisées. En cas de « guerre », aucun scientifique n’aurait été en mesure d’apporter la preuve irréfutable que l’association d’un stress prolongé, d’un décalage horaire et thermique, d’une mise à jour de plusieurs vaccinations, de la prise de produits pharmaceutiques divers, et de l’exposition à un tas de substances inhabituelles n’avait aucun lien avec les pathologies présentées par les « vétérans » français.
Exit la « guerre », et la thèse inverse est tout aussi impossible à démontrer. Sauf et éventuellement sur la surveillance épidémiologique de très long terme.
Remarquons accessoirement que la différence entre une guerre et une « non guerre » reste très intuitive puisque dans les deux cas les risques sont absolument identiques. Une autre définition, prenant par exemple le combat avec ouverture du feu, éventuellement sur une durée significative, aurait sans doute clarifié la situation. Elle serait surtout plus équitable puisqu’en « temps de guerre », il n’est pas forcé de participer à un combat pour se voir reconnaître la présomption d’imputabilité quelque soit la pathologie et les séquelles présentées.
Mais actuellement, la guerre n’est pas la guerre et la guerre ne le sait pas.
Cependant, et pour clore le sujet sur une lueur d’espoir, les combattants de la « drôle de guerre du Golfe » ne doivent pas désespérer. Les dix années de « maintien de l’ordre » en Afrique du Nord se sont finalement vues reconnaître la qualité de « temps de guerre » vers 1999, soit 40 ans plus tard (article L1 bis du CPMIVG).
La guerre d’Algérie a bien fini par avoir eu lieu, pourquoi pas celle du Golfe ?
Le principe de la preuve
En dehors du « temps de guerre », il faudra donc fournir la preuve de l’imputabilité.
La démonstration de la relation entre le service et l’accident est généralement apportée par la production d’un « rapport circonstancié » (RC), ou de son grand frère, l' »extrait du registre des constatations » (ERC ? notons une fausse similitude des sigles).
Pour simplifier : ERC = RC + constatations médicales.
Le RC est une pièce maîtresse du dispositif et on est en droit d’en attendre le meilleur… comme d’en redouter le pire. Car son contenu sera autant combattu par la commission de réforme pension militaire d’invalidité (CRPMI) dans ce qu’il aura d’avantageux pour la victime, qu’érigé en vérité absolue dans ce qu’il y aura de néfaste. Et parfois seules les omissions auront réellement valeur de preuve.
Il est bien évident que tout militaire blessé dans des circonstances compatibles avec une imputabilité au service doit réclamer (s’il est en état de le faire) la rédaction de ce RC, si besoin par demande écrite, et en vérifier le contenu.
Le soin de procéder à la rédaction du RC revient « normalement » à une autorité proche de l’accidenté et « si possible » témoin de l’évènement. En l’espèce, il s’agit ni plus ni moins d’un procès verbal de constatation.
Il faut cependant reconnaître qu’en règle générale, on a rarement la « chance » de choir devant son chef de service, et que ce papier, trop souvent considéré comme une formalité administrative, est souvent élaboré à distance du tumulte de la catastrophe, plus ou moins sur la foi de témoins, éventuellement présents.
Mais point n’est suffisant d’avoir réussi à obtenir le RC et l’ERC, encore faut-il qu’ils soient suffisamment précis.
Ainsi, le second maître KERTRUC chutant en se prenant les pieds dans ceux du coureur précédent au cours d’un footing risque de se voir gratifié d’un épitaphe du genre : « Alors qu’il courait, le SM KERTRUC est tombé et s’est fait mal au genou ». Ou pire : « Alors qu’il courait, le SM KERTRUC a ressenti une violente douleur au genou ». L’absence de mention du pied adverse va coûter très cher (Cf. plus loin).
Et là il faut détruire une autre légende. Si le RC est d’une utilité incontestable, tous les témoignages d’autre nature sont parfaitement recevables. Aussi, dans les cas de non rédaction du RC, voire de RC non satisfaisant (voire volontairement tendancieux), nous ne pouvons que recommander de recueillir le maximum d’attestations circonstanciées auprès des témoins de la scène. Cette démarche sera d’autant plus indispensable que l’institution peut ne pas vouloir ébruiter des actes révélant une défaillance (cas des rixes par exemple, ou pire, des sévices). Allez faire signer un RC du genre : « Après que l’adjudant DUCHMÖL lui eut botté les fesses, le caporal MACHIN s’est viandé dans l’escalier ». Croyez-le ou non, sans la botte de l’adjudant il sera difficile d’indemniser MACHIN, même avec une invalidité reconnue à 25% (Cf. : encore plus loin).
Le principe de « fait précis de service »
A l’origine, le législateur avait benoîtement exposé qu’ouvraient droit à pension :
« Les infirmités résultant de blessures reçues par suite … d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service » « Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service » « L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service » (Art. L2)
Les exégèses jurisprudentielles ont progressivement réduit l’expression « par le fait du service » en « un fait précis de service ». Et nous verrons plus loin que ce fait doit en plus être « violent » et « extérieur » pour bénéficier pleinement à la victime.
Cette évolution n’est pas sans conséquence sur le moral des troupes. Autrefois, et pour reprendre l’exemple du footing de KERTRUC, tout incident lors d’un footing plus ou moins collectif, plus ou moins habituel, plus ou moins « encadré » et plus ou moins loin de la caserne, était systématiquement considéré comme « en service ». On signifiait même, à l’époque, qu’un militaire qui entretenait sa forme physique, le faisait dans l’intérêt de tous et du service.
Ce qui n’était pas complètement idiot.
Aujourd’hui, et si vraiment il n’existe aucune alternative à l’exercice physique, il vaut mieux se gameller à l’intérieur de la caserne, sous les yeux des autorités, lors d’un exercice dûment prévu sur une feuille de service comportant la liste des participants, et dans un créneau horaire compatible avec les « heures normales de service ».
Et, même dans ce cas hyper favorable, ce n’est pas gagné d’avance.
Devant une telle involution récente (une dizaine d’années), la plus élémentaire des précautions est de se renseigner exactement sur les circonstances de l’activité proposée (voire ordonnée !). Il est clair que les « initiatives sportives » de dernière minute, à plus forte raison si elles entraînent un éloignement de l’enceinte militaire, doivent être considérées avec beaucoup de circonspection.
C’est d’ailleurs un dogme plus général et tout accident démontre a posteriori que l’initiative au cours de laquelle il s’est produit était stupide.
Pour cette raison, en cas d’accident pouvant entraîner des séquelles, il est indispensable de se constituer un dossier comportant la totalité des pièces administratives relatives à l’activité causale. Ca paraît fastidieux sur le coup, mais ça l’est encore plus s’il faut retrouver les mêmes documents plusieurs années après.
A titre d’exemple, l’ADEFDROMIL a étudié un accident de rugby, d’une certaine gravité, survenu sur un terrain de sport civil, un jour de semaine après 18 heures.
La sentence de la CRPMI, plusieurs années après la blessure, a été claire : « Hors service, voyez ça avec votre assurance ! ». Motif invoqué : « n’était plus, au moment des faits sous le contrôle de l’autorité militaire ».
Sachant que les déclarations auprès des assurances se font dans les jours qui suivent sous peine de nullité, la cause paraissait entendue.
La victime avait heureusement conservé l’ordre nominatif collectif de se rendre sur le terrain à 18 heures, et de participer au tournoi, signé du commandant de la base, accessoirement président du club sportif.
Imparable ! car la mission « fire and forget » n’existe pas encore, mais pas toujours aussi facile si on n’a pas conservé ce genre de preuve.
Les éléments du dossier médical
Avec un peu de chance, l’accidenté aura été dirigé sur l’infirmerie (qui s’appelle centre médical désormais, mais où il est de plus en plus difficile de trouver un praticien). Là, un toubib l’aura peut être examiné et expédié à l’hôpital (vraisemblablement civil) pour radiographies ou consultation spécialisée. Toutes ces démarches sont consignées dans le livret médical (LM) et portent témoignage de la violence du traumatisme, de la relation entre l’accident et la blessure, et des conséquences immédiates.
Mais au fur et à mesure que disparaissent les médecins des unités, disparaissent aussi les « constatations immédiates ». Ne pas hésiter à préciser aux médecins des urgences qu’il s’agit d’un accident du travail, ce qui amènera l’urgentiste à renseigner des documents spécifiques et très utiles par la suite. Demander pareillement une copie de tous les actes médicaux et paramédicaux réalisés, c’est un droit ancien auquel l’accès a été récemment facilité.
Cependant, il en va du LM comme du RC.
La commission de réforme pension va s’acharner à retrouver dans le passé médical de la victime, tout élément pouvant venir en déduction des séquelles de l’accident.
On peut déjà s’étonner qu’une commission agissant pour le compte d’un tiers (l’institution), certes au bénéfice supposé du patient, ait accès au dossier médical, intégralement et complaisamment fourni par le médecin d’unité, dépositaire.
Légalement, la demande de pension lève le secret professionnel sur les éléments pathologiques relatifs à l’affection en cause et à ses conséquences. Mais pas au-delà.
Il nous semble que la manière dont le médecin d’unité se dessaisit de la totalité des éléments médicaux insérés dans le LM, au profit des membres de la CRPMI, déroge excessivement au droit commun.
A titre d’exemple, l’ADEFDROMIL a vu passer un dossier dans lequel le médecin de la commission soulevait une « obésité » concomitante d’une entorse grave du genou, ainsi qu’une consultation antérieure pour « gonalgies », dans le seul but d’atténuer la responsabilité de l’accident de service, tout comme la part indemnisable des séquelles.
Tout résultat d’une consultation survenue en cours de carrière, c’est à dire ce qu’un militaire a confié au médecin, ou ce que le médecin a constaté, déduit, compris et écrit, est ainsi systématiquement divulgué à l’occasion d’une étude de droits à pension, et peut s’étaler dans une multitude de documents administrativo-juridiques, ouverts à tout vent. Cette légèreté dans la gestion du secret médical semble limitée aux personnels militaires, n’a pas d’équivalent dans le monde du travail, et pas non plus de support légal solide.
Cela dit, il n’est même pas nécessaire d’introduire une demande de PMI pour voir ses petits secrets médicaux franchir les océans sur simple demande de la Direction du Service de Santé à l’occasion de certaines enquêtes propres à l’institution (Cf. : affaire LEBIGRE).
La demande d’étude des droits à pension
Qui l’introduit ?
Tout militaire, ou le cas échéant ses ayants droit, peut demander que soient étudiés les droits à pension militaire d’invalidité relatifs aux séquelles d’une pathologie.
Et, à notre avis, personne d’autre. Car la demande entraîne dérogation légale au principe du secret médical sur les pathologies en cause, et il paraîtrait surprenant qu’un tiers puisse décider de lever ce secret sans une demande expresse de la victime.
La remarque s’applique à toutes les « constitutions systématiques d’un dossier de PMI » prescrites par certains textes dans certaines circonstances, et apparemment sans l’aval du « bénéficiaire ».
Quand faire la demande ?
Dés que possible !
Car la date de départ de la jouissance d’une PMI éventuelle est celle du dépôt de la demande, et en aucun cas celle de l’accident causal.
On vous objectera que si vous vous y prenez trop tôt, les séquelles ne seront pas encore constituées et donc inquantifiables. A cela répondez que le délai entre le dépôt de la demande et la première ébauche de mouvement de la CRPMI sera largement suffisant pour laisser les cicatrices se former et les os se ressouder.
On vous objectera souvent que les séquelles de petits « incidents » ne seront pas suffisantes pour ouvrir un droit à pension. Certes, mais à se petit jeu là, vous quitterez le service actif au bout de 35 années, couturé de cicatrices, d’arthroses, et d’autres misères, dont aucune n’atteignait les 10% fatidiques, mais qui, prises ensemble, vous indisposeront à 60% pendant la totalité de la durée de votre retraite.
Toute étude laisse la trace d’une évaluation « a titre documentaire ». Une « maladie » dont les séquelles seront évaluées à 20% d’invalidité (donc non indemnisable), plus deux blessures à 5% (donc non indemnisables), donnent ensemble une pension d’invalidité à 30%.
Et il est plus facile de faire constater l’aggravation secondaire éventuelle d’une pathologie déjà évaluée à titre documentaire.
On ne vous objectera pas qu’une demande de pension pour votre infirmité risque de vous faire perdre votre aptitude parachutiste, plongeur ou sous marinier, car cela s’appellerait un chantage odieux et personne n’oserait s’y livrer. Enfin, espérons.
Comment et où ?
Une simple demande écrite adressée à la CRPMI du lieu d’affectation. Cette commission siège au sein des directions interdépartementales des anciens combattants et des victimes de guerre (DIACVG).
La date de dépôt étant très importante, un RAR est de rigueur.
Combien ça coûte ?
Le prix du RAR. Et celui des photocopies que vous joignez à l’appui de votre demande.
Toutes les procédures sont gratuites, y compris les actions devant le tribunal des pensions.
Combien de temps ça prend ?
Absolument variable, mais de toute façon énormément.
Mais le temps qui court n’est en rien préjudiciable à l’indemnisation qui se fera avec effet rétroactif du jour de dépôt de la demande.
Que se passe-t-il ensuite ?
La demande va être étudiée.
La CRPMI va réclamer la constitution d’un dossier comportant des pièces diverses, administratives et médicales (dont le fameux livret) aux détenteurs de ces renseignements (unité, infirmerie, intéressé).
Le dossier va être exploité et une expertise peut être demandée auprès d’un médecin désigné ou à choisir dans une liste de médecins désignés.
En fin d’exploitation des divers éléments dont expertise, une première proposition peut être avancée. C’est le « constat provisoire des droits à pension en l’état actuel du dossier ».
Ce « constat provisoire » est très généralement décevant et peut sembler constituer une montagne de mauvaise foi pour le requérant :
L’accident n’a pas eu lieu en service S’il a eu lieu en service, il n’est rien arrivé S’il est arrivé quelque chose, il n’y a pas de séquelles S’il y a des séquelles, elles étaient là avant l’accident Si elles n’étaient pas là avant, leur taux d’invalidité est dérisoire Et enfin, si le taux n’est pas dérisoire, la fracture n’est pas une blessure mais une maladie (sic !) non indemnisable en dessous du seuil de 30%.
Arrêtons-nous un instant sur ce dernier point car il est très important. Au fil des recours qu’il intenta presque systématiquement depuis 1992 contre les décisions favorables aux victimes, le Service des pensions militaires a développé une jurisprudence surprenante.
Reprenons le cas du SM KERTRUC : les pieds du coureur précédant ne figurent pas dans le RC. Pour la CRPMI, il est donc tombé tout seul. Pire, c’est peut-être son mal au genou, celui pour lequel il a consulté il y a trois ans, qui est à l’origine de la chute. Qu’il s’estime déjà heureux d’avoir pu être engagé dans un tel état, non mais.
Suivons le sophisme institutionnel (un cheval bon marché est rare…) :
Si l’infirmité de KERTRUC est consécutive à une blessure, cette blessure provient nécessairement d’un accident. Mais un accident requiert obligatoirement l’intervention violente d’un fait extérieur. En l’occurrence et d’après le RC, c’est KERTRUC qui s’est emmêlé les pinceaux ou dont le genou, complètement usé par ses turpitudes antérieures, a lâché. Il n’y a manifestement pas intervention violente d’un fait extérieur. Il ne s’agit donc pas d’un accident. L’infirmité présentée par KERTRUC ne provient donc pas d’une blessure. Elle provient donc nécessairement d’une maladie. KERTRUC qui est invalide à 25 % l’a dans l’os (au propre comme au figuré).
Et c’est comme ça qu’ont été étiquetées « maladies » une multitude de séquelles de traumatismes manifestes dans lesquels aucun fait extérieur ne pouvait être identifié.
Mais avant de s’en plaindre, constatons qu’il aurait été encore plus facile, pour les CRPMI, de démontrer qu’il n’y a pas non plus de maladie (à cause de la soudaineté de création des lésions par exemple). Ni blessure, ni maladie, circulez, de quoi vous plaignez-vous, fainéant, puisqu’en l’absence de maladie ou de blessure, il ne peut y avoir d’infirmité.
« Ya comme un défaut…Mais c’est parce que vous vous tenez mal ! » (Fernand Raynaud)
D’où la nécessité de faire apparaître dans le RC le pied du coureur précédent qui « intervient » violemment dans la genèse de l’accident, ou de tout autre élément du genre.
Le cas échéant bien entendu.
Et cette fois-ci, KERTRUC est bien pensionné à 25% puisque la blessure est indemnisée à partir de 10%
Et ensuite ?
La DIACVG proposera au requérant une décision prise à partir du constat provisoire (rapide), ou de faire passer le dossier devant la CRPMI (avec la mention : « A une date à déterminer », ce qui est censé inciter le quidam à choisir la première solution.
Le passage devant la CRPMI n’a que peu de chance d’être plus favorable que le « constat provisoire ». On peut sans doute en faire l’économie, ou jouer la montre.
Quoiqu’il en soit, le demandeur disposera d’un délais de six semaines pour accepter la décision de l’une ou l’autre procédure (rapide ou CRPMI) ou pour se pourvoir devant le Tribunal Départemental des Pensions (TDP). La décision en question est prise par le Ministère de la Défense, Direction de la fonction militaire et du personnel civil, Service des pensions, Sous direction des pensions militaires, Bureau des pensions militaires d’invalidité.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fortement souhaitable de ne pas s’en contenter, surtout si elle refuse toute indemnisation alors qu’une expertise a constaté des séquelles.
Pourquoi et comment saisir le Tribunal des Pensions ?
Par expérience nous savons qu’un grand nombre de dossiers rejetés par les CRPMI sont accueillis favorablement par les Tribunaux.
Le Juge fonde ses décisions sur un débat contradictoire sans parti pris et n’accepte que rarement la notion de « maladie » pour une fracture, ou celle de « conditions normales de service » pour un parachutiste perclus de rhumatismes.
De plus, un avocat assiste le plaignant.
Enfin, l’expert du Tribunal est souvent plus juste que celui commis par l’institution militaire. Mais c’est un hasard.
Combien ça coûte ?
L’assistance judiciaire est accordée à tout militaire qui en fait la demande au Président du Tribunal, sans condition de ressources. C’est l’une des caractéristiques sympathiques des procédures du Code des Pensions militaires.
Le requérant peut choisir son avocat pour peu que ce dernier accepte la rémunération forfaitaire. Autrement un autre est commis d’office.
Combien ça prend de temps ?
Toujours aussi variable, mais à ce stade, on n’est plus à quelques mois près. Tout dépend de la nécessité de désigner un spécialiste pour une contre expertise, des encombrements éventuels des TDP, des diligences respectives des intervenants, des délais légaux pour présenter des observations, etc.
Mais le tribunal finit par prendre une décision qui s’impose au Ministère de la Défense comme au plaignant.
Alors à ce moment là j’obtiens enfin ma pension ?
Tout à fait, enfin peut être si le juge a donné raison au demandeur, et avec l’effet rétroactif des années écoulées depuis la demande.
Mais attention ! Le Ministre de la Défense interjette constamment appel quand ses conclusions sont rejetées par le Tribunal.
En cas d’annulation du jugement en appel, généralement des mois plus tard, l’ex-pensionné est appelé à restituer les sommes versées par l’administration. Ce qui n’est pas toujours évident quand on a fêté sa victoire.
La cour d’appel peut cependant confirmer le jugement… et le Ministère se pourvoir alors en Cassation.
Inutile de s’étendre sur ces deux procédures, car s’il a tenu jusque là, le requérant est devenu un spécialiste de la chose.
Dans toutes les procédures ultérieures, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est conservé.
L’avenir ?
La succession d’instances diverses qui s’emparent de la demande initiale, la triture, la transforme, pour la rejeter dans la plupart des cas, constitue une perte de temps et une organisation d’une lourdeur insupportable. Combien de requérants jettent l’éponge avant même la conclusion de la CRPMI ?
Combien de victimes jugent même d’emblée inutile de demander réparation ?
A combien de militaires laisse-t-on entendre, implicitement par l’appellation même de la commission (de réforme) ou explicitement dans la discrétion du cabinet médical, que leur demande d’indemnisation peut se répercuter sur l’aptitude à servir ou à certaines spécialités ?
Ce qui serait non seulement absolument faux, mais n’évitera pas, même en l’absence de dépôt d’un dossier de PMI, de tirer les conséquences de l’accident sur l’aptitude, tôt ou tard.
Le ressentiment provoqué par le rejet des prétentions en matière de pension est l’un des plus forts qui soit. A la perception d’injustice se mêlent des sentiments de dépréciation et de vulnérabilité relatifs à l’infirmité. De trahison aussi, d’abandon parfois.
On peut oublier une sanction ou une notation vécue comme inique, mais pas une douleur permanente ou une boiterie. De surcroît, la comparaison fréquente avec d’autres dossiers plus chanceux renforce l’impression de gigantesque loterie, ou pire de passe droit.
La principale caractéristique de l’être humain face à l’adversité, est sa capacité d’adaptation. Il apparaîtra rapidement préférable de s’orienter directement vers des voies contentieuses moins aléatoires (mise en jeu des responsabilités personnelles, accidents thérapeutiques, accident causé par des équipements sportifs, mise en danger, coups et blessures involontaires, etc.) que de déposer une demande de PMI. Les assurances juridiques qui fleurissent, à l’exception notable de celles qui ont convenu de ne jamais se retourner contre l’institution, pousseront d’ailleurs leurs clients vers de telles solutions rapides.
Et ce d’autant plus que l’évolution de la jurisprudence en matière d’accidents survenant à des salariés privés est constamment favorable.
Cela dit, des améliorations sont intrinsèquement possibles pour redonner au Code des Pensions Militaires son sens véritable de « contrat d’assurance tout risque ». La commission de révision du statut général des militaires (CRSGM) était même sensée s’intéresser aussi à un toilettage des conditions d’accès aux PMI. Notons par ailleurs qu’un jugement récent vient de mettre à mal le sacro-saint principe de la réparation forfaitaire. Principe extraordinaire qui prétend que, n’ayant pas été pensionné, vous n’avez forcément pas non plus souffert.
Enfin, d’autres pays européens contractent des assurances auprès d’organismes privés avant d’expédier leurs troupes au combat. De là à ce que ces assurances négocient avec celles de l’ennemi une sorte de gentlemen agreement style « cessez le feu économique », il n’y a qu’un pas que ces méga boîtes internationales franchiront sans état d’âme.
Pour conclure, citons le Contrôleur général BONARDO, dans son volumineux rapport préparatoire aux travaux de la CRSGM : « Il ne semble en effet guère possible d’admettre que les hommes et les femmes qui assurent la défense de la Nation et de ses intérêt, en exigeant d’eux qu’ils le fassent jusqu’au péril de leur vie si nécessaire, bénéficient d’une moindre protection que celles et ceux qu’ils défendent. »
Personne ne pourra dire qu’il ne savait pas.
Quelques chiffres…
De 1992 à 1999, le nombre de pensionnés militaires d’invalidité a diminué de 136.812 bénéficiaires.
L’économie réalisée entre les dépenses de 1992 et celles de 1999 s’élevait à plus de 3 milliards de francs.
Au 31 décembre 1997, la pension militaire d’invalidité la plus élevée atteignait 1.533.522 francs de versement annuel (versus pension civil d’invalidité la plus forte : 530.907 francs).
Les pensions militaires d’invalidité sont non imposables et insaisissables.
Lire également :
Pensions militaires d’invalidité : réaction d’un lecteur