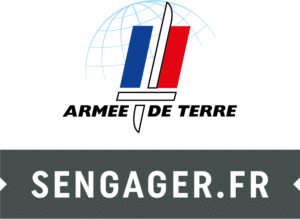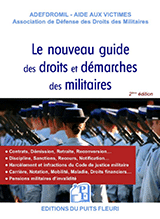Commission de la défense nationale et des forces armées
Présidence de M. Jean-Jacques Bridey, président, puis de M. Charles de la Verpillière, vice-président
La séance est ouverte à seize heures trente.
M. le président Jean-Jacques Bridey. Notre commission accueille aujourd’hui le général Jean-Claude Gallet, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) qu’elle entend pour la première fois. La BSPP a perdu récemment deux hommes, dans mon département d’élection, dont l’un dans ma circonscription même. À l’occasion des deux cérémonies très émouvantes auxquelles nous avons assisté, à la caserne Champerret, je vous ai proposé, Mon général, de venir devant nous pour une audition.
Nous espérons vous entendre d’abord sur votre expérience de militaire, puis sur les enjeux et défis de protection civile auxquels est confronté l’ensemble du territoire. À l’instant, vous m’expliquiez aussi que vous conduisiez également des actions de formation à l’extérieur.
Général Jean-Claude Gallet, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je commande la brigade de sapeurs-pompiers de Paris depuis un an. Auparavant, j’étais l’adjoint du commandant. Je suis saint-cyrien et j’ai effectué quinze années au sein de la BSPP. Je vous présente le colonel Joseph Dupré La Tour, qui est le chef d’état-major de la brigade et l’assistant militaire, le capitaine Clément Cognon.
Je vais exposer les enjeux propres à la BSPP, ses forces et ses faiblesses, en cherchant à partager avec vous sa vision de l’avenir à dix ans, le tout s’inscrivant dans ce qu’on appelle le « continuum sécurité défense ». Je vais bien sûr évoquer la singularité de cette unité militaire implantée en région parisienne. Mais je pense que vous pourrez, en tant qu’élus de terrain, trouver dans mon propos matière à nourrir des réflexions sur vos propres services d’incendie et de secours.
Cet échange est aussi d’actualité parce que la France est confrontée à des crises, qu’elles soient d’origine naturelle, accidentelle, ou humaine – lorsque, par exemple, il s’agit d’actions terroristes. Si les services de secours et les services de l’État ne sont pas en mesure de répondre à ces crises, cela altère durablement la relation de confiance entre l’État et les citoyens, d’où l’importance de pouvoir dialoguer et d’échanger avec les politiques, avec les élus que vous êtes. Pour moi, cette démarche est très saine. J’aurai donc un discours de transparence, même si je n’ai pas prévu d’aborder les questions liées au terrorisme.
Cet échange est aussi opportun parce que la gestion des crises concerne une multitude d’acteurs, qui relèvent d’entités et de ministères différents et ne se connaissent pas forcément en amont, si bien qu’ils fonctionnent encore parfois en silos. Pour ma part, je pense que le politique doit servir de catalyseur pour mettre tout le monde autour d’une table de façon à avoir une manœuvre combinée, à l’instar de ce que les militaires nous démontrent tous les jours dans les opérations de maintien de la paix ou dans des opérations un peu plus coercitives.
Pour moi, les facteurs de succès dans le traitement des crises sont très simples. Ce sont la confiance, la connaissance mutuelle et un seuil d’information commun. Autant de points qui se travaillent en amont, pendant les crises et après elles, par un retour d’expérience.
Mon intervention sera articulée en trois parties. J’évoquerai d’abord la singularité de la brigade, qui existe depuis maintenant deux siècles dans ce modèle de sécurité civile ; j’évoquerai ensuite sa place et le rôle qu’elle joue dans le continuum sécurité-défense, ne menant pas seulement des actions de sécurité civile, mais aussi des actions d’éducation de la population, visant à améliorer la résilience, l’intégration et la cohésion nationale ; enfin, j’attirerai votre attention sur un point de fragilité de la brigade dont je pense qu’il est commun à vos services d’incendie et de secours.
La BSPP a pour première particularité de résulter d’un accident de l’histoire. Elle a en effet été créée en 1811 par l’empereur Napoléon, à la suite d’un incendie catastrophique à l’ambassade d’Autriche. L’empereur y a échappé de justesse à la mort et a décidé de confier la lutte contre les incendies à une unité militaire, soumise à l’autorité du préfet de police.
Je m’attarderai un peu sur cette double singularité. Le statut militaire nous permet de disposer d’unités qui assurent la continuité des services de l’État. Sous ce statut, il n’y a pas de droit de grève ni de droit de retrait ; il instaure au contraire une disponibilité spéciale.
Sa principale plus-value n’est cependant pas là, mais plutôt dans l’organisation militaire de la sécurité civile, fondée sur un cercle vertueux de doctrine : à l’analyse de l’évolution du risque s’ajoute le retour d’expérience, d’où découlent la recherche de nouveaux équipements et la préparation opérationnelle ; cette unité est ainsi en perpétuel mouvement, sur le plan de la théorie, de la doctrine et du règlement.
Comme unité militaire, elle pratique aussi la culture interarmées, ce qui se traduit, à mon niveau de sécurité civile, par la coopération interservices. Nous discutons avec des acteurs relevant de ministères différents, au premier rang desquels le ministère de la Santé, notamment à travers l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) et différentes agences, mais aussi Aéroports de Paris (ADP), la SNCF et la RATP.
Notre deuxième point d’excellence est l’intégration au sein de la préfecture de police (PP). On peut ainsi disposer, dans la préparation des crises, de toute l’information, mais également des capacités des grandes directions de la PP. Par exemple, les pompiers coopèrent avec le laboratoire central dans le cas d’un incident technologique ou d’un problème de déminage, la police judiciaire étant compétente, dans le cas d’un attentat, pour l’identification des victimes ; lorsqu’il s’agit d’entraver une menace, les brigades de recherche et d’intervention (BRI) sont responsables ; les deux autres directions permettent l’accès aux sites concernés.
La coopération entre ces services s’opère de manière naturelle parce que nous travaillons quotidiennement ensemble, des grands chefs jusqu’au niveau du commissariat et des centres de secours.
Le troisième point particulier, c’est l’intégration médicale, pratiquement dès la création de l’unité. Parmi les 70 médecins de la brigade, il y a 40 médecins militaires ; la plupart ont servi sur les théâtres d’opérations extérieures. Nous nouons un partenariat « gagnant-gagnant » avec le service de santé des armées (SSA) dont les médecins sont formés, à la brigade, comme urgentistes. Nous connaissons en effet une moyenne hebdomadaire de 15 à 16 blessures par arme blanche et d’une à deux blessures par arme à feu. En termes d’intervention, cela fait appel à des savoir-faire qu’on rencontre en traitant des blessés de guerre en opérations extérieures. Mais ces médecins ont surtout la capacité de faire le tri en situation de catastrophe ou de pertes massives.
Dernier point intéressant : le sapeur-pompier militaire est un technicien et un tacticien qui va affronter le feu, l’inondation, l’explosion de gaz, le tremblement de terre – autant de phénomènes qui ne sont pas mus par des intelligences nuisibles. On peut mourir en tant que pompier parce qu’on ne respecte pas les procédures ou parce qu’on n’a pas de chance, mais, derrière ce décès, il n’y a pas d’intelligence qui travaille à casser notre manœuvre. Cependant, comme sapeurs-pompiers militaires, nous avons une double culture : culture du risque et culture de la menace.
La première question qu’un chef militaire se pose en opération extérieure est de savoir ce que va faire l’ennemi face à son action. Le 13 novembre 2015, c’est la question qu’on s’est posée : Est-ce une séquence ? Est ce qu’on doit conserver une réserve ? Quel est le mode d’action des terroristes ?
Si nous ne nous étions pas posé cette question, nous aurions pratiquement envoyé l’ensemble des moyens en Seine-Saint-Denis – car la brigade est une structure interdépartementale. Nous aurions alors été « tapés » dans le dos 40 minutes plus tard. Dans cette perspective d’attentats, notre bonne entente avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers explique notre vraie complémentarité avec elle. Ne s’agit-il pas d’un enjeu national qui fait oublier les logiques de statut ?
J’en viens à la place de la BSPP au sein de l’armée de terre. Elle fait partie du commandement du théâtre national (COM-TN). C’est une grosse unité de 8 500 femmes et hommes regroupés au sein d’une entité qui inclut le service militaire adapté (SMA), le service militaire volontaire (SMV), les unités d’intervention de la sécurité civile, le régiment du génie de l’air, etc.
Ce choix est cohérent dans le cadre du continuum sécurité défense. Nous cohabitons en effet avec les unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC), en échangeant avec elles tant en termes de doctrine que de retour d’expérience. Parfois, nous les appuyons lorsqu’elles sont projetées. Car, si la brigade a une logique territoriale, les UIISC sont, quant à elles, parfois en projection sur le territoire national, dans les DOM-TOM ou à l’étranger. Nous leur apportons alors un appui en médecins ou en unités de sauvetage et de déblaiement, comme c’était le cas pour l’ouragan Irma ou sur d’autres interventions.
La brigade réalise chaque année 1 200 actions de formation au profit des jeunes. Nous nous situons ici dans le prolongement du SMA et du SMV. Une possibilité serait de recruter les jeunes qui correspondent à nos critères au sein du SMV, ce qui garantirait une certaine continuité. Quant au régiment du génie de l’air, il apporte des ressources et des capacités critiques en cas de crise majeure, pour le rétablissement des itinéraires.
Notre positionnement au sein du COM-TN a ainsi finalement permis à la brigade de s’exprimer, au travers de ses retours d’expérience, en termes de doctrine. Il permet également d’avoir un lien avec le centre de conduite et de planification des opérations (CPCO) du théâtre national, en cas de montée en puissance de l’opération « Sentinelle ». Il permet enfin de disposer d’informations sur les modes opératoires terroristes, de façon à pouvoir actualiser notre doctrine.
J’en viens au troisième atout de la BSPP depuis plus de cinquante ans, à savoir sa structure interdépartementale. La BSPP défend en effet Paris et les trois départements de la petite couronne.
En termes de coût, cela représente une seule école pour quatre départements de formation, mais cela facilite surtout la gestion de la couverture des risques courants. En effet, pour nous, il n’y a pas, dans ce qui est l’un des bassins les plus peuplés de France, de frontières opérationnelles. Cela garantit l’équité dans la qualité du service rendu, qui est l’un des principes clés de la brigade : que vous fassiez un malaise cardiaque à Choisy-le-Roi, à Épinay-sur-Seine, à Nanterre ou dans le 7e arrondissement, vous avez les mêmes chances de survie. Voilà ce que nous permet la structure interdépartementale.
Elle nous permet aussi, en cas de crise majeure, par exemple en cas d’attaque terroriste, de faire basculer des moyens, donc de conserver une liberté d’action.
Un autre argument au soutien de cette structure interdépartementale est l’argument des coûts, puisque nous avons besoin d’une seule école, d’ailleurs implantée dans le Val-de-Marne.
En termes de résilience, la BSPP compte 76 casernes dans l’agglomération parisienne, c’est-à-dire 76 infrastructures qui peuvent servir autant de points d’appui pour les armées que d’appuis logistiques. Si je prends l’exemple d’une chute de réseau, due à une panne électrique provoquée par une cyber-attaque, par un événement technologique ou par un événement naturel, ces 76 casernes nous permettent de reconstituer du réseau, certes de manière rustique, en nous appuyant sur les réserves et sur les résultats de la formation du citoyen, et d’apporter une réponse, même en mode dégradé, à la gestion du risque courant. De ce point de vue, cette implantation réticulaire constitue un atout exceptionnel.
Rappelons que nous opérons dans une des régions les plus denses en termes de population : un peu plus de 7 millions d’habitants, sur 800 kilomètres carrés, soit à peu près l’échelle de la ville-État de Singapour, mais répartis sur 124 communes. La BSPP est ainsi au contact de 124 maires, ce qui permet de bénéficier d’une expérience très riche. Les élus constituent en effet un capteur sociologique. Parfois, le pompier s’enferme dans sa bulle tactique et technique ; il a donc besoin de ces échanges avec les élus pour mesurer l’évolution sociologique de sa zone d’action.
Dans cette zone, nous comptons aussi 35 millions de touristes par an, chiffre qu’il faudra, d’ici quelques années, multiplier par deux, de même qu’il faudra multiplier par deux les flux de navetteurs, une fois que le Grand Paris Express (GPE) sera en service.
Grâce à notre implantation réticulaire, les sapeurs-pompiers sont parfaitement intégrés dans la cité. En effet, dans les 76 casernes vivent non seulement les sapeurs-pompiers, mais également leurs familles et leurs enfants. Citez-moi un autre service public qui continue à vivre près des Beaudottes, à Aubervilliers, à La Courneuve… Le rapport même à la population est donc autre, même si cela peut poser des problèmes de cadre de vie.
La BSPP met dans ses casernes les cadres plus expérimentés : un chef de centre à La Courneuve ou à Choisy a vingt ans d’expérience derrière lui, de même qu’il a connu deux séjours en zone difficile.
Voilà ce qui explique qu’on arrive encore à tenir le dialogue avec les administrés. À partir du moment où la famille du pompier vit avec lui, il est obligé de comprendre les autres acteurs différemment.
Permettez-moi maintenant de m’attarder sur le sapeur-pompier de Paris en tant que tacticien et technicien des différentes couches, qui vont de la grande hauteur, puisque les trois quarts des immeubles de grande hauteur en France sont sur le secteur de la brigade, jusqu’à la profondeur, c’est-à-dire moins de 20 mètres, et même la très grande profondeur, à moins 50 mètres, ce qui sera le cas avec le Grand Paris Express.
Dans ce dernier environnement, l’enjeu pour la brigade est d’être en mesure de faire face aux risques induits par 200 kilomètres de voies et de galeries souterraines enfouies à moins 50 mètres, avec une cinquantaine de gares. Car la réglementation n’existe pas encore au stade de la construction de chantier ; il faut aussi préparer la réglementation de l’exploitation.
Dans le monde, vous ne trouverez pas de défi d’urbanisme équivalent. Cela implique, pour nous, de s’associer avec les armées dans le domaine de la robotique ou de la communication en grande profondeur.
On développe des partenariats sur des technologies duales : robots mule, techniques d’extinction nouvelles. En apportant une réponse tactique, nous apportons également, du moins je l’espère, un soutien à l’exportation.
Quant à nos projets en cours, qui sont liés au Grand Paris Express et aux Jeux olympiques, ils ont pour enjeux principaux la réglementation incendie et la protection des populations, et ne se limitent pas aux interventions.
Volontairement, j’ai choisi de pas aborder la question du coût comparé entre un sapeur-pompier de Paris et un sapeur-pompier d’un département de province car, pour moi, cela n’a pas de sens.
M. Joaquim Pueyo. Mais si !
Général Jean-Claude Gallet. Pour commencer, il existe une différence de statut et de disponibilité. Gardons-nous donc d’aviver des guerres qui n’ont pas lieu d’être.
À mes yeux, nous devons garder en tête les volumes critiques d’intervention. La BSPP assure 520 000 interventions et défend 7,5 millions d’habitants. Son budget annuel s’élève à 580 millions d’euros, compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions » inclus, ou à seulement 407 millions si l’on s’en tient au budget de fonctionnement et d’investissement (équipements et infrastructures).
J’ai donc choisi de comparer la BSPP à ses équivalents de New York et de Tokyo, qui ne sont pas sous statut militaire, mais qui ont ce même volume d’interventions. Sachons qu’il est très difficile d’effectuer des comparaisons internationales, car le sapeur-pompier de la BSPP incarne deux sauveteurs en un : comme ses camarades civils français, il est à la fois secouriste et soldat du feu, alors que cette chaîne est souvent dissociée dans le reste du monde.
La BSPP est le premier service d’incendie et de secours en Europe, et le troisième dans le monde.
Notre organisation est très classique. Je mettrai seulement l’accent sur quatre fonctions, dont une qui monte en puissance, à savoir le bureau d’études et de prospective (BEP). Il est en effet important pour moi de pouvoir me projeter dans dix ans : que sera alors l’agglomération parisienne, à l’ère de la smart city équipée de nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle ? Quelle sera l’évolution démographique ? Le vieillissement de la population entraînera-t-il une paupérisation ? Je me dois en effet, dans mon champ d’action, d’assurer cette équité dans la qualité de service rendu dont je vous entretenais tout à l’heure. La BSPP participe également à la cohésion nationale, et les choses lui seront peut-être facilitées à cet égard, dans trois ou quatre ans, grâce à l’intelligence artificielle. Je dois en tout cas rester en veille permanente.
J’en viens à la sécurité informatique. Il est clair que la cyberattaque constitue le Blitzkrieg du XXIe siècle. Risquant à tout moment d’être ainsi neutralisée, la BSPP s’appuie sur un fonctionnement reposant sur la redondance des prises d’appels. Nous doublons systématiquement notre communication « stratégique » avec des capacités satellitaires, mais continuons à travailler aussi avec des tableaux blancs, savoir-faire qui s’oublie très vite, notamment dans la jeune génération. Nous voulons éviter d’ajouter du chaos au chaos.
En ce qui concerne la sécurité du travail, je me suis intéressé à la toxicité des fumées, problème que vous avez peut-être rencontré dans les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Certaines fumées sont supposées être cancérigènes. En tant que chef, j’ai sur ce sujet un devoir de transparence vis-à-vis du personnel. Je dois aussi tout faire pour éviter des dommages comme ceux causés par l’amiante.
Dans les SDIS, vous ne connaissez sans doute pas de division de santé comme celle de la BSPP, avec des ambulances de réanimations et de nombreux médecins urgentistes. Nous comptons aussi trois groupements opérationnels qui se répartissent par tiers l’agglomération parisienne. Un groupement regroupe les expertises nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC), les plongeurs et personnels cynotechniques ; il existe également un groupement de soutien et enfin une école.
La gestion des opérations au sein de la brigade repose sur deux principes paradoxaux : d’une part, une forte centralisation des ressources critiques, et une centralisation de la prise d’appels ; d’autre part, une très grande subsidiarité sur le terrain.
Je reprends l’exemple du 13 novembre 2015. Sur le terrain, ceux qui commandent les unités de secours ont aussi bien le niveau de général que le grade de caporal-chef. En termes de leadership et en termes de formation, nous inculquons en effet à nos hommes une très grande autonomie. Ainsi, ceux qui prennent les appels au centre 18/112 sont des militaires du rang, qui ont une expérience opérationnelle assez riche.
En ce qui concerne notre taux d’encadrement, vous trouvez ainsi 4,5 % d’officiers et 20 % de sous-officiers, soit un taux d’encadrement inférieur à 10 % pour l’ensemble de la brigade. Encore ne s’agit-il que d’une moyenne. Dans les unités uniquement opérationnelles, le taux d’encadrement des officiers est de 3 %.
Je vous livre quelques chiffres sur nos 8 500 personnels : 6 700 d’entre eux sont affectés au service d’incendie, 1 800 au service d’appui et de secours, 2 200 qui sont de garde chaque jour.
Pour disposer de la capacité de monter en puissance rapidement sur une crise à cinétique brutale, telle qu’un attentat, une pandémie ou une inondation, la création d’une réserve opérationnelle est importante. Actuellement, la réserve s’élève à près de 400 hommes ; nous serons à 600 dans quelques mois ; l’objectif fixé est d’atteindre les 1 000 en 2024.
Je préfère faire porter l’effort sur la réserve, plutôt que de demander des personnels d’active supplémentaires. Par ce biais, je travaille en effet à améliorer la résilience, l’intégration et la cohésion. Cette réserve est alimentée par les six dispositifs jeunesse que je vais vous détailler tout à l’heure. Pour moi, il y a donc là à la fois un impératif tactique, mais, de manière plus importante, un impératif politique de cohésion, de résilience et d’éducation de la population.
Parmi les principes que j’évoquais, le principe clé est celui de l’équité qui garantit notre cohésion et notre solidarité dans la mise en œuvre dans un plan régalien d’urgence.
À la BSPP – situation particulière – le manageur a la plénitude de tous les moyens. Je suis responsable en termes de marchés publics, en termes de préparation opérationnelle, en termes de doctrine RH, etc.
Sachez que les sous-officiers de la BSPP sont, comme les légionnaires, issus du corps des militaires du rang. On ne recrute pas de sous-officiers directement sortis de l’école ; un jeune sous-officier a en moyenne entre cinq et six ans d’expérience. Ainsi, un chef de centre qui va commander en Seine-Saint-Denis aura déjà vingt années d’expérience. Voilà une garantie de pédagogie comme d’intelligence multiculturelle.
Sur un plan opérationnel, je peux être amené à prendre le commandement d’opérations de secours, mais je suis surtout conseiller auprès du préfet de police, pour qu’il puisse connaître les implications en termes de communication politique. Il s’agit souvent de donner une indication de temps : « Monsieur le préfet, cette intervention va prendre une heure, une heure et demie » ; « Monsieur le préfet, nous avons été frappés sur cinq sites, c’est une action terroriste ; quatre vont pouvoir être évacués, mais la situation sur le cinquième point est un peu plus compliquée, parce qu’il y a un volume important de victimes et parce que la menace pas réduite »…
Ces éléments permettent aux politiques de bâtir une communication opérationnelle en direction de la Nation, bien sûr, mais surtout en direction de ceux qui nous ont frappés. Cela montre à ces derniers que nous sommes préparés en amont et que nous ne sommes pas un ventre mou.
J’en viens à l’écosystème. La brigade travaille en concertation avec la préfecture de police, le militaire, la sécurité civile, nos camarades de la fédération, le service d’aide médicale urgente (SAMU) et les services hospitaliers. Si la concertation n’était pas mon fil directeur, je n’y arriverais pas. Dans le fameux continuum sécurité-défense, qui regroupe à la fois des forces de sécurité intérieure et des forces militaires, de nombreux acteurs privés et experts interviennent aussi. Si on arrive à se faire entendre de cet écosystème et à l’écouter, il est très riche d’enseignements, en termes de doctrine, pour préparer l’engagement de forces armées sur le théâtre national, notamment en cas de catastrophe naturelle. Dans cette hypothèse, ce sont en effet les armées qui mettraient à disposition le plus de capacités mais elles n’auraient pas le commandement.
L’activité opérationnelle est un point de très grande fragilité pour la BSPP. En 2017, nous avons fait 503 000 interventions. Or, la brigade est conçue et organisée pour en traiter 450 000 au grand maximum. Ces interventions, dont le nombre progresse de 5 % par an, concernent principalement le secours à personne. Dans le Nord-Est parisien, marqué par la paupérisation, le vieillissement de la population et la défaillance de la médecine de ville et des maisons de santé, la population se tourne vers les sapeurs-pompiers car le service est gratuit, efficace et anonyme. Or, comment conserver une capacité d’intervention dans un contexte de suractivité, pour garantir l’équité et la qualité du service rendu, la cohésion sociale et gérer 100 000 interventions non urgentes, correspondant à une détresse sociale ou psychologique légère ?
Il y a deux solutions possibles : soit je demande des effectifs et des casernes supplémentaires – et je passe à côté de la nécessaire réforme de fond liée à l’évolution de l’agglomération parisienne à l’horizon de 2030 –, soit j’arrive à réorienter vers d’autres acteurs les 100 000 interventions qui ne relèvent pas de ma mission régalienne. Sur ces 503 000 interventions, seules 70 000 relèvent véritablement de l’urgence, qui nous conduisent à sauver à peu près 28 000 vies au titre des risques liés aux accidents domestiques. Tout l’enjeu de la discussion en cours – dans laquelle nous sommes appuyés par le préfet de police et par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) – est de savoir comment arriver à réguler ces interventions qui correspondent à une inquiétude de nos concitoyens et qui répondent à la disparition progressive de la médecine de ville. Cette disparition est d’ailleurs un enjeu national que l’on retrouve dans les déserts médicaux ruraux. Le système est à bout de souffle. Or, je tiens vraiment à préserver l’équité et la qualité du service rendu. Je me suis donné un an pour susciter une prise de conscience collective qui permettra de résoudre le problème.
Je ferai un point sur les feux, la lutte contre les incendies étant la première de nos missions. La brigade est confrontée à 14 000 incendies par an, soit à 30 à 40 feux par jour. Nous activons notre centre opérationnel une à deux fois par jour pour des feux majeurs. Nous avons à déplorer entre vingt-cinq et trente victimes chaque année et sauvons 150 vies par an dans des feux : c’est là que les pompiers prennent le plus de risques. La lutte contre les incendies a entraîné cette année un mort, huit blessés très graves et 163 blessés sérieux au sein de la brigade. Le sapeur-pompier, comme ses camarades civils, met vraiment sa peau au service de son idéal.
Quelle pourrait être la place de la brigade dans le continuum de sécurité-défense ? Si la BSPP présente des atouts, c’est que nous sommes non seulement un acteur mais aussi un capteur au sein de la cité. Nous dialoguons avec les élus. Nous sommes au fait des réalités humaines et socioéconomiques et de l’évolution du secteur. Comme nous travaillons en amont sur des projets de grande prévention, nous voyons arriver les mutations urbaines. Non seulement le Grand Paris Express est une révolution dans les transports, donc dans les flux d’usagers, mais, surtout, il va créer de nouveaux points de concentration de population. Ces phénomènes seront accentués par le vieillissement démographique. Paris accueille en outre de nombreux événements internationaux de grande ampleur, comme l’ont été la Conférence de Paris sur le climat (COP21), l’Euro 2016 de football, le centenaire du 11 novembre 1918, ou comme le seront les Jeux olympiques de 2024. Cela a changé la donne du dispositif de prévention et de sécurité. Depuis trois ans, avec la problématique terroriste, nous avons complètement changé de mode opératoire. Nous sommes au fait de l’évolution de la doctrine et servons d’interface entre les forces de police et les forces militaires de Sentinelle. Chaque fois qu’il y a une relève, ces forces viennent naturellement se faire « briefer » au poste de commandement de la brigade.
La brigade est aussi ouverte à l’international : nous essayons de voir ce qui se fait de mieux dans la gestion des risques et des catastrophes naturelles et technologiques –. Nous étudions l’évolution de la ville-État de Singapour qui devrait correspondre à l’évolution naturelle de Paris. Nous faisons une synthèse à la fois en tant qu’acteurs, que capteurs et que veilleurs. Nous traduisons ensuite cette synthèse en termes de doctrine, via le commandement du territoire national qui alimente ensuite toutes les structures de doctrine des armées.
J’ai déjà évoqué le travail interservices. Travaillant avec une trentaine d’acteurs, nous devons être capables de nous faire entendre, d’entendre les autres et d’avoir une manœuvre combinée, sachant que chacun a des seuils critiques et des tempos différents dans la manœuvre. C’est un savoir-faire que nous défendons au sein du continuum sécurité-défense.
Nous sommes aussi acteurs de la résilience sociétale. La brigade recrute 1 200 jeunes par an et forme aussi 1 200 jeunes de onze à vingt-cinq ans grâce à six dispositifs. À onze ans, il y a le dispositif « école ouverte » qui, dans les cités dites sensibles, consiste à former les jeunes pendant une semaine à l’apprentissage des risques domestiques. Dans le cadre du dispositif « bac pro », la brigade est conventionnée avec neuf lycées pour 317 lycéens, ce qui nous permet de recruter des jeunes dans la réserve, sachant qu’on n’entre pas dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris par concours, mais à la suite de tests physiques et psychologiques, après vérification du casier judiciaire. Nous offrons ainsi une chance aux jeunes des cités – le plus dur étant de leur faire passer l’information et d’être attractifs. Il y a ensuite le service civique : 250 jeunes servent en tant qu’équipiers après une formation de douze semaines. Dans les engins, on place souvent un jeune effectuant son service civique auprès de chaque équipage de personnels de l’active. À l’issue de leur service, ces jeunes peuvent rejoindre la brigade en réserve opérationnelle ou s’engager. Les jeunes sapeurs-pompiers font un cursus certifiant de trois ans. C’est un outil de mixité sociale très important : s’il y a beaucoup d’enfants de pompiers, il y a également des jeunes issus de banlieues défavorisées. Grâce à ce dispositif, nous avons pu aider une jeune femme à intégrer St Cyr et un jeune homme l’Institut d’études politiques de Paris. Je suis bien conscient que ce sont des cas particuliers et que cela reste insuffisant mais j’apporte quand même ma pierre à l’édifice. Enfin, il y a le dispositif des « cadets de la sécurité civile », en petite couronne. Enfin, en plus du dispositif « jeunesse », nous formons aussi aux « gestes qui sauvent » – 14 000 personnes ayant été formées depuis les attentats –, ce qui nous permet de conserver le lien avec la population. En effet, les casernes de pompiers sont parfois un peu « bunkérisées » alors qu’auparavant elles étaient ouvertes sur le monde
Nous cherchons à recruter en région parisienne, car 70 % des sapeurs-pompiers de Paris sont d’origine provinciale. En outre, il faut alimenter nos réserves pour avoir ces 1 000 jeunes en 2024, leur donner un projet de vie et donner un sens à leur engagement. Au lendemain des attentats, les jeunes ont eu la volonté très forte de s’engager mais ont également été frustrés car ils ne connaissaient pas forcément les dispositifs idoines. Nous continuons donc à faire passer l’information. La brigade est perçue comme une unité d’élite et il est vrai qu’on a entretenu cette image. Cependant, nous restons une unité ouverte sur la société, qu’on peut rejoindre en tant que réserviste.
J’en viens aux points de vigilance. Comme vous l’aurez compris, le modèle a été conçu pour 450 000 interventions. Or, nous en avons fait 503 000 l’année dernière et nous en ferons 520 000 cette année. Comme je ne veux pas demander plus d’effectifs et d’infrastructures, l’enjeu est de réorienter les interventions qui ne relèvent pas de l’urgence. Nous avons donc entamé un dialogue, avec l’appui du préfet de police, avec l’agence régionale de santé. Nous menons aussi quatre actions avec les réseaux sociaux solidaires de Paris pour renforcer le lien social avec des entités comme « Hyper Voisins ». Lors de la petite canicule de cette année, par exemple, nous avons incité les gens à prendre soin des personnes âgées, à développer la solidarité, à apprendre les gestes qui sauvent et à n’appeler les pompiers qu’en cas de réelle urgence.
Si je dois recruter 1 200 jeunes par an, contre 700 auparavant, c’est que les personnels, travaillant à un rythme très soutenu, ne renouvellent pas leur contrat. Un engin comme le véhicule de secours et d’aide aux victimes (VSAV) peut être dehors pendant quinze à seize heures sur vingt-quatre, et notre rythme de garde suit une séquence de quarante-huit heures. Vous imaginez la pression qui peut peser sur les épaules de ces jeunes. Si les interventions sont motivées, il n’y a pas de problème. En revanche, si une intervention sur quatre relève du social et n’a pas pour objet un acte salvateur alors qu’on demande aux sapeurs-pompiers de s’entraîner dur, en complément de leurs interventions, en sport et en manœuvre, ils perdent leur motivation.
Autre facteur de démotivation, qui concerne toute la France, il y a une agression par jour en moyenne. En augmentation de 50 % par rapport à l’année dernière, les agressions ne sont pas que des incivilités liées aux cités sensibles : elles sont aussi provoquées par l’alcoolisme et il y a autant d’agressions dans Paris intra muros qu’en Seine-Saint-Denis. Il y a aussi un phénomène nouveau : les agressions provoquées par des victimes qui sont en détresse psychologique. Nous avons donc développé des protocoles avec la police et des échanges d’information avec le SAMU. Il faut par ailleurs que nous revoyions nos cursus de formation. Il est hors de question d’armer les sapeurs-pompiers, même d’un taser. Nous avons suffisamment de leviers, y compris sur le plan juridique : une majorité de plaintes étant classées sans suite, nous avons une marge de progrès. Il faut essayer de sanctuariser le rôle du sauveteur – qui n’est pas un policier. Si le policier est chargé de réguler la violence, le pompier, lui, n’est pas formé pour se protéger individuellement puisqu’il est dans l’environnement immédiat de la victime. Si la victime présente des troubles psychologiques, elle peut vivre comme une intrusion le fait qu’on soit dans son environnement immédiat – chose que le sauveteur ne comprend pas. J’ai la responsabilité morale de former mes cadres à ce type d’interventions – dont le nombre explose –, et de développer l’interopérabilité. Si vous avez l’occasion de venir à Champerret, vous verrez que la plateforme d’appels unique regroupe pompiers et policiers pour l’ensemble de l’agglomération parisienne, conformément à une volonté forte du préfet de police. Cela permet un échange d’informations. Reste à développer ce type d’interopérabilité avec les quatre SAMU départementaux. Enfin, il faut peut-être prévoir un mode de protection des pompiers mais je ne suis pas très favorable à ce qu’ils portent des gilets car ce n’est pas aux pompiers de s’adapter, autrement il y aura une confusion entre les missions des uns et des autres. On peut porter ce type de gilets en cas d’attaques terroristes mais pas lors d’interventions relevant du risque courant.
En conclusion, la brigade est une unité militaire située à la confluence de différentes expertises. Elle a non seulement un devoir d’excellence tactique mais également d’éducation des populations, d’intégration et de cohésion des plus jeunes. Nous mettons notre savoir-faire à disposition des forces armées dans le cadre du continuum sécurité-défense pour être en mesure de faire face à des crises majeures.
M. le président. Je vous remercie, Mon général, pour cet exposé détaillé. Nous en venons aux questions de nos collègues.
M. Charles de la Verpillière. Je vous confirme qu’une partie des problèmes que vous rencontrez se retrouve dans les SDIS. Les pompiers sont en effet le réceptacle d’absolument tous les appels d’urgence, quels qu’ils soient, sans que ce soit forcément justifié. Je pense notamment au transport et aux urgences sanitaires.
Les sapeurs-pompiers de Paris sont des militaires et vous nous dites qu’ils dépendent du COM TN. Y a-t-il une mobilité interarmes avec les autres unités de l’armée de terre, comme le génie, ou est-on sapeur-pompier toute sa carrière ?
M. Christophe Blanchet. Mon général, nous nous étions rencontrés lors d’auditions sur le service national universel (SNU). Le projet qui est en train de voir le jour répond-il à vos attentes ? Vous étiez demandeur de ce service universel dans une optique d’inclusion des jeunes et aviez indiqué qu’il pouvait constituer un vivier pour les sapeurs-pompiers.
Comme bon nombre d’entre nous, j’ai été, il y a six mois dans ma circonscription, en immersion pendant vingt-quatre heures avec les pompiers, en caserne et sur le terrain. Je voudrais donc revenir sur deux des problèmes que vous avez soulevés. Le premier est celui des missions de taxi que les pompiers effectuent pour les personnes souhaitant aller chez le médecin ou aux urgences. De même, les missions liées à l’état d’ébriété d’une personne ne sont pas non plus dans le champ de l’urgence. Quelles sont vos préconisations à cet égard ? D’autre part, nous nous sommes rencontrés à Paris lors d’un salon au cours duquel vous m’avez montré un logiciel fournissant les plans en trois dimensions (3D) des immeubles, plans qui vous permettent d’agir beaucoup plus vite et plus efficacement en cas de feu. Vous avez alors suggéré l’idée que les architectes vous fournissent ces plans en 3D pour tous les bâtiments neufs : cette réflexion a-t-elle été suivie d’effet ?
Mme Patricia Mirallès. Lors de votre audition de l’an passé, général, l’idée avait été émise de faciliter la généralisation d’un suivi des blessés par code-barres, tel que le système d’information numérique standardisé (SINUS). Avez-vous une idée du coût du système à l’échelle de la BSPP afin que nous puissions évaluer notre capacité à le transposer dans d’autres corps ? L’utilisation de ce système entraîne-t-elle d’autres problèmes que ceux de nature budgétaire ?
M. Yannick Favennec Becot. Mon général, j’aimerais vous interroger sur l’organisation des secours en milieu rural même si elle ne dépend pas directement de vous : 194 000 sapeurs-pompiers volontaires ont, aux côtés de leurs 41 000 collègues professionnels et des 12 000 militaires, un rôle irremplaçable dans les territoires pour assurer une répartition équitable des secours quotidiens de proximité. Ils sont en outre la seule force disponible pour assurer une levée en masse en cas de catastrophe dans le cadre de la solidarité nationale. Si ce modèle d’organisation a fait ses preuves, il est aujourd’hui menacé par la directive européenne sur l’aménagement du temps de travail qui impose onze heures de repos quotidien. Cette directive, si elle devait être appliquée, remettrait en question de fond en comble la loi française selon laquelle l’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres, ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui étant applicable. Si on devait transformer nos sapeurs-pompiers volontaires en sapeurs-pompiers professionnels, c’est la philosophie même de l’engagement altruiste de nos sapeurs-pompiers volontaires qui serait remise en cause et, d’autre part, il en coûterait près de 3 milliards d’euros à nos finances publiques. Qu’en pensez-vous ?
M. Jean-Pierre Cubertafon. Ma question rejoint celle de mon collègue. Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont des piliers de la stabilité et de la sécurité. Dans les milieux ruraux, tels que mon département, les sapeurs-pompiers sont majoritaires et au plus près de la population. Cependant, les recrutements sont de plus en plus difficiles. Le Gouvernement a proposé plusieurs pistes. Quel est votre avis sur ce sujet ? Quelle spécificité des sapeurs-pompiers de Paris pourrait-elle être appliquée aux autres pompiers de France pour améliorer leur efficacité et leur disponibilité ?
M. Joaquim Pueyo. Mon général, c’est moi qui vous ai interpellé tout à l’heure quand vous avez dit qu’il ne fallait pas comparer les coûts. Il me semble en effet que les sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas suffisamment rémunérés, compte tenu de leurs qualités, des services qu’ils rendent et de leur disponibilité. En outre, comme vous l’avez dit, 70 % des sapeurs-pompiers viennent de province et la plupart d’entre eux font des allers-retours entre leur lieu de travail et leur famille. Je vous prie de m’excuser de vous avoir interrompu et ne vous demande pas de me répondre : c’est mon sentiment, pour avoir discuté avec beaucoup de pompiers. Les Parisiens ont la chance que beaucoup de jeunes provinciaux viennent leur porter secours. Je veux donc féliciter la brigade des sapeurs-pompiers.
Lors de la dernière législature, j’ai interrogé votre prédécesseur sur la reconversion des personnels et il m’a donné des réponses classiques. Je voudrais aller plus loin. Lorsqu’un sapeur-pompier sert la Nation à Paris pendant cinq à dix ans, ne pourrait-il pas être mis directement sur la liste d’aptitude pour être pompier professionnel plutôt que de devoir faire, comme aujourd’hui, pour y parvenir, un parcours du combattant ?
M. André Chassaigne. La directive européenne 2003/88/CE sur l’aménagement du temps de travail (DETT) a donné lieu à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne le 21 février 2008 qui limite les dérogations à cette directive. Qu’en est-il de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ? Si la directive lui était appliquée comme elle l’est aux sapeurs-pompiers allemands et aux gendarmes, cela exigerait des recrutements supplémentaires alors que, sur 8 500 pompiers, vous en recrutez 1 200 par an, ce qui me paraît déjà énorme. Or, il me semble que vous n’avez pas de financement des départements et des communes comme les SDIS : pourriez-vous nous éclairer sur cette question budgétaire ?
M. Bastien Lachaud. Ma question portera spécifiquement sur la Seine-Saint-Denis. J’ai visité les différentes casernes de ma circonscription. À chaque fois, le constat est le même : les interventions connaissent une augmentation plus importante que celle de la population. Comment analysez-vous cette évolution ? Les pompiers que j’ai rencontrés m’ont parlé des conséquences de la précarité grandissante des populations de ce département. Les questions de mal-logement jouent-elles également ? Le rapport de notre collègue Cornut-Gentille a démontré une sous-estimation de la population liée à un mauvais recensement dans le département. Comment comptez-vous faire face dans les années qui viennent à ces problématiques particulières à la Seine-Saint-Denis ?
Général Jean-Claude Gallet. La mobilité des cadres de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en direction de l’armée de terre ne concerne ni les militaires du rang ni les sous-officiers, qui sont engagés au titre de la brigade et qui font l’ensemble de leur cursus au sein de l’institution BSPP. Les seuls à effectuer cette mobilité sont les officiers. À la brigade, 50 % des officiers sont recrutés directement aux écoles de Coëtquidan, les autres sont issus de nos rangs, ce qui est intéressant sur le plan de la promotion sociale et de la valorisation des compétences. Cette mobilité ne concerne que les saint-cyriens, les officiers issus de l’école militaire interarmes et quelques officiers servant sous contrat. En général, un officier rejoint la BSPP à la sortie d’école, y effectue sept ans puis repart dans des unités comme le COM-TN pour obtenir son diplôme d’état-major et faire son cursus d’école de guerre ou un diplôme technique. C’est à ce moment-là que nous avons un échange d’informations.
Concernant le service national universel, la BSPP forme 1 200 jeunes par an. Ces actions de formation, notamment celle des volontaires du service civique, pourraient être labellisées au titre du service national universel. Le secrétaire d’État Gabriel Attal va nous présenter les grandes lignes de son projet qui devrait être lancé dès l’année 2019. Nous sommes effectivement preneurs car nous participons à la résilience des populations et ce service universel alimente le recrutement. La force de la brigade est que 70 % de provinciaux défendent Paris. Sa faiblesse est que les sapeurs-pompiers de la brigade sont à la fois sapeurs-pompiers militaires et sapeurs-pompiers volontaires auprès des SDIS : en cas de crise nationale, de pandémie ou d’événement naturel, je ne suis pas sûr que le sapeur-pompier de Paris qui est dans son département remontera dans la capitale, car il sera déjà employé pour la gestion de crise. C’est pourquoi le SNU nous intéresse. Notre problème est que nous n’avons pas de ressources suffisantes pour faire 520 000 interventions au lieu des 450 000 prévues. Par ailleurs, notre mode de fonctionnement est pragmatique. Mes cadres font à peu près 120 gardes de vingt-quatre heures par an et vingt gardes de douze heures. Le reste du temps, ils sont au repos. Il est toléré, pendant ce temps de repos, qu’ils fassent des actions de formation en tant que moniteurs de secourisme. Cela permet de démultiplier en masse les actions de formation de secouriste dans l’agglomération parisienne.
Nous allons, j’espère, basculer du fort de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, sur la base de Limeil-Brévannes-Valenton, pour avoir enfin une école digne de ce nom. Il pourrait être envisagé de poursuivre les actions de la brigade au profit de la population à travers le foncier de Villeneuve-Saint-Georges que nous libérerons. Nous contribuons donc en plus à une stratégie de développement du territoire.
Quant au logiciel 3D, il est intéressant non seulement pour les feux mais également pour les forces de police en cas d’action terroriste. Le législateur ne s’est pas encore emparé de la question. Pour l’instant, il s’agit uniquement d’une démarche commerciale. Nous incitons les futurs grands sites à se doter de ce type d’appareil qui nous fait gagner du temps en minutes d’intervention.
Non seulement l’ébriété ne relève clairement pas du champ de l’urgence mais c’est la première source d’agression des sapeurs-pompiers. Je vais proposer aux élus de la plaque parisienne des solutions, mais ne m’en veuillez pas de ne pas vous les exposer : je préfère les évoquer d’abord avec eux la semaine prochaine lors de la commission consultative de gestion du budget de la BSPP. C’est un enjeu national et cela rejoint votre question sur les taxis. Une heure de VSAV coûte 250 euros à la BSPP. Un taxi coûte 50 euros. La solution est en passe d’être trouvée grâce à l’action conjointe du préfet de police et du directeur de l’ARS pour instituer un coordinateur de gestion des transports non médicalisés. Parfois, on appelle les pompiers en raison d’une carence d’ambulances : c’est problématique pour la brigade car cela représente des milliers d’interventions supplémentaires, mais ça l’est encore plus dans les départements ruraux où un VSAV qui part effectuer un transport sera indisponible pendant trois ou quatre heures. La solution qui sera mise en place à Paris – très rapidement, je pense – servira d’expérimentation pour le reste du territoire.
SINUS est le bracelet apposé sur chaque victime lors d’un attentat ou d’une catastrophe. Nous l’apposons systématiquement dès qu’une intervention dépasse cinq victimes, pour entraîner les personnels. J’évoquais tout à l’heure la relation de confiance entre l’État et le citoyen. Si on n’assure pas la traçabilité de la victime et qu’il y a confusion d’identité entre personnes décédées et survivantes, cela aboutit à des drames. C’est ce qui s’est passé le 13 novembre 2015. Le dispositif SINUS n’est pas très onéreux : chaque bracelet coûte environ un euro et le coût de formation en interne et en équipement n’est pas significatif. Le problème, c’est l’interopérabilité avec le système d’information des hôpitaux. Il faut que ces derniers utilisent le même dispositif ou permettre à leur SI (SIVIC) d’être compatible car si on incrémente une base et qu’on redémarre à zéro une fois que la victime arrive à l’hôpital, on perd du temps.
Plusieurs d’entre vous m’ont interrogé sur la directive européenne concernant le temps de travail. Je m’efforcerai de faire une réponse globale. Si la DETT était appliquée à la brigade, cela nécessiterait de recruter 35 % de personnes en plus – par rapport aux 8 500 membres de la brigade, s’entend, et aux 1 200 personnes que nous recrutons chaque année. Actuellement, le régime est de 120 gardes par an. Avec la DETT, chaque sapeur-pompier de Paris en ferait 102, ce qui entraînerait un recrutement supplémentaire de 35 % environ. Dans ces conditions, le modèle militaire n’aurait plus de sens.
Ma position personnelle, pour ce qui est de la BSPP, est donc non pas une dérogation, mais bien une exclusion du champ de la directive. En effet, comme vous l’aurez compris, je suis très attentif à ce que le personnel ne soit pas sur-sollicité, pour éviter une déshumanisation des interventions : au-delà d’un certain niveau, on entre dans un processus industriel. J’ai donc intérêt à ce que les membres de la brigade fassent moins de dix interventions par jour, pour que cela reste humainement possible, pour éviter qu’ils soient usés, qu’ils deviennent aigris, qu’ils soient victimes de burn-out ou qu’ils perdent leur faculté de compréhension de l’autre.
Heureusement, les sapeurs-pompiers de Paris sont jeunes et ne servent chez nous qu’un temps limité : 80 % sont en contrat à durée déterminée (CDD) – ou l’équivalent du CDD, sous statut militaire. Le personnel tourne donc beaucoup. La fonction est physiquement exigeante : j’évoquais tout à l’heure les feux, pour lesquels il y a ce que l’on appelle l’« échelle à crochets ». Ce qu’a fait le jeune Mamoudou Gassama à mains nues, nous le faisons avec une échelle à crochets, de balcon en balcon, sur des façades inaccessibles. Nous nous entraînons pendant des heures et des heures, en défiant les lois de la gravité – ce qui explique aussi l’exercice de la planche à rétablissement. Cela découle du tissu urbain auquel nous sommes confrontés, que l’on rencontre aussi dans certains quartiers de Lyon ou de Lille, mais pas dans le reste de la France. Voilà pourquoi les pompiers de la brigade sont jeunes.
L’objectif est de trouver un partenariat « gagnant-gagnant » : la brigade a besoin de jeunes, et ceux-ci acquièrent des compétences et de l’expérience à Paris. Ils peuvent ensuite trouver une voie de reconversion dans ce qui constitue leur premier métier, à savoir sapeurs-pompiers, quand ils retournent dans leur département d’origine. D’ailleurs, pour 40 % environ, ils étaient déjà sapeurs-pompiers volontaires avant d’intégrer la brigade. Or ce partenariat gagnant-gagnant n’est pas du tout acté – selon moi, pour de mauvaises raisons.
Quoi qu’il en soit, l’application de la DETT serait la fin du modèle militaire pour la BSPP. La directive serait plutôt compatible avec le modèle de la fonction publique territoriale. On ne peut pas recruter des gens avec des petits salaires et les faire venir à Paris s’ils ne bénéficient pas, notamment, du tarif réduit à la SNCF pour leurs allers-retours. C’est un autre modèle, qui est tout à fait louable mais qui mettrait du temps à monter en puissance. Pour ce qui est de l’application de la directive à mes camarades pompiers volontaires, je ne saurais décemment me prononcer. Cela dit, je comprends très bien les difficultés qu’elle peut entraîner.
M. Yannick Favennec Becot. Cela démultiplie les difficultés.
Général Jean-Claude Gallet. En effet. Ce n’est pas que je fuie la question, mais il est difficile pour moi d’émettre un avis sur l’opportunité d’appliquer la DETT. D’ores et déjà, je sors du bois en disant que, selon moi, appliquée à la BSPP, elle signifierait la fin du modèle actuel – mais, en tant que commandant de la brigade, j’assume ces propos. Ce serait peut-être le prolongement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais avec un autre statut, dans le cadre d’un autre modèle, qui ne serait pas militaire.
L’un d’entre vous a évoqué les rémunérations : elles sont calquées sur la grille des fonctionnaires, à ceci près que les pompiers de la BSPP travaillent tout de même 70 heures par semaine – pas en permanence, il est vrai. Le problème tient davantage à la baisse du pouvoir d’achat. Cela explique aussi la concomitance des activités de sapeur-pompier militaire et de sapeur-pompier volontaire : là, on y trouve son compte, d’autant que l’on bénéficie de l’entraînement et de l’expérience que fournit la brigade.
S’agissant du service national universel, et pour vous dire les choses franchement, tant que tout n’a pas été clarifié, tant que les limites n’ont pas été fixées, je suis prudent pour ce qui est de m’engager dans le dispositif. Si l’on autorisait des cadres et des militaires du rang à être moniteurs pendant leurs journées de repos dans un cadre associatif, moyennant rémunération, on réglerait le problème du pouvoir d’achat tout en éduquant la population. Ce serait là une solution très pragmatique.
En ce qui concerne la reconversion, je trouve dommage, effectivement, qu’elle soit difficile. C’est d’autant plus dommage qu’il existe des dispositifs, qualifiés par certains de « martingales » : dans le cadre de conventions avec des SDIS, on s’engage à mettre de nouveau à disposition un jeune sapeur-pompier de Paris au bout de sept ans. Toutefois, nous ne pouvons rien faire si, à ce moment-là, le SDIS ne recrute pas la personne en question. Je suis évidemment preneur de telles solutions de reconversion. J’irai même au-delà en faisant remarquer que, si nous recrutons 1 200 jeunes par an, cela signifie que nous remettons à disposition, dans la vie civile, 1 200 sapeurs-pompiers de Paris – et pas uniquement d’ailleurs des jeunes : il y a aussi des cadres.
Certains continuent comme sapeurs-pompiers volontaires, mais ce que je souhaite, comme je le disais, c’est développer une réserve opérationnelle, car les anciens pompiers ont un savoir-faire utile dans les départements, en cas de crise. C’est un système que nous sommes en train de mettre en place, pour que ces compétences ne se perdent pas. De même, nos anciens pompiers peuvent participer à des dispositifs du type « école ouverte », comme c’est le cas par exemple en Seine-Saint-Denis, département qui en est le principal bénéficiaire. Des personnes de cinquante ans ayant derrière elles trente ans de service opérationnel dans des unités de lutte contre les incendies ont des choses à apporter sur le plan pédagogique.
Pour ce qui est du blocage du recrutement sur liste d’aptitude, j’en suis le premier désolé, parce que je m’aperçois qu’on trahit nos personnels. De surcroît, étant donné leur haute valeur ajoutée, en termes de compétences, c’est vraiment dommage.
M. Joaquim Pueyo. Nous devons faire une loi !
Général Jean-Claude Gallet. Ce sont 1 440 sapeurs-pompiers de Paris qui ont passé le concours de sapeur-pompier professionnel en 2018. Je dois réussir à rehausser leur pouvoir d’achat, à rendre le métier un peu plus attractif, notamment en supprimant les 100 000 interventions qui ne relèvent pas de notre domaine, c’est-à-dire de l’urgence. Je me suis donné un an pour y parvenir par un travail collectif en interministériel ; j’y crois.
La Seine-Saint-Denis fait l’objet de toute notre attention. Je crois, d’ailleurs, que vous avez visité les casernes de Pantin et d’Aubervilliers. Ce qui est en cause, ce n’est pas tant le nombre d’habitants que les difficultés qu’on y rencontre, et que vous connaissez très bien – j’ai deux élus du département en face de moi. Il y a à la fois des zones comme la Plaine Saint-Denis, qui est une sorte de Silicon Valley à la française, et des quartiers, à Aubervilliers ou à Pantin – par exemple les Courtillières –, qui vieillissent mal, où l’habitat est délabré – je pense aux immeubles dits de « quatrième famille », qui ont quarante ans.
Nous menons des actions de prévention ; la préfecture essaie aussi, en concertation avec les élus – notamment les maires –, d’apporter des réponses. En ce qui me concerne, je ne dispose pas d’un cadre coercitif : nous menons des actions de recrutement, auxquelles je suis très sensible. Nous essayons, en particulier, de recruter dans les clubs sportifs. De plus, c’est en Seine-Saint-Denis que nous allons ouvrir le plus grand nombre de classes de jeunes sapeurs-pompiers. Je connais bien ce département où j’ai servi pendant les trois quarts de ma carrière. Pour moi, il s’agit du principal point d’application des efforts, au regard de l’enjeu politique que j’ai évoqué dans mon propos liminaire.
M. Jean-Marie Fiévet. Mon général, je vous remercie de votre présence parmi nous. Depuis plusieurs années, le renouvellement des premiers contrats est en forte diminution. Les chiffres, au bout de six mois, montrent une déperdition de 30 % du nombre d’engagés. Or le nombre d’interventions augmente chaque année. De bons éléments, repérés durant leur formation de quatre mois à Villeneuve-Saint-Georges, sont, par la suite, déstabilisés par la rigueur de la vie en caserne et l’ambiance qui y règne ; ils quittent la brigade. Je connais votre préoccupation en la matière, puisque vous avez mis en place un contrat d’un an, ce qui permet un engagement moins long que le contrat de cinq ans proposé jusque-là. Quelles sont les nouvelles pistes que vous explorez pour enrayer la diminution du nombre d’engagés ?
M. Alexis Corbière. Comme vous le savez, en janvier 2018, le responsable « risques-aménagement » en Île-de-France, M. Ludovic Faytre, expliquait que la crue centennale de la Seine aurait bien lieu, sans que les outils existants puissent évidemment en déterminer la date précise. Ma question est la suivante : considérez-vous que les sapeurs-pompiers de Paris sont suffisamment préparés à une crue centennale ? Si des manques existent, quels sont-ils ? Quels dispositifs votre brigade a-t-elle prévus en matière de prévention, mais aussi de réaction rapide au cas où la crue se produirait ? Une harmonisation des efforts d’anticipation des différents acteurs de la prévention est-elle envisagée ?
Mme Nicole Trisse. Ma question concerne l’une des images que vous avez projetées tout à l’heure et qui m’interpelle fortement, à savoir la comparaison du nombre d’appels à Paris, New York et Tokyo. Sachant que Paris a deux fois moins d’habitants que les deux autres villes, comment expliquez-vous la situation ? J’ai noté que nous enregistrons 2,6 millions d’appels à Paris, contre 2,3 millions à New York et 2 millions à Tokyo. Nos compatriotes sont-ils d’incorrigibles anxieux, ou bien est-ce l’urbanisme parisien qui est particulièrement dangereux ?
Mme Laurence Trastour-Isnart. Je voudrais commencer par saluer le professionnalisme et l’implication de nos sapeurs-pompiers, et par souligner les risques qu’ils prennent tous les jours.
Ma question porte sur la place des femmes parmi les sapeurs-pompiers de Paris ; elles représentent 3 % des effectifs. Je voudrais savoir quels dispositifs ont été mis en place pour développer le recrutement des femmes, étant donné que la ministre Florence Parly souhaite une féminisation de nos armées. Par ailleurs, comment avez-vous réglé les difficultés que vous avez rencontrées en matière de harcèlement et de violences envers les femmes – violences que je qualifierais d’ordinaires dans un milieu très masculin ?
Mme Anissa Khedher. Avant de devenir députée, j’ai été infirmière puis cadre de santé. À ce titre, je m’intéresse à la question des blessés. Les sapeurs-pompiers de Paris, comme on le sait, ont la particularité d’être militaires. Ma question concerne la prise en charge des pompiers blessés et de leur famille. Quels sont les moyens alloués à ces soldats du feu qui ont payé cher leur engagement ? L’accompagnement est-il suffisant ? Quels sont les retours directs que vous avez eus, sur ce point, de la part de ces hommes et de ces femmes blessés ? Enfin, quelles sont les mesures prises pour renforcer encore la sécurité de nos pompiers lors des interventions périlleuses, notamment en termes de matériel et de technologie ?
M. Jean-Philippe Ardouin. Le sujet sur lequel je souhaitais vous interroger a déjà été en partie abordé : il s’agit de la spécificité française que constituent les sapeurs-pompiers volontaires. Si la directive européenne de 2003, qui a été évoquée, venait à s’appliquer, quels moyens pourriez-vous mettre en œuvre pour protéger et valoriser cette exception française ?
M. Patrice Verchère. Nous venons de commémorer les événements du 13 novembre. Quel a été, pour vous, le retour d’expérience ? Qu’aviez-vous imaginé avant – car je sais que vous aviez été formés à de tels risques –, et quels changements ont-ils entraînés pour vous, notamment en termes de formation, d’intervention et de coordination ? Qu’est-ce qui pourra être amélioré ? Quels éléments avez-vous pris en compte ?
Général Jean-Claude Gallet. En ce qui concerne le renouvellement du premier contrat, je me permets de faire un rectificatif : on ne peut pas dire que le taux se détériore depuis des années. Il était de 87 % il y a encore peu de temps, même s’il est vrai qu’il s’élève désormais à 53 %.
Le phénomène d’« attrition », qui se caractérise par la dénonciation du contrat dans les premiers mois, a deux explications. La première tient à la découverte d’un environnement marqué par la sur-sollicitation, avec des missions qui n’ont pas toujours de sens – ce sont les 100 000 interventions inutiles que j’évoquais. La seconde explication – et c’est pour cela que j’ai parlé du risque de déshumanisation du sapeur-pompier s’il est soumis à de fortes contraintes opérationnelles – a trait à l’accueil des plus jeunes.
Nous faisons des efforts dans ce sens. Nous devons montrer que, précisément en vertu de la camaraderie et de la cohésion, qui constituent notre marque de fabrique et sont les garantes de notre efficience, certains schémas sont éculés et ne sauraient être perpétués. Nous devons mener des actions très fortes afin de prévenir ces comportements. Même s’ils sont très marginaux, ils perdurent, comme c’est également le cas dans les SDIS. Pour moi, c’est un fléau national, au même titre que le sexisme, sur lequel je me prononcerai tout à l’heure. Nous combattons ces phénomènes. S’agissant du taux de rengagement au bout de cinq ans de service (53 %), il est effectivement faible. Nous avons donc mis en place, pour ceux qui hésitent à signer un nouveau contrat, des contrats beaucoup plus individualisés (un, deux, trois, quatre ou cinq ans) pour tenter de les garder parmi nous.
Toutefois, je le répète, la principale cause de l’attrition ou de la baisse des rengagements, ce sont bien les interventions non motivées, qui affectent nos camarades, y compris, là aussi, ceux des SDIS. Tant que l’on n’aura pas inversé la tendance, c’est-à-dire que l’on n’aura pas recentré l’activité sur des missions ayant du sens, des missions de véritable secours, on observera une attrition par démotivation des personnels.
En ce qui concerne la crue, nous avons constaté, en 2016 – même si c’était alors une crue décennale, dont l’ampleur n’était donc pas comparable à celle de la fameuse crue centennale –, la fragilité provoquée par l’urbanisation et la multiplication des réseaux. Par ailleurs, la gestion des crues relève de l’état-major de zone. La brigade n’est qu’un des acteurs ; elle intervient en complément. Les crues sont en effet des phénomènes de bassin, qui concernent aussi nos camarades sapeurs-pompiers civils d’Île-de-France. La coordination de l’ensemble des moyens se fait au niveau de l’état-major de zone, qui est installé à la préfecture de police, laquelle coordonne l’action des services de secours, mais aussi celle des dispositifs municipaux, des associations et des armées, dans le cadre du plan Neptune.
Notre priorité, en cas de crue, est bien sûr le sauvetage des personnes. À la différence d’un incendie ou d’une action terroriste, la crue peut être prévue 72 heures à l’avance. Autant le pompier est optimiste dans l’action, autant il est pessimiste dans la réflexion. C’est pourquoi, en 2016, nous avions anticipé 10 centimètres de plus, même si nous n’avions pu prévoir qu’un capteur serait perturbé par une algue. Comme nous avons aussi la responsabilité des musées, c’est-à-dire de l’évacuation des œuvres, ce qui prend du temps, nous réfléchissons toujours sur la base de prévisions plus pessimistes.
Comme je le disais, les enjeux d’une crue importante dépassent la brigade : il s’agit de décider de l’évacuation des populations, et dans quel ordre elle se fera, sans oublier les risques de pillage que cela implique. Se pose aussi le problème de l’information : comment informer tout le monde, notamment les personnes âgées ? Nous travaillons donc sur divers scénarios. Il faut également former les populations, et s’appuyer sur les réseaux locaux, en particulier les mairies, qui connaissent très bien le terrain : il y a là un tissu d’information très fin. Sur le plan tactique, il faut prévoir des embarcations de sauvetage rapide, des camions ayant une petite capacité amphibie. Les moyens d’épuisement n’interviennent – et c’est souvent un motif d’incompréhension de la part des sinistrés – que lorsque la phase de décrue commence : on ne peut pas pomper l’eau tant que celle-ci continue à monter.
Il faut aussi se préparer en étudiant les nappes phréatiques, ce qui n’est pas vraiment prévu pour l’instant. Si, en 2016, nous avons été en mesure de réagir, au moins dans une certaine mesure, c’est parce qu’en fouillant dans nos archives nous nous étions aperçus que le plus redoutable était en réalité la montée des nappes phréatiques, laquelle a lieu avec un temps de retard par rapport à celle des eaux. Or nous n’avons plus beaucoup de sources d’information sur le sujet, et il est très difficile de modéliser le processus. Voilà pourquoi nous travaillons sur une hypothèse de 10 centimètres supplémentaires.
Quoi qu’il en soit, je le répète, il s’agit là d’une manœuvre dont la conception ne relève pas de la brigade : elle concerne l’ensemble de la région, est organisée à l’échelle de la zone et fait appel à un nombre d’acteurs important. De mon point de vue, dans ce contexte, l’enjeu essentiel est d’informer les gens au plus vite et de prendre la décision d’évacuer – ou pas. Pour la partie du Val-de-Marne qui était concernée lors de la dernière crue, on avait développé des capacités de secours aux personnes, y compris en cas d’incendie, de façon à intervenir sur des embarcations pour aider ceux qui souhaitaient rester dans leur pavillon – mais cela ne peut fonctionner que pour une durée très limitée. Lorsque vous reviendrez nous voir, je pourrai vous fournir une réponse plus complète sur le sujet.
En ce qui concerne l’éducation de la population, et par comparaison avec la population japonaise, comme vous l’avez dit, celle-ci est beaucoup plus disciplinée et elle profite de centres d’éducation des populations aux risques. Nous recevons 2,5 millions d’appels environ ; seul un sur cinq donne lieu à un départ, soit 520 000 interventions. Or, malgré ce tri, 100 000 interventions ne se traduisent par aucune action. Quels leviers pouvons-nous utiliser pour remédier à cette situation ? Je présenterai la semaine prochaine un plan d’action ; le président Bridey membre de la CCGB en aura des échos.
La place des femmes est, selon moi, un enjeu majeur, car l’émergence du leadership féminin correspond à une évolution de la société. La brigade ne s’est ouverte aux femmes que depuis une quinzaine d’années. Pourquoi est-ce difficile ? Je vous rappelle le mode de recrutement : les sous-officiers sont issus du corps des militaires du rang. Cela suppose, à partir de l’âge de 18 ou 19 ans, et pendant cinq ou six ans, de grimper les échelons en passant des examens. Physiquement, c’est très dur, et dès que l’on rate une marche, on est quasiment sorti du jeu. Il est difficile pour des jeunes femmes de concilier ce parcours avec leur vie de compagne ou d’épouse, voire de mère. En termes de ressources humaines, nous allons expérimenter, pour les officiers et les sous-officiers militaires du rang, et par une distorsion de la règle, la possibilité pour les femmes de prendre une année blanche, voire deux années, pour leur permettre d’avoir des enfants.
Les jeunes femmes réussissent parfaitement dans les fonctions de capitaine et commandant d’unité, qui supposent pourtant un management de proximité assez difficile, comme nous en avons vu encore deux exemples cette année. Les hommes ne font pas du tout la différence : elles sont respectées.
L’enjeu, pour moi, est de leur permettre de réussir l’École de guerre – car nous sommes des militaires. Cela veut dire qu’à 30 ans ou à 32 ans, c’est-à-dire quand c’est peut-être le moment pour elles de faire un deuxième enfant, elles doivent se replonger dans les livres. C’est là que l’année blanche peut être nécessaire pour leur permettre de réussir au même titre que leurs camarades masculins. Une femme a d’ailleurs réussi cet exigeant concours et commandera au milieu des années 2020.
Quoi qu’il en soit, j’essaie toujours de privilégier le talent et les compétences à la loi du genre. Je ne désespère pas : dans cinq ou six ans – peut-être quinze ans – nous devrions réussir à avoir plusieurs femmes chef de corps. Le but est non pas de mettre des femmes parce que ce sont des femmes, mais de leur permettre d’accéder à ces fonctions, tout en tenant compte de leurs aspirations personnelles.
En ce qui concerne le sexisme, je me suis exprimé au mois de juillet dans un article publié par Le Monde. Je rappellerai simplement que les cinq affaires concernant la brigade s’étalent sur une période de neuf ans. Je précise aussi que le sujet me tient à cœur. Mais, en étudiant les chiffres de l’Observatoire du harcèlement, je constate également que 50 % des entreprises sont touchées par le phénomène. En disant cela, je n’excuse en rien ces agissements, et dès qu’un cas est avéré, la sanction est claire : le coupable prend la porte, il n’y a aucune circonstance atténuante. Nous avons mis en place un système de détection, avec des référentes chargées de la mixité, des assistantes sociales, des médecins et des psychologues, sans oublier l’échelon de commandement, car c’est à lui qu’il revient de détecter les cas. Les sanctions sont exemplaires.
Je dois aussi éviter l’instrumentalisation. Il me faut préserver la présomption d’innocence, tout en évitant de douter de la parole de la victime, et alors que le temps judiciaire et médiatique joue contre moi. Je dois envoyer un message fort, tout en évitant de stigmatiser.
Nous travaillons à la détection, sans oublier la prévention. Nous avons ainsi mis en place des MOOC et, comme j’aime bien les contre-pieds, en mars prochain, je ferai appel à un conteur, Yannick Jaulin, qui va s’immerger dans la brigade et montrer, dans une série de saynètes, les maladresses du pompier, tout en insistant sur les difficultés auxquelles celui-ci est confronté. Le dernier conte illustrera toute l’absurdité d’une action de harcèlement sexiste ou de « bahutage » d’un jeune – phénomène qui, je le répète, est très marginal, mais c’est encore trop –, en insistant sur le fait que, finalement, ce que les pompiers mettent en avant dans les actions difficiles qu’ils doivent mener, c’est-à-dire la camaraderie et la cohésion, ils le détruisent sans s’en rendre compte par de tels comportements, et ce à cause de l’effet de groupe.
Je ne sais pas si vous trouverez dans le monde civil un dispositif similaire, avec aussi bien la détection que la prévention…
Mme Laurence Trastour-Isnart. Les dénonciations existent aussi dans le privé !
Général Jean-Claude Gallet. …tout en sachant que les jeunes que nous accueillons viennent de la société civile, avec leurs défauts, et sans oublier, par ailleurs, qu’il s’agit effectivement d’un milieu masculin, qui s’est ouvert aux femmes depuis peu. Je pense que nous aurons gagné la bataille dans dix ans, mais nous devons faire attention en permanence.
En la matière, la transparence est assurée. La jeune femme – ou le jeune homme, d’ailleurs – qui est victime peut déposer plainte. Nous l’accompagnons et lui assurons une protection fonctionnelle. Si je suis informé des faits incriminés par des voies détournées, et non par la plaignante ou le plaignant, je respecte l’article 40 du code de procédure pénale. Certes, ces agissements sont inadmissibles, mais les problèmes des sapeurs-pompiers sont aussi les agressions dont ils sont l’objet et la sur-sollicitation opérationnelle. Pour être audible en interne, je dois aussi insister sur la difficulté du métier, sans pour autant, une fois encore, tolérer de tels excès, qui sont inadmissibles. Notre démarche est donc très volontariste.
J’ai été interrogé sur les blessés. Hier, la brigade a assisté à l’avant-première de Sauver ou périr, que je vous conseille vraiment d’aller voir, car c’est un film lumineux. Son message est universel, notamment en ce qui concerne les blessés, et la brigade sert de support révélateur. Le film raconte l’histoire véridique d’un sous-officier qui a été grièvement brûlé, et sa reconstruction physique, morale et psychique.
Je suis contemporain de cette histoire. Or, force est de constater qu’il y a trente ans, au moment où l’accident en question s’est produit, pas grand-chose n’était prévu pour la prise en charge des blessés. Depuis, on a progressé, notamment avec l’armée de terre, d’abord avec les blessés de Côte d’Ivoire, ensuite – et surtout – avec ceux d’Afghanistan, sans oublier les syndromes post-traumatiques de soldats revenant de République centrafricaine. Nous nous raccrochons à la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre (CABAT).
Notre propre structure de prise en charge psychologique est en liaison avec la structure correspondante qui existe pour les armées. Au lendemain des attentats de 2015, les 750 sapeurs-pompiers de Paris engagés sont tous allés voir un psychologue mais, si nous avons eu la chance de ne pas compter de blessés dans nos rangs, je pense que nous aurons des « pertes psy », pour utiliser un terme très technocratique.
S’agissant du statut des blessés, nous avons profité des avancées de la recherche et de l’amélioration de l’armée de terre ; comme je l’ai dit, nous bénéficions de leur dispositif. Plus largement, la prise en charge des blessés est aussi l’une des préoccupations de la ministre des Armées, qui a déclaré que les blessés d’unités militaires seraient mis à la disposition d’autres autorités. Le chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT) rencontrait hier les membres du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire (HCECM) pour évoquer le sujet.
Quoi qu’il en soit, entre ce qui se faisait il y a trente ans et ce qui se passe maintenant, la prise en compte des blessés s’est vraiment améliorée, même si l’on peut naturellement toujours mieux faire. Je vous recommande, une fois encore, d’aller voir le film que j’évoquais : c’est un hommage aux sapeurs-pompiers blessés en opération, mais aussi aux personnels de santé – médecins, infirmières, aides-soignantes. Le film donne en même temps des clés de vie, y compris pour les blessés de la vie, non seulement ceux qui ont été blessés au cours d’une opération, mais ceux qui souffrent d’un syndrome post-traumatique.
S’agissant de l’application de la DETT aux pompiers volontaires, je ne me prononcerai pas. Je peux simplement vous dire, une fois encore, que si la BSPP n’est pas exclue du champ de la directive, c’est la fin de notre modèle. Pour l’heure, nous avons reçu des assurances des autorités politiques et militaires.
Vous m’avez interrogé, Monsieur Verchère, sur le retour d’expérience du 13 novembre 2015. J’aurais pu vous apporter le film d’une réunion qui s’était tenue le 5 novembre, et lors de laquelle nous avions décrit le scénario des attentats – non pas que nous soyons devins : nous analysons les dépêches d’agences de presse spécialisées, notamment concernant les fusillades mortelles. Nous mettions d’ailleurs en place, en 2015, un exercice sur la base d’un scénario similaire à celui qui s’est produit.
Tout à l’heure, j’ai évoqué, parmi les critères de succès, le partage de l’information avant, pendant et après. Ce partage a lieu, mais il est toujours très difficile de travailler avec des partenaires obéissant à des temporalités différentes, ayant des seuils de criticité et des phases de montée en puissance différents. L’enjeu est simple : si l’on prend l’exemple d’une fusillade, donc de blessures par armes à feu, nous avons entre dix et quinze minutes pour réaliser un damage control – si toutefois la victime n’a pas été tuée sur le coup –, une heure pour l’évacuer et une heure et demie, peut-être deux heures, pour accomplir un acte chirurgical salvateur. Il faut donc concevoir une manœuvre accomplie sous forte contrainte sécuritaire et impliquant des acteurs ayant des doctrines différentes, pour parvenir à ce résultat.
Cela dit, nous avons fait d’énormes progrès. Nous avons travaillé sur la doctrine et élaboré des exercices. Je pense donc que, sous réserve que le scénario n’ait pas une dimension trop grande, nous serions au rendez-vous – BSPP, associations, SAMU, AP-HP, et bien sûr les forces de police de l’ensemble de la région parisienne. L’essentiel est de travailler sur un scénario différent des attentats du 13 novembre. Il faut donc être agile intellectuellement. En effet, si nous continuons à envisager un scénario de 250 blessés, sur une séquence de 40 minutes, nous aurons tout faux : il est temps de travailler sur un scénario impliquant 500 ou 800 blessés graves en deux minutes, sur un site non sécurisé, c’est-à-dire avec la combinaison de kamikazes, de tireurs et d’une prise d’otages.
Mme Séverine Gipson. Lorsque survient une catastrophe, chaque minute compte pour sauver les vies. Nous avons été exposés à des attentats, à des catastrophes naturelles et, malheureusement, ces menaces sont toujours présentes ; la ville de Paris est la première concernée. Notre majorité travaille actuellement à la mise en place du service national universel. Pensez-vous que la formation d’une classe d’âge au secourisme et à la gestion de l’effet de sidération développera la résilience et fournira de l’aide face à de telles catastrophes, facilitant ainsi le travail des sapeurs-pompiers ?
M. Jean-Louis Thiériot. Je souhaiterais poser trois questions techniques.
La première concerne la doctrine d’intervention. Ayant été président du conseil départemental de Seine-et-Marne, j’ai beaucoup échangé avec le directeur du SDIS. Existe-t-il une différence de doctrine d’intervention, à niveau de spectre identique – je ne parle pas d’attentats terroristes massifs – entre la BSPP et les services départementaux ?
Une réflexion est en cours sur la plateforme d’appel unique, sur le rôle du 112, avec notamment le développement de la plateforme unifiée des services d’incendie et de secours, dite NexSIS. Ma deuxième question est donc la suivante : la BSPP fait-elle partie de ce projet et, si oui, à quel titre ? Pensez-vous qu’un numéro d’appel unique faciliterait le tri des demandes ?
Ma troisième question concerne les réservistes. Je suppose que les réservistes de la réserve opérationnelle servent sous statut militaire. Comment recrutez-vous les primo-entrants ? Qu’en est-il de ceux qui quittent la BSPP et qui souhaiteraient rester dans la réserve opérationnelle ? Enfin, quelle est la pyramide des grades dans la réserve opérationnelle ?
M. Thomas Gassilloud. Je souhaite d’abord vous remercier, Mon général, pour votre accueil la semaine dernière : dans le cadre de l’École de guerre, j’ai eu l’occasion de passer 12 heures, la nuit, au sein de la BSPP, au centre de secours de Nanterre. Je dois dire que j’ai beaucoup appris à cette occasion, non seulement sur la BSPP, qui est la plus grande brigade de l’armée de terre, mais également d’un point de vue sociologique : le centre de secours que j’ai visité intervient aussi bien à La Défense que dans des zones moins favorisées – vous parliez à cet égard du rôle de capteur de la BSPP. Il est vrai qu’en intervenant de nuit au fin fond du quartier Pablo-Picasso, on se fait une idée un peu plus fine de la diversité des quartiers.
On a beaucoup parlé de la fidélisation et de l’attractivité de la fonction de sapeur-pompier. Ma question sera donc toute simple. Je me suis rendu compte, en discutant avec des sapeurs-pompiers, que le coût résiduel du billet de train était parfois important, puisque certains font plusieurs allers-retours dans la semaine. Cela peut représenter une charge de plusieurs centaines d’euros par mois, malgré la réduction de 75 %. Étant donné, par ailleurs, qu’il peut être utile d’avoir des sapeurs-pompiers de la BSPP dans des trains, lieux où, par nature, il est compliqué d’acheminer des secours, je me demandais si vous aviez étudié la possibilité de prendre en charge les billets de train au-delà de 75 %. Ce serait une mesure forte pour augmenter l’attractivité de la fonction.
M. Jacques Marilossian. Mon général, je vous remercie pour votre exposé. J’habite moi-même à 200 mètres de la caserne de la BSPP à Saint-Cloud. On peut regretter que la dernière audition d’un général commandant la BSPP remonte à 2015 : nous aimerions vous voir plus souvent.
Sous l’autorité du préfet de police, vous avez révisé le schéma interdépartemental d’analyse et de couverture des risques (SIDACR), qui détermine les objectifs de couverture des risques en définissant les enjeux et les lignes directrices pour la période 2017-2022. Tout à l’heure, vous avez rapidement évoqué le Grand Paris Express et les Jeux olympiques de 2024. Ma question est simple : pouvez-vous revenir sur ces deux grands défis des prochaines années et sur leur impact pour le schéma en question ?
M. Philippe Chalumeau. Mon général, je vous remercie pour votre présence parmi nous. J’ai eu l’occasion, comme mon collègue Christophe Blanchet – et d’autres – de participer à une immersion dans un centre de secours – c’était à Tours, dans ma ville. Je voudrais à mon tour saluer l’engagement des pompiers, leur courage et l’abnégation dont ils font preuve quotidiennement.
Vous avez évoqué la question des appels, avec les plateformes du 17 et du 18, à Paris, et la volonté d’élargir au 15. À Tours, nous avons un centre de traitement des appels rassemblant le 15, le 18 et le 112, mais il a été décidé de traiter de nouveau les appels de façon séparée pour des raisons liées aux logiciels utilisés. Je voulais vous faire part de cet élément et vous demander quelle est votre vision : envisagez-vous de rassembler le 17, le 18 et le 15 à Paris ? Cela nous permettrait, à Tours, d’avoir un retour d’expérience.
Par ailleurs, les agressions quotidiennes dont les pompiers sont victimes doivent nous interpeller. Quelles actions pourrions-nous imaginer pour essayer de faire évoluer cette situation, qui est bien sûr inacceptable ?
Général Jean-Claude Gallet. En ce qui concerne le SNU, je répondrai en posant un préalable technique. Pour faire face à l’effet de sidération, deux éléments sont indispensables : comprendre ce qui se passe et donner un sens à l’action. Ce second élément est particulièrement important quand il ne s’agit pas de personnels d’active, et c’est précisément le plus compliqué.
Cela dit, le SNU, si la BSPP devait être amenée à y contribuer, permettrait non seulement d’apprendre aux jeunes qu’il ne faut pas appeler les pompiers pour rien, mais aussi de les rendre acteurs, donc de les responsabiliser. La jeunesse actuelle est à la recherche d’engagement et de responsabilités, sous réserve qu’on lui explique le pourquoi des choses. Les douze jours de formation au secourisme pourraient y contribuer. Certains ne se révéleront peut-être capables de faire face à des situations d’urgence, mais il y a bien d’autres emplois ou fonctions : ils pourraient servir dans la logistique, ou au premier niveau d’une plateforme de prise d’appels. Il y a là un gisement de possibilités.
Pour éviter que cela ne se transforme en fausse bonne idée, il faut continuer à creuser, et garder le principe directeur qui est l’engagement de la jeunesse – une jeunesse qui est véritablement en attente d’un engagement, et a été un peu frustrée après 2015. D’ailleurs en s’appuyant sur les dispositifs jeunesse, il faut commencer à expérimenter progressivement, comme j’en ai l’intention, des formations dans certains départements pilotes.
Cela étant dit, il y a tout de même un besoin d’actualisation de cette formation. Après avoir été formé pendant douze jours, puis engagé pendant trois à quatre mois dans une réserve, on doit y revenir régulièrement, sur son temps libre. La génération que nous connaissons y est moins encline. L’idée reste cependant à creuser, car il est clair qu’en cas de crise majeure, c’est une ressource qui fera la différence. Je reste donc optimiste sur ce dispositif.
Monsieur Thiériot, il n’y a pas de différence sur la doctrine appliquée par les différents services de secours, comme l’ont fait ressortir les réunions du groupe de travail mis en place après les tueries massives de 2015.
Peut-être y a-t-il tout au plus des différences de niveaux, parce que les sapeurs-pompiers militaires sont peut-être plus aguerris. Encore faut-il nuancer, car, chez les sapeurs-pompiers volontaires, vous comptez aussi les sapeurs-pompiers de Paris. Il n’y a donc pas de vraie différence.
La BSPP est engagée à la fois sur la plateforme des appels d’urgence (PFAU) et sur NexSIS, le logiciel national pour les centres d’appels d’urgence. Je rappelle que la PFAU est un système, expérimenté à Paris, de réponse commune aux appels du 17, du 18 et du 112. Quant à NexSIS, c’est le futur système de gestion opérationnelle : il inclut bien sûr la BSPP, qui y est contributrice, en fournissant déjà des cadres d’expérience.
Je parie sur l’avenir ! Souvent, je dis que « le concept doit précéder l’innovation technologique ». Mais, en l’occurrence, pour casser un peu les cultures de silos, il me semble que ce sont l’innovation technologique et les systèmes d’information qui permettront de cet échange d’informations. Ainsi, NexSIS devrait être compatible avec la plateforme du SAMU.
La pyramide des grades chez les réservistes est une question nouvelle, vu que cette ressource est elle-même nouvelle et que les réservistes n’avaient jusqu’à aujourd’hui pas accès à la fonction de chef d’agrès. On vient de leur ouvrir cette possibilité et nous allons poursuivre dans cette voie, mais on démarre de pratiquement de zéro : ils sont à présent 400, seront bientôt 600, et 1 000 en 2024.
J’en viens, Monsieur Gassilloud, au coût du transport. Sur ce sujet, notre partenaire est la SNCF. Pour certains, le coût du transport doit représenter 30 % de leurs soldes. Mais je ne suis pas sûr d’arriver à un résultat.
C’est pourquoi je cherche à recruter sur la plaque parisienne. Malgré tous les efforts, cela reste compliqué. Cependant, nous connaissons l’exemple de ce qu’il s’est produit en Île-de-France, avec le financement du transport gratuit des policiers, parce que cela contribue à la sécurité. Aussi avons-nous le projet de nous présenter à la SNCF et à Île-de-France mobilité, comme sapeurs-pompiers de Paris, pour leur dire que notre action est un gage de sécurité supplémentaire. Il ne s’agit pas d’obtenir un tarif à 0 %, mais une participation à l’« effort de guerre ».
En outre, un pompier en tenue peut aussi être une cible. En trois ans, la situation a en effet changé. Les casernes, qui étaient ouvertes sur le monde, sont désormais équipées de systèmes de vidéosurveillance. Cela ne faisait pas du tout partie de notre culture.
Si nous n’arrivons pas à développer un partenariat avec la SNCF, nous étudierons, dans le plan d’attractivité, qui est une déclinaison du plan familles, la possibilité de rembourser, sous certaines conditions, certains frais de transport sur le budget de la brigade – mesure à faire adopter par nos élus.
En ce qui concerne le SIDACR, j’aurai une réponse très longue et très complexe que je vous propose de vous faire parvenir. Elle vous fournira la vision complète de la brigade par rapport aux enjeux du Grand Paris Express et par rapport à l’organisation des Jeux olympiques. Nous y prenons en compte les implications en termes de démographie et de vieillissement. En synthèse, à court terme, il faudra 25 VSAV, soit 250 personnes en plus à l’horizon 2024, c’est-à-dire l’équivalent de trois ou quatre casernes. Avec la mise en service du Grand Paris Express en 2030, cela représente beaucoup. Vous pourrez prendre connaissance du détail, y compris s’agissant du vieillissement de la population et de la paupérisation prévisible. Les données sont issues de l’INSEE et l’IAU ; ce sont donc des données véritablement scientifiques, auxquelles nous avons appliqué un ratio mécanique développé par l’École polytechnique.
J’en viens, Monsieur Chalumeau, à la question des plateformes d’appel, éventuellement communes aux numéros d’urgence 17, 18 et 112. Nous avons franchi un grand pas à Paris, en rassemblant sur ces PFAU policiers et pompiers – grand pas assez naturel, à vrai dire, puisque nous sommes déjà tous intégrés sous l’égide de la préfecture de police.
Il y a des systèmes européens où les différents corps d’intervention sont présents dans la même salle, à la fois pour la prise d’appels et pour la gestion de crise. Mais je pense que nous n’y sommes pas encore prêts, sachant que le SAMU souhaite, ce que je comprends très bien, que le centre de crise soit à l’hôpital, ce qui n’a pas la préférence des pompiers, tandis que la logique de la police ou de la gendarmerie est tout autre.
Une solution intermédiaire serait que les systèmes d’information soient compatibles ou interopérables. Tel est le sens du travail de NexSIS. Actuellement, nous lançons une expérimentation sur la place parisienne : nous nous sommes donné six mois pour que nos services d’information soient compatibles avec ceux du SAMU.
On peut peut-être dématérialiser la collaboration, sans forcément mettre tout le monde dans la même salle, grâce aux nouvelles technologies. Je fais ce vœu. Sinon, nous allons nous heurter à des conflits et nous n’aboutirons pas, alors qu’il y a urgence. Car le facteur du succès, c’est de partager les informations avant, pendant et après.
Quant aux formations sur les agressions, je rappellerai d’abord qu’en 2018, 256 sapeurs-pompiers de Paris ont été agressés, soit pratiquement une agression par jour. En 2017, de mémoire, cela devait être 170, année où une augmentation de 50 % était déjà observée par rapport à 2016.
Parmi les causes, j’évoquerai l’alcoolémie, mais aussi la perte de repères de notre société, où la patience d’attendre n’existe plus. Le pompier se trouve confronté à des actes inciviques ou à de la détresse psychologique. C’est pourquoi nous conduisons des actions de formation. Ce matin, était organisé le retour d’expérience de l’agression qui a coûté la vie au caporal Geoffroy Henry il y a deux mois. Comment introduire dans le cursus de formation des chefs d’agrès, c’est-à-dire des chefs de détachement, des savoir-faire qui permettent de détecter le risque ? Normalement, on ne devrait pas basculer dans cette approche, mais il est possible de porter plus d’attention à des signaux faibles, qui relèvent soit de la personne mal intentionnée, soit d’une pathologie psychique. Sur cette base, il est possible de concevoir et de développer une conduite à tenir, qui est très simple : l’esquive et la fuite.
En amont, quand la dangerosité est connue, il est aussi possible de se déplacer avec la police. Cela fait l’objet d’un protocole qu’on est en train de développer. C’est l’objet de la dernière directive laissée par le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb avant qu’il quitte ses fonctions.
Nous développons aussi la protection de nos emprises. Cela représente un surcoût depuis trois ans. Une caserne de pompiers n’est plus ouverte au public, malheureusement. Il y a désormais une herse, un dispositif de vidéosurveillance et un personnel équipé d’un kit de protection. Quant à la sécurité pendant les interventions, nous étudions l’emploi éventuel d’un gilet pare-lames. Mais j’espère ne pas basculer dans une approche qui reviendrait en quelque sorte à accepter une situation qui n’est pas bonne.
Il y a aussi un effort de judiciarisation des agressions. Il faut que le sapeur-pompier soit sanctuarisé. On ne peut pas exiger de lui un comportement irréprochable en termes de sexisme et de harcèlement moral et, dans le même temps, ne pas assurer sa protection en intervention. Cela ne serait pas cohérent, en termes de commandement.
M. Charles de la Verpillière, président. Mon général, c’était vraiment une audition très utile et passionnante. Dans la plupart des départements français, on a aussi bien compris qu’il va falloir prendre à bras-le-corps le problème du nombre d’interventions inutiles. Ce sera probablement un grand sujet pour les années qui viennent.
*
* *
La séance est levée à dix-huit heures trente-cinq.
*
* *
Membres présents ou excusés
Présents. – M. Jean-Philippe Ardouin, M. Didier Baichère, M. Xavier Batut, M. Stéphane Baudu, M. Thibault Bazin, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Jacques Bridey, M. Philippe Chalumeau, M. André Chassaigne, M. Alexis Corbière, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Yannick Favennec Becot, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Jean-Marie Fiévet, M. Thomas Gassilloud, Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, M. Jean-Michel Jacques, Mme Anissa Khedher, M. Bastien Lachaud, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Didier Le Gac, M. Jacques Marilossian, M. Philippe Michel-Kleisbauer, Mme Patricia Mirallès, Mme Josy Poueyto, M. Joaquim Pueyo, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Trastour-Isnart, M. Stéphane Travert, Mme Nicole Trisse, M. Patrice Verchère, M. Charles de la Verpillière
Excusés. – M. François André, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Florian Bachelier, M. Olivier Becht, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Sylvain Brial, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Luc Carvounas, Mme Françoise Dumas, M. Richard Ferrand, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Laurent Furst, M. Claude de Ganay, Mme Manuéla Kéclard-Mondésir, M. Loïc Kervran, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Fabien Lainé, M. Gilles Le Gendre, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Sabine Thillaye, Mme Alexandra Valetta Ardisson