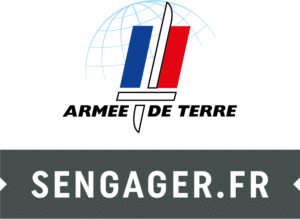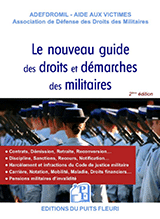Commission de la défense nationale et des forces armées
Présidence de Mme Patricia Adam, présidente
— Audition, ouverte à la presse, de M. Arnaud Kalika, directeur du séminaire Russie, chaire de criminologie au CNAM, et de Mme Barbara Kunz, chercheur au comité d’études des relations franco-allemandes de l’IFRI, sur la situation de sécurité en Scandinavie et autour de la mer Baltique
La séance est ouverte à dix-sept heures.
Mme la présidente Patricia Adam. Nous accueillons M. Arnaud Kalika, directeur du séminaire « Russie » à la chaire de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), et Mme Barbara Kunz, chercheur au comité d’études des relations franco-allemandes de l’Institut français des relations internationales (IFRI) pour une audition, ouverte à la presse, sur la situation de sécurité en Scandinavie et autour de la mer Baltique.
Au cours de cette législature, nous avons été particulièrement attentifs à la zone du Sahel et au Moyen-Orient, ce qui est normal, compte tenu notamment des opérations extérieures menées par nos forces dans ces deux régions. Nous avons aussi travaillé, on le sait moins, sur la question du retour des « États puissances », qui figurait dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013. Deux délégations de la commission de la défense se sont rendues respectivement en Estonie en septembre dernier et en Norvège en décembre. Nous avons aussi rencontré ou reçu nos collègues parlementaires d’autres pays de la zone, notamment d’Allemagne et de Pologne.
Madame, Monsieur, vos réflexions et votre expertise visent à éclairer les parlementaires tant de l’actuelle que de la prochaine législature, ainsi que tous ceux qui nous écoutent, afin que la prise de conscience soit la plus large possible sur ces questions, qui reviendront inévitablement dans l’actualité.
M. Arnaud Kalika, directeur du séminaire « Russie » à la chaire de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers. Je vais vous présenter la manière dont la Russie perçoit elle-même sa sécurité, du dedans et du dehors. Je ne prétends pas énoncer ici des vérités ; j’espère plutôt susciter vos questions.
En guise d’introduction, je rappellerais que le monde change à vue ; « la vitesse est entrée dans l’histoire », ainsi que le constatait l’historien Marc Bloch. En moins d’un siècle, la Russie a d’abord concentré l’espérance du monde en proposant, en 1917, la paix et le socialisme et en s’impliquant dans le processus de décolonisation contre les puissances coloniales, puis, le 21 août 1968, pour ceux qui ne l’auraient pas compris, les « chars d’août » sont entrés dans Prague, annonçant la chute de l’Empire soviétique et de son utopie.
L’URSS disparue, Moscou a cessé d’être ce qu’elle disait vouloir être : un phare, une lumière alternative à l’idéologie européenne. La Russie s’est retrouvée déclassée au rang de puissance périphérique de l’Europe et de l’Asie, d’État en voie de développement, malgré ses immenses richesses naturelles. En 1992, non seulement plus personne ne craignait la Russie de Boris Eltsine, mais on l’a fait disparaître des priorités de politique extérieure de la majorité des États les plus riches de la planète.
Vu de Russie, les relations internationales sont une affaire de représentation. Elles sont le produit de ce qu’on appelle l’Occident. Rappelons que l’émergence de l’école réaliste en 1945, c’est-à-dire de l’étude des puissances, a permis aux États-Unis de conceptualiser leur nouvelle position de leader mondial. Or, même si la Russie a une relation historique profonde avec l’Europe et l’Occident, elle ne se considère plus comme appartenant idéologiquement à ce monde. Depuis la faillite du socialisme réel et la chute de l’URSS, ce monde est perçu comme légitimant la dissolution de la puissance russe au profit d’un monde globalisé, dont le démiurge serait, bien entendu, américain. Ainsi, son éviction du G8 serait le résultat d’une politique menée par une caste orgueilleuse fermée, dont le but ultime serait l’application de la théorie de « la fin de l’histoire et du dernier homme », prônée par Francis Fukuyama.
S’il ne fallait retenir qu’un seul élément de la politique de Vladimir Poutine depuis son arrivée aux affaires en 1999 comme Premier ministre, c’est qu’il s’est employé à rendre à la Russie son statut de puissance, à lui faire retrouver sa grandeur, afin d’avoir la faculté d’imposer à l’autre sa volonté tout en montrant à l’Occident que le monde ne se contrôle plus seulement au moyen d’une politique des clubs. Toujours vu de Russie, le fait d’être craint et d’apparaître au sommet sur l’échelle des menaces potentielles pour la sécurité de ses voisins est plutôt une bonne chose. Dès lors, la clef de la sécurité dans la Baltique et en Europe du Nord, comme dans l’ensemble du voisinage russe, réside précisément dans la gestion de cette séparation des perceptions, qui divise désormais nos mondes en tension.
Cette année, l’ancien numéro deux de l’OTAN, le général britannique Richard Shirreff, a publié un ouvrage intitulé 2017: War with Russia: An Urgent Warning from Senior Military Command. Dans cet essai, il anticipe une invasion militaire russe dans la Baltique, dont les États riverains sont des membres de l’OTAN, mais pour la protection desquels l’OTAN ne bougerait pas car, si menace russe il y a, il faut un élément intentionnel. L’ancien chef militaire de l’OTAN considère que l’on assiste, dans le sillage de l’annexion de la Crimée – rappelons que ce qui est qualifié d’annexion en droit international n’est qualifié, en Russie, que de reprise d’un territoire concédé par une fredaine de l’histoire –, au retour d’une politique néo-impériale en vue de reconstituer le glacis soviétique. Certains scénarios de crises de l’OTAN sont finalement assez proches de celui qui est décrit dans ce livre : l’idée est que la Russie de Poutine a actuellement un comportement agressif et pourrait vouloir intervenir militairement dans des États où les minorités russophones se percevraient en danger. Pour le dire plus simplement, il s’agirait d’un scénario de violences sociales extrêmes contre des minorités russes qui conduiraient Vladimir Poutine à utiliser la force pour protéger ces communautés.
Pour essayer de comprendre cette problématique, il faut faire litière des préjugés et porter un regard dessillé sur cette « Russie puissance ». J’évoquerai quatre points, en me plaçant toujours du point de vue russe : la Russie comme nouveau point de repère civilisationnel ; la guerre et la force, afin de comprendre les implications de la posture d’une « Russie en guerre » ; le concept de frontière, qui est, selon moi, à géométrie variable vu de Russie ; l’évaluation de la menace vue par la Russie au travers de ses documents officiels, qui permettra de faire la synthèse des éléments précédents.
Premier point : la Russie comme nouveau point de repère civilisationnel.
Depuis l’arrivée aux affaires de Vladimir Poutine en 1999, on assiste à une politique étrangère opportuniste et multivectorielle : il y a d’abord eu l’affirmation européenne du discours prononcé au Bundestag le 25 septembre 2001, puis la fin du virage occidental après la guerre en Géorgie en 2008 ; progressivement, la Russie s’est mise à bouder son ancrage européen au profit d’une redécouverte de sa slavophilie et de son rôle historique comme pivot de l’Eurasie.
Vu de Russie, ce basculement eurasiatique est la conséquence d’une déception vis-à-vis de l’Europe, dont la non-livraison du Mistral et les sanctions constituent, selon le Kremlin, l’apogée. Le repositionnement eurasiatique est passé par la consolidation de la relation avec les anciens alliés et la restructuration de l’espace post-soviétique au moyen d’organisations régionales telles que l’Organisation de coopération de Shanghai et l’Union économique eurasiatique. Dans cet espace, le dossier ukrainien a été au cœur des tensions avec l’Occident. Mais, au-delà de cet espace, le véritable point de rupture s’est certainement dessiné en 2011, en miroir de l’opération en Libye : vu du Kremlin, une opération autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies pour protéger les populations civiles ne pouvait pas aboutir à l’élimination physique d’un chef d’État. C’est dans ce contexte que Vladimir Poutine a déclaré, peu de temps après sa réélection en 2012, qu’il ne se reconnaissait plus dans les valeurs européennes. La Russie a alors décidé de cheminer seule dans un monde multipolaire et interdépendant. À partir de ce moment-là, l’Occident ne pouvait plus servir de point de repère à la Russie.
Ainsi assiste-t-on à l’exhumation de certains auteurs slavophiles exaltant une voie géopolitique russe, fondée sur un esprit national transcendant à la fois l’Europe et l’Asie. C’est également un retour à cette Russie, nouveau modèle idéologique du monde, face à un Occident éventé par la mondialisation. Si Byzance, la « Deuxième Rome », a failli dans sa mission, Moscou doit assurer sa fonction de « Troisième Rome ». Slavophilie, je le rappelle, ne signifie pas asiatisme et, si les Russes sont souvent perçus en Europe comme des Asiatiques, ils sont perçus en Asie comme des Européens. D’où la fameuse formule de Malraux : « La Russie n’est ni en Europe ni en Asie, elle est en Russie. »
Par-delà le bien et le mal, les faits sont donc là : la Russie a choisi d’embrasser en toute transparence l’axiome de nouveau phare spirituel chrétien à l’extérieur et des valeurs nationales à l’intérieur. À cet égard, ce que l’on qualifie de nationalisme russe en Occident est qualifié, à Moscou, de patriotisme. Pour les auteurs du nouveau concept de politique étrangère russe, publié en décembre 2016, l’actuelle « crise grave » dans les relations entre la Russie et les États occidentaux et l’OTAN est liée aux « problèmes systémiques » qui s’accumulent depuis un quart de siècle dans la région euro-atlantique. Pour le dire autrement, le discours russe est aujourd’hui le suivant : contrairement à ce qui se passe en Occident, où toute chose tend à être réduite au fétichisme marchand, en Russie, le spirituel eschatologique et la transcendance d’une civilisation préservée et de son histoire sont les seules valeurs supérieures et celles pour lesquelles on est prêt à payer le prix du sang. Cela implique un retour au patriotisme et à la morale versus la globalisation et les dérives du genre, dont les réseaux sociaux sont le prolongement. Par-delà ce discours officiel partagé par une large majorité de la population – ne nous y trompons pas : le message vertueux est très populaire en Russie –, on se rend compte en allant sur le terrain que la réalité est, bien entendu, parfois plus froide : celle d’une société de classes aliénée dans sa prison bureaucratique, où l’élite fonctionnarisée cannibalise progressivement les richesses à son profit.
Deuxième point : la guerre et la force, pour comprendre les implications de la posture d’une « Russie en guerre ».
Selon un adage bien connu, « le pouvoir est au bout du fusil », mais je dirais que, dans le cas russe, sa préservation est au bout du langage. Il existe assurément, dans la politique de Vladimir Poutine, une croyance dans la fonction créatrice de la force. Dans cette perception, le monde est globalement incertain et ce sont les armes qui, depuis des siècles, changent le monde. Alors qu’une mystique pacifiste a gagné l’Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en Russie, la force a continué d’être considérée comme le pilier le plus fiable pour régler le destin des peuples.
Selon moi, plusieurs facteurs peuvent l’expliquer.
C’est, d’abord, le sentiment général d’avoir disparu de la carte du monde lorsque l’URSS s’est effondrée. À cet instant, l’identité russe s’est cherché un passé, et l’élite au pouvoir a constaté que l’Occident avait acté la disparition de la menace soviétique, cantonnant la nouvelle Russie dans le statut d’une puissance périphérique et de nain économique. Une posture de guerre devenait donc nécessaire pour lancer une politique de remontée en puissance et de récupération de son rang international.
C’est, ensuite, la conséquence des deux guerres en Tchétchénie et de ce qu’on a appelé le « terrorisme intérieur » : la Russie a été, je le rappelle, le premier pays victime du terrorisme de masse, à Boudionnovsk, au théâtre de la Doubrovka ou encore à Beslan.
C’est, enfin, la théorie de la citadelle assiégée, qualifié de complexe en Occident mais vécue comme une réalité en Russie : le pays se sent réellement encerclé et nous invite à observer les élargissements successifs de l’OTAN ainsi que le déploiement de forces de l’OTAN à ses frontières, notamment dans la Baltique. C’est dans ce cadre qu’il faut réfléchir à la doctrine Guerassimov – du nom du chef d’état-major des armées –, dans laquelle a été annoncée, en 2013, la mise en œuvre de nouvelles formes de guerre, une guerre qui sera, pour la Russie, transversale, une guerre d’ubiquité. La nouvelle loi russe sur le cyberespace fait partie de cette guerre d’ubiquité : selon son premier alinéa, elle vise à « défendre la souveraineté, la stabilité politique et sociale, l’intégrité territoriale » de la Russie.
La Russie est donc en guerre, pour sa survie, pour la défense de son rang international, pour ses valeurs et sa vision du monde. En pratique, cela signifie que, dans tous les discours et dans tous les textes législatifs, on trouve des actes de guerre. Chaque apparition médiatique, chaque opération de communication, chaque exercice militaire est un exercice de guerre. Il est donc naturel que, dans le domaine de l’information, la Russie pratique une censure de guerre et une communication offensive pour imposer sa vision comme l’ultime vérité. Une Russie en guerre, cela implique aussi l’application de la « tactique du salami », c’est-à-dire la neutralisation, une tranche après l’autre, de tous les éléments jugés préjudiciables à la pérennité du pouvoir et à la sécurité de l’État.
Troisième point : le concept de frontière est, vu de Russie, à géométrie variable.
Historiquement, la Russie a été un espace, une idée, avant d’être un territoire délimité par des frontières. Philosophiquement, la Russie ne connaît pas de frontière. Cela peut ressembler à un paradoxe, mais la Russie se considère elle-même comme un pays-frontière, un pays du milieu, symbolisé par l’aigle bicéphale. Dans cette optique, l’idée russe est une singularité, une religion, voire un dogme. L’histoire est au service de la géographie, et il n’existait plus, sous l’Empire, de nation russe, mais des peuples de Russie.
Cependant, en 1945, le mythe fondateur de la victoire et l’esprit de Yalta ont scellé les nouvelles frontières administratives de l’URSS. Les juristes soviétiques ont toujours défendu le principe d’intangibilité de ces nouvelles frontières, car la frontière appelle aussi la reconnaissance internationale et la paix. Ce principe de clôture a volé en éclat avec l’annexion de la Crimée, qui, dans la perception russe, rappelons-le, est non pas une violation des frontières d’un État souverain, mais une réponse à l’histoire.
C’est là toute l’ambiguïté de cet espace : l’identité russe a nomadisé aux confins de l’Empire, au moins jusqu’en 1991, moment où, pour la première fois, être Russe, c’était d’abord être citoyen de la Fédération de Russie. Quant aux Russes qui continuent à vivre hors de Russie, dans « l’étranger proche », notamment dans la Baltique, ils constituent ce qu’on appelle le rousskii mir – le monde russe. C’est une communauté qui s’allonge en forme de collier de perles sur les marges post-soviétique de la Russie. Selon les endroits, l’acceptation de la frontière est plus ou moins difficile. Dans le cas ukrainien, de nombreux Russes d’Ukraine se sentent ukrainiens, mais beaucoup d’autres se sentent aussi russes. Pour nous, Européens, il est difficile d’émettre à ce sujet un jugement réellement objectif.
Dans le cas des États baltes, de la Pologne et, plus globalement, de l’Europe du Centre-Est, les choses sont assez compliquées, car chaque pays à sa propre vision, que ni l’Union européenne ni l’OTAN n’effaceront. Dans ces pays, il existe un sentiment réel d’impuissance, d’hostilité envers la Russie et de ressentiment à l’encontre de l’Occident dans le sillage de l’esprit de Yalta. Si la Pologne est si virulente à propos de la Russie, c’est aussi parce qu’elle n’a pas oublié l’histoire, y compris l’assaut avorté conduit en 1920 par le stratège soviétique Toukhatchevski pour prendre Varsovie et exporter la révolution bolchevique.
Dans cette région du monde, de la Baltique à l’Europe du Centre-Est, la Russie a toujours été vue comme un autre monde. Historiquement, pour la Pologne, la Russie a été une rivale. La Fédération polono-lituanienne comprenait la Biélorussie et une partie de l’Ukraine. Puis, au XVIIe siècle, lorsque l’expansion impériale russe s’est tournée vers l’Ouest, vers la mer Baltique et la mer Noire, la Pologne est devenue une cible. En Occident, Pierre le Grand et Catherine II sont perçus comme des modernisateurs, alors que, vu de Pologne, l’européanisation de la Russie a signifié conquête et impérialisme. Cette expansion russe a conduit à la perte d’indépendance de la Pologne.
En somme, la géopolitique est toujours jeune, et ces tensions restent clairement l’épicentre des convulsions actuelles.
Quatrième point : l’évaluation de la menace vue par la Russie au travers de ses doctrines officielles.
Tout est écrit dans les documents successifs publiés ces dernières années. On peut y lire que la mission principale de la politique extérieure russe est « la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’État », avec deux nouveaux objectifs cependant : « consolider les positions de la Russie comme l’un des centres les plus influents du monde contemporain » et renforcer celles des médias russes afin de « transmettre aux plus larges cercles de l’opinion publique mondiale les points de vue russes sur les processus internationaux ». Le média devient ici un instrument au service du rayonnement de la puissance.
Dans son nouveau concept de politique étrangère, la Russie affirme son intention de s’opposer aux « tentatives d’utiliser le concept de la défense des droits de l’homme comme un outil de pression politique et d’ingérence dans les affaires intérieures des États, notamment afin de les déstabiliser » et d’y renverser les régimes. On voit ici l’effet miroir de l’intervention en Libye.
Quant à l’OTAN, son élargissement reste perçu de façon négative : il est considéré comme une menace potentielle, au même titre que les deux types de terrorisme, le terrorisme intérieur et le terrorisme extérieur.
Dans ces documents, on note peu de références au Grand Nord et à la Baltique. Mais, historiquement, dans les doctrines soviétiques, la mer Baltique et la mer Noire ont toujours été perçues comme des mers fermées, sur lesquelles il fallait exercer un contrôle militaire et posséder une supériorité.
Le ministère russe de la Défense a communiqué sur le fait qu’il entendait développer des bases et des implantations militaires dans le Grand Nord. Cette région polaire a toujours été une priorité, ainsi que le montre le lancement récent de la construction de deux nouveaux brise-glace à propulsion nucléaire. Cependant, dans les doctrines officielles – la doctrine militaire, le concept national de sécurité –, rien n’apparaît quant à d’éventuelles intentions hostiles à l’égard des États baltes et, lorsque les autorités russes sont interrogées à propos de leurs ambitions territoriales sur cet espace autrefois annexé, elles ne prennent guère la question au sérieux : les États baltes seraient paranoïaques et prendraient un malin plaisir à développer une politique de la victime potentielle afin de s’assurer le parapluie de l’OTAN. Pourtant, d’un point de vue européen, il est de notre devoir d’envisager tous les scénarios possibles, dont celui d’une nouvelle ascension aux extrêmes dans cette région du monde.
La Russie le fait d’ailleurs elle-même et est amenée, dans ce cadre, à se poser, trois questions.
Première question : suis-je menacée par les mouvements otaniens et nationaux sur mes frontières au Nord ? La réponse, vu des Russes, est oui, car l’élargissement de l’OTAN est perçu comme une provocation.
Deuxième question : cette menace remet-elle en cause mes relations bilatérales avec les États du Nord ? La réponse est non, ainsi qu’en atteste, par exemple, la politique extérieure de la ville de Saint-Pétersbourg, qui entretient de bonnes relations économiques et politiques avec les pays voisins et les villes anciennement hanséatiques.
Troisième question : quelles réponses puis-je apporter, moi Russie, à l’élargissement de l’OTAN ? La réponse est non seulement la permanence du dialogue OTAN-Russie, ainsi que l’a énoncé le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, mais aussi la multiplication des exercices militaires de type « Vostok » ou « Caucase », qui mettent en œuvre une riposte graduée, et dans lesquels il s’agit pour la Russie de montrer toute la panoplie de ses moyens militaires.
Pour clore ce bref exposé, je dirais que la Russie est un « marteau sans maître », un Sisyphe géopolitique dont on ne voit jamais la fin.
Mme Barbara Kunz, chercheur au comité d’études des relations franco-allemandes de l’Institut français des relations internationales. Dans ma présentation, j’adopterai un angle d’approche plus régional, en mettant principalement l’accent sur la Finlande et la Suède.
Il faut tout d’abord comprendre que la région de la mer Baltique présente une unité stratégique, mais que l’on y trouve des acteurs relativement différents : la Russie, que vient d’évoquer M. Kalika, notamment avec l’« exclave » de Kaliningrad et la base navale de Mourmansk, qui ont une certaine importance stratégique dans la région ; six États membres de l’OTAN, à savoir les trois États baltes, la Pologne, le Danemark et l’Allemagne ; deux pays qui ont choisi une politique de non-alignement militaire, la Finlande et la Suède.
Concernant la perception des menaces, il y a aujourd’hui une vision relativement unifiée autour de la mer Baltique, ce qui n’a pas toujours été le cas : la Russie est perçue par tous ces acteurs comme une menace, du moins potentielle – bien que les évaluations de la gravité de la situation varient toujours. On entend souvent à ce propos les représentants des États baltes et de la Pologne, mais on trouve aussi la confirmation de cette perception dans les Livres blancs publiés récemment en Suède, en Finlande et en Allemagne. La région a suscité beaucoup d’intérêt ces derniers temps, notamment de la part de think tanks américains, qui ont rédigé des rapports. La question au cœur de la réflexion est souvent celle de la « défensibilité » des pays baltes.
Examinons la situation de plus près : quels sont les enjeux de sécurité dans la région, notamment par rapport à la Russie ? L’enjeu est tout d’abord la sécurité des pays riverains de la mer Baltique, principalement des États baltes et de la Pologne, mais on nourrit aussi des craintes à Berlin, Helsinki ou Stockholm : ce que l’on redoute, ce n’est pas forcément une invasion classique, mais plutôt des scénarios analogues à ceux que l’on a vus en Ukraine, ou alors le fait que Moscou ne s’empare de territoires stratégiques dans la région, en particulier de l’île suédoise de Gotland. Selon le ministre suédois de la Défense, Peter Hultqvist, celui qui contrôle Gotland contrôle l’accès à la Baltique par la mer et par les airs. Plus largement, ne l’oublions pas, ce sont la crédibilité de l’OTAN et celle des États-Unis en tant que puissance mondiale qui sont en jeu dans la région.
Quelles réponses tente-t-on d’apporter à cette situation ?
On tente tout d’abord d’apporter des réponses au niveau national, en augmentant les budgets de défense – ainsi que nous le constatons tout autour de la mer Baltique – et en essayant de renforcer l’outil de défense. Je n’insiste pas sur les aspects nationaux, dans la mesure où vous allez auditionner les ambassadeurs des pays concernés à ce sujet.
Cependant, le forum principal pour débattre de ces questions demeure l’OTAN. Sans entrer dans le détail, l’OTAN a adopté une série de mesures, principalement le Plan d’action réactivité – Readiness Action Plan (RAP) – au sommet de Newport en 2014 et la Présence avancée rehaussée – Enhanced Forward Presence (EFP) – au sommet de Varsovie en 2016. Les mesures relevant de la Présence avancée rehaussée sont en train d’être mises en œuvre.
À cela s’ajoute, ne l’oublions pas, un investissement bilatéral considérable de la part des États-Unis dans le cadre de l’Initiative de réassurance européenne – European Reassurance Initiative (ERI) –, décidée par le président Obama. Celle-ci comprend notamment l’opération « Détermination atlantique » – Atlantic Resolve –, mise en œuvre depuis 2014. Entre 2016 et 2017, le budget consacré à cette imitative a été multiplié par quatre, pour atteindre 3,4 milliards de dollars. Il s’agit d’un engagement important, mais on se demande ce que le président Trump décidera quant à l’avenir de ces mesures.
L’OTAN fait beaucoup de choses, mais, dans la mesure où la région présente une unité stratégique, il faut aussi s’intéresser à deux pays qui n’en font pas partie : la Finlande et la Suède, sachant que le territoire suédois revêt une très grande importance d’un point de vue militaro-stratégique.
Après quelques hésitations initiales liées au fait que ni la Finlande ni la Suède ne font partie de l’alliance, l’OTAN a développé une vision d’ensemble de la région. L’arrivée du Norvégien Jens Stoltenberg au poste de Secrétaire général a sans doute donné une impulsion à cet égard. L’OTAN a engagé un véritable dialogue avec Helsinki et Stockholm, baptisé « 28 + 2 ». Le Conseil de l’Atlantique Nord s’est réuni dans ce format dès 2015. En mai 2016 s’est tenu un sommet des dirigeants américains et nordiques, lors duquel ils ont une fois de plus souligné leur volonté de travailler ensemble dans ce cadre. Les chefs d’État et de gouvernement se sont aussi rencontrés lors du sommet de Varsovie. Les réunions se poursuivent au niveau des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, et des échanges de vue ont lieu entre militaires sur la situation stratégique dans la région.
Cette coopération entre l’OTAN et les deux pays non-alignés s’inscrit dans une tradition de coopération très étroite qui remonte au lancement du Partenariat pour la paix en 1994. La Suède et la Finlande ont participé dans ce cadre à un grand nombre d’opérations de gestion de crise de l’OTAN. La coopération s’intensifie depuis le sommet de 2014 à Newport, lors duquel la Finlande et la Suède ont signé un accord de soutien fourni par le pays hôte – Host Nation Support Agreement (HSNA) –, qui crée un cadre juridique pour les opérations de forces étrangères sur leur territoire respectif, sans porter atteinte au principe de non-alignement militaire. Lors de ce même sommet, les deux pays ont également signé un accord dans le cadre du Partenariat « nouvelles opportunités » – Enhanced Opportunities Partnership (EOP) –, qui prévoit un programme de coopération à la carte avec l’OTAN. Trois autres pays partenaires ont signé un tel accord : la Géorgie, l’Australie et la Jordanie.
Examinons maintenant ce qui se passe à l’intérieur de ces deux pays, pour voir comment on réagit à ce nouveau risque attribué à la Russie. Si la Finlande et la Suède sont l’une et l’autre non-alignées, il convient de bien distinguer les deux cas, car leur position géostratégique, leur histoire et les formes qu’y prend le débat sont différentes.
La Finlande, qui célèbre d’ailleurs en 2017 le centenaire de son indépendance vis-à-vis de la Russie, partage avec ce pays une frontière de plus de 1 000 kilomètres. Elle a une approche relativement pragmatique, qui s’explique sans doute par son histoire : on perçoit la logique du petit pays qui ne peut pas se permettre d’irriter son grand voisin. Néanmoins, le Livre blanc finlandais, publié en juin 2016, est relativement clair à propos de la Russie : « Durant les dix dernières années environ, la Russie, à travers ses actions et ses interprétations, a défié l’essence du régime européen de sécurité et l’a déstabilisé. »
Si l’on observe le débat interne et les réactions en Finlande, on constate que l’annexion de la Crimée et les actes russes dans la Baltique n’ont pas véritablement eu d’impact direct sur la politique de sécurité, dans la mesure où, en Finlande, on n’est jamais allé jusqu’à dire que la géopolitique et les risques classiques étaient obsolètes ; on est sans doute moins tombé dans ce piège que dans d’autres pays européens, notamment en Suède, où l’on a vraiment cru à l’idée de la « fin de l’histoire ». Dès lors, Helsinki a toujours mené une politique de défense relativement vigilante, à plus forte raison depuis la guerre de 2008 en Géorgie. En comparaison avec la Suède, la Finlande a conservé une vision assez « traditionaliste » de la défense nationale : elle n’a jamais aboli le service militaire obligatoire et, si les dépenses militaires y ont baissé comme partout ailleurs en Europe depuis la fin de la Guerre froide, leur chute a été beaucoup moins marquée que dans d’autres pays européens. En 2016, ces dépenses se sont élevées à 1,37 % du PIB.
En matière de politique de défense, la Suède revient de loin et a ressenti un choc en 2014, au moment de l’annexion de la Crimée. Après 1991, Stockholm avait pleinement adopté le discours de la fin des menaces classiques – on avait alors parlé d’un « time out stratégique » – et une grande réforme de la défense, qui tirait les conséquences de la diminution de la menace extérieure, avait été mise en place. En 2004, la Suède a abandonné la défense territoriale pour miser sur les opérations de gestion de crise ; en 2009, elle a aboli le service militaire obligatoire. Cette politique a suscité de vives critiques : selon certains, on avait tout bonnement démilitarisé le pays et aboli l’outil de défense. Cette vision très négative devait être confirmée quelques années plus tard par des rapports officiels suédois ainsi que par le chef d’état-major lui-même, qui déclara en 2012 que les forces armées suédoises ne seraient pas en mesure de défendre le pays plus d’une semaine : à l’issue de ce délai, les Suédois auraient besoin de renforts – on pouvait se demander lesquels, la Suède étant un État non aligné.
Comme je l’ai dit précédemment, l’annexion de la Crimée a donné un véritable coup de semonce, et a conduit à prendre la décision d’accélérer la remilitarisation du pays, notamment dans le repositionnement de forces armées permanentes sur l’île de Gotland, où il n’y en avait plus depuis de longues années : le retour de ces forces, initialement prévu pour 2018, a eu lieu en septembre 2016.
La Suède et la Finlande sont parfaitement conscientes des risques géopolitiques, et du fait qu’elles ne peuvent les affronter seules. Elles cherchent donc à renforcer leur coopération avec l’OTAN, mais aussi dans le cadre de la coopération de défense nordique NORDEFCO. Parallèlement, la coopération bilatérale entre la Suède et la Finlande s’intensifie, au point de pouvoir aller pour la première fois « au-delà du temps de paix », ce qui constitue une exception au principe de non-alignement militaire – la ligne rouge dans toutes les politiques de coopération.
En dehors de la coopération avec l’OTAN, les États-Unis constituent le partenaire le plus important pour la Suède et la Finlande. Des accords bilatéraux ont été signés dans plusieurs domaines entre Stockholm et Washington d’une part, et entre Helsinki et Washington d’autre part.
Au vu de la nouvelle donne stratégique, l’adhésion à l’OTAN pourrait apparaître comme la meilleure solution. Si le gouvernement finlandais n’exclut pas cette hypothèse, il n’envisage de la mettre en œuvre dans un avenir proche. Un débat ressurgit de temps à autre en Finlande sur cette question, qui ne déchaîne cependant pas les passions. En Suède, l’éventualité d’une adhésion à l’OTAN donne lieu à un débat idéologique et politique relativement complexe, dans un contexte où le non-alignement militaire fait partie de l’identité nationale. C’est essentiellement le parti social-démocrate, actuellement au pouvoir avec les Verts, qui fait référence à un principe de neutralité dont il est le porteur historique, ce qui le conduit à exclure formellement de demander l’adhésion à l’OTAN. Cette option se trouve donc bloquée, et le restera au moins jusqu’aux élections qui auront lieu en 2018. Une idée prévaut largement à Helsinki et Stockholm, celle que l’adhésion de l’un des deux pays ne pourrait se faire sans l’autre – pour le moment, rien ne peut donc bouger en Finlande non plus.
Les politiques menées et les solutions recherchées par les gouvernements suédois et finlandais reposent en grande partie sur un engagement important des États-Unis. Or, avec la récente élection du président Trump, le degré d’implication américaine bilatérale et au sein de l’OTAN autour de la Baltique dans les années à venir constitue une inconnue, ce qui contribue à entretenir le flou sur la situation sécuritaire dans cette région.
M. Philippe Vitel. Madame, Monsieur, je vous remercie pour vos exposés intéressants et très complets. Vous concluez sur une question que nous avons tous en tête aujourd’hui, à savoir quelle sera la position des États-Unis de Trump. Sur bien des points, le nouveau président américain tient des propos contradictoires, ce qui fait que nous ne pouvons pas avoir une vision claire de la situation : tout en affirmant vouloir entretenir des relations franches et fortes avec les Russes et en menaçant de remettre en cause l’article 5 du traité de l’Atlantique nord, il ne parle pas de démanteler le système de défense antimissile américain installé en Europe, qui préoccupe tant Poutine.
Lorsqu’on se rend dans les pays baltes, on s’aperçoit que si une partie de la population vit dans la terreur de la menace russe, une autre partie – environ 40 % – est russophile.
Par ailleurs, en matière d’énergie, il me semble que l’Europe a une grande responsabilité – que ce soit dans le cadre de l’Union européenne ou de l’OTAN – puisque, lors de l’adhésion à l’Union européenne des pays baltes, on a imposé à ceux-ci qu’ils ferment rapidement leurs vieilles centrales nucléaires de type Tchernobyl sans leur apporter aucune solution de remplacement, ce qui a eu pour résultat de les rendre encore plus dépendants énergétiquement des Russes, qu’ils craignent pour d’autres raisons.
Quelle est votre position sur ces deux points ?
M. Arnaud Kalika. Pour ce qui est de la russophilie des Baltes, je crois qu’il faut se garder de considérer les pays baltes de façon uniforme, car selon qu’elle est vue d’Estonie, de Lettonie ou de Lituanie, la menace russe est perçue de manière très variée, en raison justement de la proportion de russophones. Ceux-ci sont beaucoup plus nombreux en Lettonie : Riga, où l’essentiel du commerce portuaire est aux mains de russophones, peut quasiment être considérée comme une ville russe. C’est moins le cas en Estonie. Pour ce qui est de la situation en Lituanie, un État territorialement inséré entre la Pologne, la Russie et la Biélorussie, elle est encore plus complexe, puisqu’on y trouve également une importante population polonaise.
Parmi les différents scénarios otaniens, il en est un que les Baltes craignent particulièrement, à savoir celui où une infraction de droit commun – une agression ou un viol, par exemple – commise dans une ville majoritairement russophone donnerait lieu à une escalade en termes de communication, qui ferait monter la pression à un point tel que Vladimir Poutine ne pourrait faire autrement que de réagir – soit directement, c’est-à-dire par la force, ce qui est peu probable, soit de manière indirecte, ce qui est plus probable. Une telle intervention serait alors perçue comme une ingérence dans les affaires intérieures de l’État balte concerné.
La Lituanie est particulièrement sensible à ce type de scénarios du fait qu’elle compte bon nombre de villes à majorité russophone, et que les régimes de droit administratif y sont aussi divers que les communautés en présence : régulièrement, des litiges surviennent sur la question de savoir quel régime juridique il convient d’appliquer à tel ou tel russophone – par exemple, certains se considèrent comme des apatrides parce qu’ils ne peuvent rentrer en Russie, mais ne sont pas non plus acceptés par l’État balte où ils se trouvent. La situation est donc complexe, et l’OTAN et l’Union européenne ne s’y intéressent malheureusement pas. Cela dit, il est difficile pour nous, Européens, de porter un jugement objectif sur des pays caractérisés par un éparpillement politique que nous avons du mal à percevoir.
Mme Barbara Kunz. Au sujet des minorités russophones des pays baltes, il ne faut pas sous-estimer l’importance qu’elles accordent à un passeport européen : les personnes concernées sont parfaitement conscientes des avantages attachés au fait d’être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et, de ce point de vue, l’aspect identitaire passe au second plan.
Pour ce qui est de la politique énergétique des pays baltes, j’avoue ne pas en être une spécialiste, mais lorsque j’évoque cette question sur place ou avec des experts, il est une question qui revient toujours, celle d’une véritable politique européenne de l’énergie, voire d’une union de l’énergie, qui pourrait constituer une réponse dans ce domaine.
M. Olivier Audibert Troin. Monsieur Kalika, vous avez dit que Vladimir Poutine ne se reconnaissait plus dans les valeurs européennes. Pouvez-vous nous préciser en quoi les valeurs européennes et russes diffèrent les unes des autres, et si le fait que ces valeurs soient dissemblables peut suffire à légitimer la reconstitution de la grande Russie, qui semble être le grand dessein de Vladimir Poutine depuis des années ?
Par ailleurs, la position incertaine du nouveau président américain au sujet de l’implication des États-Unis au sein de l’OTAN ne vous paraît-elle pas de nature à favoriser une recomposition des relations entre l’Europe – notamment la France, très impliquée en matière de défense – et la Russie, cette dernière pouvant se sentir les mains beaucoup plus libres sur sa frontière ouest ?
M. Arnaud Kalika. Quand Vladimir Poutine déclare ne plus se reconnaître dans les valeurs européennes, je pense qu’il fait référence au fait que, vue de la Russie, l’Europe a toujours été considérée comme un modèle d’attraction sur les plans culturel et économique, mais pas sur le plan politique. Perçue comme un impératif en Europe, la démocratie n’en est pas un aux yeux de l’élite actuellement au pouvoir à Moscou. Pierre Hassner a utilisé le terme « démocrature » pour désigner les États tels que la Russie, qui ne font que se parer de quelques atours de la démocratie, par exemple en organisant l’élection du président au suffrage universel, mais ne respectent pas suffisamment les libertés et ne font pas aux contre-pouvoirs une place suffisante pour être considérés comme de vraies démocraties.
Quand Vladimir Poutine voit que les États européens accordent la priorité aux « grands principes » que sont la liberté et l’égalité, cela ne fait que le conforter dans l’idée d’un Occident qui, faute d’avoir pris la bonne voie, serait en plein déclin – dont il voit l’un des symptômes dans l’instauration du mariage pour tous en France. Cela dit, ce n’est pas parce que l’Europe n’est plus un modèle que l’Asie en est un. Le vrai modèle, c’est celui que la Russie n’aurait jamais dû cesser de suivre, à savoir le modèle russo-russe. À l’appui de sa position, Vladimir Poutine fait appel à des théories développées par des philosophes slavophiles du xixe siècle, selon lesquels la voie russe constituerait une voie alternative à l’Asie et à l’Europe.
Il existe d’autres théories, plus violentes : je pense aux théories eurasiennes, qui considèrent que l’Eurasie a vocation à devenir le centre de gravité du Heartland, voire du Rimland. Aujourd’hui, le monde russe peut être tenté de chercher le modèle à suivre dans ces théories, partant du principe que celles qui ont été mises en œuvre n’ont pas prouvé leur bien-fondé : selon Vladimir Poutine, le spectacle du monde prouve que la Russie a eu raison de suivre une autre voie que la voie occidentale.
Lors de son discours devant le Bundestag, le 25 septembre 2001, Vladimir Poutine avait pourtant fait part de sa volonté de faire bloc avec l’Occident – certes, dans le contexte immédiat de l’après-11 septembre 2001 – et d’adhérer à ses valeurs. Ceux qui connaissent la Russie savent qu’elle réagit souvent de manière assez brute aux événements qui surviennent. La voie russe qui constitue aujourd’hui la politique de Vladimir Poutine n’est pas née spontanément, mais constitue une espèce d’improvisation politique au contexte actuel, s’inspirant de l’histoire russe et des théories slavophiles.
M. Olivier Audibert Troin. Le fait que le peuple russe se taise signifie-t-il qu’il approuve ?
M. Arnaud Kalika. Le peuple russe se tient derrière son leader, dont la popularité oscille entre 50 % et 80 % – des chiffres qui ont une valeur toute relative, car les instituts de sondages ont du mal à travailler en Russie. Globalement, le peuple russe est patriote, il a la Russie chevillée au corps : vous ne verrez jamais un Russe, où qu’il vive, critiquer son drapeau – les événements de Crimée l’ont montré, même si ce phénomène n’est pas toujours bien compris en Occident, peut-être parce que les journalistes peinent à le saisir. Quand, dans le concept de politique étrangère et dans la doctrine d’information, on lit aujourd’hui que les médias russes doivent être l’instrument d’une sorte de communication d’influence – en d’autres termes, il ne faut pas critiquer la Russie, et veiller à ce que les journalistes russes à l’étranger soient bien traités et ne soient pas entravés dans leur communication –, il ne s’agit pas d’autre chose que d’une forme de patriotisme. En même temps, cela n’est pas sans rappeler les sociétés décrites par George Orwell dans 1984 ou encore par Ievgueni Zamiatine dans plusieurs de ses ouvrages, où tout est transparent, tout figure noir sur blanc dans les textes, qui contiennent toutes les réponses.
M. Jacques Lamblin. Vous avez évoqué la présence d’une population russophone assez importante dans les pays baltes. J’aimerais savoir si, à l’inverse, il existe une population non russophone dans l’enclave russe de Kaliningrad, et le cas échéant si la présence de cette population pose également des problèmes – résultant plutôt, cette fois, de son appartenance à l’Europe.
Par ailleurs, pouvez-vous nous préciser si la politique occidentale, en particulier américaine, pratiquée après la fin de l’empire soviétique et avant l’émergence de Poutine, qui a consisté pour l’Occident à pousser son avantage au maximum sur le plan stratégique en Europe orientale, en multipliant les contacts et les interventions auprès des pays récemment sortis du bloc soviétique à un moment où la Russie était en situation de faiblesse, a pu être ressentie comme une agression par le peuple et les autorités russes, et avoir pour conséquence d’amplifier la réaction nationaliste défensive de la Russie ?
M. Arnaud Kalika. Je ne pense pas que Kaliningrad présente un effet miroir avec la situation des États baltes. L’enclave – ou l’exclave, comme disent certains experts – de Kaliningrad est un poste avancé de la Russie sur la Baltique, tout comme Saint-Pétersbourg était une fenêtre ouverte sur l’Europe. On a beaucoup écrit sur Kaliningrad et le déploiement du système de missiles Iskander – dont personne ne connaît l’ampleur exacte, mais qui implique un déni d’accès sur toute cette zone. En tout état de cause, la modernisation des matériels militaires présents à Kaliningrad et de la flotte déployée sur la Baltique n’a pas été une priorité de l’État russe, alors qu’en Crimée, la flotte et les infrastructures militaires ont fait l’objet d’un gros effort de modernisation au cours des dernières années.
Pour ce qui est des populations, les problématiques de Kaliningrad sont plutôt d’ordre sociétal. En Occident, on parle de l’enclave comme d’une « zone grise » propice aux trafics en tout genre et qui serait également un haut lieu du blanchiment et du transit de fonds illégaux vers d’autres destinations. Pour les autorités russes, il ne s’agit pas du tout d’une zone grise, mais d’une zone sous contrôle, qui cherche des débouchés afin de se développer économiquement ; en tout état de cause, Kaliningrad est tenue par le centre, c’est-à-dire par Moscou.
Pour ce qui est de votre deuxième question, ce sont plutôt la perspective d’un élargissement de l’OTAN et le déploiement d’une défense antimissile, notamment du système américain installé en Roumanie en 2016, que la Russie dit ne pas comprendre. Ces actes sont interprétés par la Russie comme une menace directe contre elle, et contribuent à amplifier le mouvement de cohésion nationale. Les Russes estiment que l’image de la citadelle assiégée n’a rien d’un fantasme, mais correspond pour eux à la réalité, puisqu’ils ont à faire face à l’OTAN et à la défense antimissile sur le flanc ouest, et à de nombreuses incertitudes sur le flanc sud – si la Crimée et la mer Noire sont désormais sous contrôle, l’Iran et la Turquie sont des partenaires d’une fiabilité toute relative ; enfin, sur le flanc est et aux marges asiatiques, la Chine, avec laquelle ils ont signé un accord de partenariat stratégique prévoyant des exercices communs de sécurité et de défense, est censée être un allié, mais dont on peut se demander s’il est d’une loyauté à toute épreuve. Les tenants des théories occidentalistes vous diront, à partir du constat que je viens de dresser, que la Russie est nécessairement européenne, ce qui justifie que l’on parle de la Russie d’Europe. Vladimir Poutine, lui, considère que la Russie est à la fois européenne et asiatique, mais avant tout russe, et qu’elle suit sa propre voie.
Enfin, avant de vous répondre au sujet de Donald Trump, je dois vous dire que Vladimir Poutine déploie une géopolitique de l’ubiquité en termes de communication : il fait preuve d’une volonté manifeste de monopoliser les médias, mais aussi d’anticiper les coups. Ce joueur d’échecs sait que, pour gagner, il faut certes avoir un plan stratégique au départ, mais aussi et surtout savoir mettre en œuvre une somme de tactiques. Ainsi, ayant perçu que l’élection de Trump était l’un des futurs possibles – peu probable, mais ne pouvant être écarté –, il a envisagé cette hypothèse et mis en œuvre une politique de communication très prophylactique, qui a anticipé cette élection à coup de tweets et de tribunes dans la presse, y compris dans le New York Times. Le message délivré était clair : le président russe se montrait euphorique à la perspective de l’élection de Trump, et prédisait quasiment la Troisième Guerre mondiale dans l’hypothèse de l’arrivée de Clinton au pouvoir ! Bien évidemment, l’élection de Trump a fait revenir les colombes de la paix.
M. Philippe Vitel. L’obsession actuelle des Américains, ce sont les fake news qui, circulant dans le monde entier, peuvent avoir des effets déstabilisants très importants. Je viens de lire un livre russe traitant de la désinformation comme arme de guerre, qui montre bien le danger représenté par ce phénomène.
M. Arnaud Kalika. Effectivement, c’est l’effet miroir en termes de communication.
Mme la présidente Patricia Adam. Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre intervention qui a éclairé les travaux de notre commission.
La séance est levée à dix-huit heures quinze.
*
* *
Membres présents ou excusés
Présents. – Mme Patricia Adam, M. Olivier Audibert Troin, M. Nicolas Bays, M. Daniel Boisserie, Mme Isabelle Bruneau, M. Jean-David Ciot, M. David Comet, M. Nicolas Dhuicq, M. Jacques Lamblin, M. Christophe Léonard, M. Alain Moyne-Bressand, M. Philippe Vitel
Excusés. – Mme Danielle Auroi, M. Claude Bartolone, M. Philippe Briand, M. Jean-Jacques Bridey, M. Jean-Jacques Candelier, M. Guy Delcourt, Mme Carole Delga, M. Yves Foulon, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Serge Grouard, Mme Edith Gueugneau, M. Francis Hillmeyer, M. Éric Jalton, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Frédéric Lefebvre, Mme Lucette Lousteau, M. Alain Marty, M. Jean-Claude Perez, M. Gwendal Rouillard, M. François de Rugy
Source: Assemblée nationale.