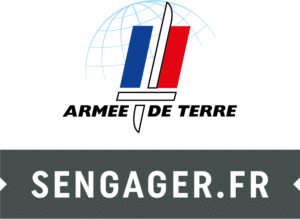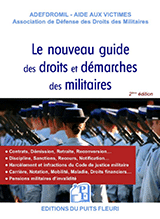Débat sur les violences faites aux femmes
M. le président. L’ordre du jour appelle le débat sur le rapport de la délégation aux droits des femmes et sur les violences faites aux femmes.
La conférence des présidents a décidé d’organiser ce débat en deux parties. Dans un premier temps, nous entendrons les orateurs des groupes, puis le Gouvernement. Nous procéderons ensuite à une séquence de questions-réponses.
Je vous rappelle que la durée des questions, ainsi que celle des réponses, est limitée à deux minutes, sans droit de réplique.
La parole est à Mme Pascale Crozon.
Mme Pascale Crozon. Monsieur le président, madame la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, mes chers collègues, le 3 décembre 2015, la cour d’assises de Blois confirmait la condamnation de Jacqueline Sauvage à dix ans de réclusion criminelle pour avoir tué son mari, après avoir subi plusieurs décennies de violences conjugales et familiales. C’est dans le contexte de ce jugement, qui a soulevé une profonde émotion collective, que la délégation aux droits des femmes a jugé utile d’auditionner juristes, associations et acteurs institutionnels pour faire le point sur la protection et l’accompagnement des femmes victimes de violence.
Notre rapport n’est toutefois pas dicté, madame la ministre, par la nécessité de répondre à cette émotion. Il entend, bien au contraire, examiner les différentes propositions qui ont surgi dans le débat public, ainsi que l’opportunité de modifier notre législation pénale, à la lumière des actions et des résultats enregistrés par les pouvoirs publics depuis la loi du 9 juillet 2010 sur les violences faites aux femmes.
L’histoire de Jacqueline Sauvage, c’est l’histoire, tout à la fois tragique et banale, que vivent plus de 200 000 femmes en France, selon l’INSEE ; celle de violences qui interviennent dans le déni, dans le silence, dans l’impunité, alors même que « tout le monde savait » ; celle de femmes qui, confrontées à une société qui ferme encore bien trop souvent les yeux, s’enferment dans une spirale de la peur, où se mêlent la douleur physique et la recherche d’excuses, l’angoisse pour sa vie et celle de ses enfants et l’auto-persuasion que les choses vont changer. C’est l’histoire de l’emprise, qui conduit ces femmes à ne bientôt plus voir d’autre issue que la mort, la leur ou celle de leur conjoint.
Si je veux saluer la décision d’humanité prise par le Président de la République à l’égard de Mme Jacqueline Sauvage, je veux dire également l’inquiétude que m’inspire l’idée de « légitime défense différée », que nous avons particulièrement étudiée dans nos travaux. En réalité, rien ne serait pire que de légitimer cette spirale et cet enfermement destructeur. Rien ne serait pire que d’envoyer le signal que les victimes de violences ne peuvent compter que sur elles-mêmes et doivent se faire justice par elles-mêmes. En effet, lorsque nous en arrivons à devoir mettre en cause la responsabilité individuelle d’une victime, c’est que nous avons failli dans notre responsabilité collective de la mettre en sécurité.
Si nous devons mieux comprendre et prendre en charge les situations d’emprise dans notre réponse pénale, c’est en amont que nous devons protéger et accompagner les victimes de violences, pour prévenir ces drames. Libérer la parole des victimes pour que la honte change de camp et que la société ne tolère plus ces violences, tel est bien l’objectif prioritaire des politiques que nous menons et qui, peu à peu, portent leurs fruits. Je citerai un seul chiffre pour illustrer cette évolution, madame la ministre, celui des 50 780 appels enregistrés en 2014 par le 3919, ce qui représente un doublement en une année – tendance qui devrait se confirmer en 2015.
Mais aujourd’hui encore, seules 16 % de ces victimes portent plainte contre leurs agresseurs. C’est sur ce chiffre que nous devons désormais travailler, qui pose la question de ce que nous faisons de la parole de ces femmes. L’enjeu, pour nous, ce doit être celui de l’accompagnement. Tout acteur susceptible d’identifier une situation d’emprise ou de violence – policier, gendarme, avocat, magistrat, mais aussi médecin, travailleur social, enseignant – doit être formé à leur détection et être en mesure de les comprendre ; il doit être capable d’informer les victimes sur leurs droits, mais aussi de les orienter et de les accompagner dans le processus de maturation qui leur permettra de sortir de cette situation. C’est pourquoi nous vous demandons des actes forts, en prévoyant dans la feuille de route de chaque ministère des objectifs chiffrés de personnels formés à ces situations.
Il demeure tout aussi impératif de mieux suivre le parcours judiciaire de chaque victime ; il importe que les classements sans suite ou les déclassements soient encadrés et strictement motivés ; que l’accès des victimes aux unités médico-judiciaires soit assuré et que les circuits de signalement et de communication entre les différents acteurs judiciaires soient clarifiés.
Il nous faut enfin avoir le courage de nommer ces phénomènes. Les récentes affaires ne doivent pas nous faire perdre de vue que les premières victimes de meurtres conjugaux restent les femmes elles-mêmes : avec 134 décès en 2014, ces meurtres représentent un homicide sur cinq dans notre pays. Et, précisément, le terme universaliste d’homicide tend à noyer cette réalité, à ne pas en prendre la mesure, comme si tous les meurtres commis participaient d’une seule et même logique, ou si tous étaient équivalents. Voilà pourquoi je souhaite que les meurtres commis à l’encontre de femmes, parce qu’elles sont des femmes, soient nommés « féminicide » car, comme le disait Simone de Beauvoir : « Nommer c’est dévoiler. Et dévoiler, c’est déjà agir. » (Applaudissements sur tous les bancs.)
M. le président. La parole est à M. Guy Geoffroy.
M. Guy Geoffroy. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui le 29 mars 2016. Il y a un peu plus de dix ans, le 23 mars 2006, nous votions définitivement, dans cet hémicycle, la première des deux grandes lois de ce siècle contre les violences faites aux femmes.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Très juste !
Mme Catherine Coutelle. C’est vrai.
M. Guy Geoffroy. Cette loi faisait suite à un travail engagé par nos collègues sénateurs, et que nous avions poursuivi dans cette assemblée, en particulier au sein de la délégation aux droits des femmes, que présidait à l’époque Marie-Jo Zimmermann.
Nous avions décidé de nous appuyer sur une étude essentielle, l’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France – ENVEFF – qui avait révélé à la population de notre pays ce que nous voulions ignorer, collectivement. La violence anonyme que nous avions laissée s’installer et l’hypocrisie collective qui caractérisait alors notre pays nous amenaient en effet à considérer que les violences faites aux femmes dans la sphère familiale relevaient, justement, d’une sphère intouchable, à laquelle la puissance publique ne pouvait et, pire, ne devait pas accéder.
En tant que responsables publics, nous avons décidé tous ensemble – gauche, droite et centre confondus – de mettre sur la place publique la question majeure de la violence conjugale sous toutes ses formes et de la traiter, car elle constitue la principale cause de délinquance dans notre pays : 10 % des femmes d’une génération ont été, sont ou seront victimes, un jour ou l’autre, d’une manière ou d’une autre, d’une violence au sein de leur couple, du fait de la volonté du conjoint violent de diminuer, d’abaisser, de détruire la femme dans ce qu’elle est, dans son identité, dans son authenticité, dans son droit à l’égalité.
La première loi, celle à laquelle j’ai fait référence et dont j’ai eu le grand honneur d’être le rapporteur dans cette assemblée, a permis de franchir des étapes importantes. Reconnaître, comme nous l’avons fait il y a dix ans, la possibilité qu’un viol soit commis au sein d’un couple, ce n’était pas évident – certains parlementaires ne voulaient d’ailleurs pas s’attaquer à ce problème. De même, ce n’était pas rien que de reconnaître, comme nous l’avons fait, que les ex-conjoints pouvaient également avoir à répondre de ces violences conjugales et que tout fait relevant de la même problématique, même commis des années, voire des décennies, après le drame vécu par une femme victime de violence, devait se voir appliquer des circonstances aggravantes.
La seule chose que nous n’ayons pas réussi à faire en 2006, parce que les esprits n’étaient pas mûrs, nous y sommes parvenus quatre ans plus tard en adoptant la loi du 9 juillet 2010, avec les députés ici présents et Danielle Bousquet, dont je salue l’action à nos côtés et à la tête de la mission d’information. Au-delà de la violence physique, des morts ou des paralysies dont souffrent à vie toutes ces femmes victimes de violences et qui sont l’horreur même, cette loi reconnaît le flot incessant des violences psychologiques invisibles mais si brutales, sauvages et injustes qu’elles réduisent à néant les espoirs de si nombreuses femmes dans notre pays. Cette grande et belle loi est venue parfaire le dispositif par la mise en place de l’ordonnance de protection, la reconnaissance de l’existence du délit de violence psychologique et grâce à plusieurs mesures permettant de reconnaître, partout sur le territoire, le besoin impératif de lutter de toutes nos forces contre ce fléau. Il nous reste beaucoup à faire. Non que rien n’ait été fait, mais parce que ces deux lois sont riches de dispositifs si prometteurs qu’il y a toujours une marge de progression.
Pour terminer mon propos, je voudrais évoquer trois sujets en particulier. Premièrement, l’ordonnance de protection. Nous avons constaté avec Danielle Bousquet que ces dispositions étaient entrées en vigueur, mais de manière timide et inégale, et trop souvent imparfaite. Il serait utile de faire le point aujourd’hui et d’améliorer la situation, tant certaines juridictions peinent encore à reconnaître cette avancée considérable qu’est l’ordonnance de protection. Deuxièmement, les violences psychologiques. Malgré le travail formidable fait pour nous et avec nous par la Chancellerie en 2010, beaucoup de juges peinent à reconnaître les éléments permettant de caractériser cette infraction et de la punir. Or nous savons que l’horreur, ce sont les violences psychologiques qui précédent immanquablement les violences physiques et conduisent trop souvent à la mort. Dernier sujet, l’hébergement des femmes victimes de violence avec leurs enfants. Lorsque la femme n’a pas le choix de quitter le domicile conjugal, même si la loi prévoit que c’est au mari violent de le quitter, elles se retrouvent souvent, lorsqu’elles ont des enfants, dans une situation impossible et sont victimes d’une double peine : non seulement elles quittent le domicile, mais elles voient aussi leurs enfants confiés à d’autres, à des familles d’accueil, car aucun dispositif national n’est véritablement appliqué à l’échelle locale.
Je tiens à appeler votre attention, madame la ministre, sur ces quelques sujets sur lesquels nous devons avancer. Je crois que l’unanimité qui a toujours été de mise au sein de cette assemblée nous permettra de progresser autant que nous le souhaitons. Quoi qu’il en soit, seize ans après l’ENVEFF, beaucoup reste à faire et beaucoup a été fait, mais nous n’avons pas à rougir de tout ce que nous avons décidé de mettre en œuvre, sous différents gouvernements, et qui fait l’honneur de la représentation nationale. (Applaudissements sur tous les bancs.)
M. le président. La parole est à Mme Maina Sage.
Mme Maina Sage. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, mes chers collègues, si la législation a évolué de façon positive ces dernières années, les violences faites aux femmes, ancrées dans une inégalité profonde, persistante, entre les femmes et les hommes, demeurent omniprésentes dans notre société, et les outre-mer ne sont pas épargnés. Les chiffres, sans cesse rappelés, ont toujours la même résonance. Aujourd’hui encore, une femme meurt tous les 2,7 jours, victime de son conjoint. Selon Mme Salmona, spécialiste en mémoire traumatique, cette réalité fait malheureusement encore l’objet d’un déni massif. Pourtant, plus de 200 000 femmes de 18 à 75 ans subissent des violences physiques et sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire. Seules 10 % d’entre elles portent plainte.
Ces chiffres sont la preuve que le combat contre les violences faites aux femmes est plus que jamais d’actualité. Drame humain avant tout, ces violences sont aussi, ainsi que l’indique à juste titre notre collègue Pascale Crozon dans son rapport d’information, une « question politique centrale ». En France, comme l’a rappelé à l’instant M. Geoffroy, beaucoup a déjà été accompli pour améliorer la prévention et la répression de telles violences : la loi du 9 juillet 2010, avec notamment l’ordonnance de protection, qui fournit un cadre d’ensemble aux femmes victimes de violences, ou encore la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, plus récemment débattue dans cet hémicycle.
Au-delà du bilan des dernières années, le rapport mentionne de récentes affaires qui, il est vrai, ont fait naître de nouvelles interrogations. À la fin de l’année dernière, les attaques commises contre des femmes dans plusieurs villes européennes ont attesté d’une forme de violence dépassant la sphère privée et familiale. L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné lors d’une réunion de janvier 2016 la nécessité d’une réponse globale. Nous devons avoir une réflexion sur les moyens d’agir contre ce nouveau type de violences inacceptables.
L’affaire « Jacqueline Sauvage », femme condamnée à dix ans de réclusion criminelle pour avoir tué son mari après avoir subi des violences pendant plusieurs décennies et qui s’est vue accorder une remise de plein gracieuse en janvier dernier, nous pousse également à nous interroger. Ce jugement, qui a suscité une forte émotion collective, a mis à jour la réalité des violences faites aux femmes, qui font souvent l’objet d’un déni, sont passées sous silence ou laissées impunies.
Doit-on modifier le régime de la légitime défense ou instituer des circonstances aggravantes, lorsque des meurtres sont commis en raison du sexe ? Faut-il reconnaître le féminicide au même titre que le parricide ou l’infanticide ? Ce sont des sujets complexes. Je salue le travail réalisé dans ce rapport. Il est nécessaire de prendre du recul pour traiter de ces sujets. Doit-on assouplir à l’extrême le code pénal, au risque, selon certains, de conduire notre société à accorder une forme de permis de tuer ou un droit de se faire justice soi-même ? Dans ce combat, la sémantique est essentielle. Je tiens également à rappeler que le rapport de 2014 de Mme Pascale Vion, membre du Conseil économique, social et environnemental, aborde ces questions. En tout état de cause, la conclusion du rapport qui nous a été présenté semble raisonnable. Il faudra en débattre pour que ses dispositions soient efficaces et ne soient pas détournées de leurs objectifs. Si les réponses pénales sont importantes, la priorité est, en amont, d’assurer la protection et l’accompagnement des victimes de violences et de veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures susceptibles de prévenir ce type de drame.
En outre, il est important de permettre à toutes les victimes de pouvoir bénéficier de ces recours. Je tiens à rappeler notre proposition de loi visant à rallonger les délais de prescription. Certes, une proposition de loi a permis d’intégrer la jurisprudence dans le droit commun. Mais les agressions sexuelles ne sont pas des crimes comme les autres. Ils sont d’une nature particulière et peuvent entraîner des amnésies post-traumatiques. Les conséquences sont lourdes. Les travaux sur la mémoire traumatique de Mme Salmona montrent que, si les victimes de ne sont pas bien prises en charge, les conséquences peuvent se faire sentir pendant toute la vie et se traduire par des psychotraumatismes graves : dépressions, maladies, voire suicides.
En conclusion – j’y reviendrai au cours du débat –, nous devons mieux former les professionnels qui ont à recevoir et accompagner ces victimes. Ces notions doivent être intégrées dans la formation initiale et continue. En outre, puisque je suis issue des territoires d’outre-mer, je tiens à dire qu’il y a un véritable déficit de connaissance sur ce sujet. Nous devons absolument renforcer le réseau des délégués présents dans ces territoires. (Applaudissements sur tous les bancs.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Krabal.
M. Jacques Krabal. Je voudrais tout d’abord rendre hommage à Jacques Moignard, suppléant de la ministre Sylvia Pinel, pour le travail qu’il a réalisé dans le cadre du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et dans le sillage duquel mon intervention s’inscrit. L’évolution de notre société, mais aussi les prises de conscience successives sur les conditions de traitement des femmes nous amènent, aujourd’hui, à l’occasion du rapport de Mme Crozon, à poursuivre la marche entreprise.
Au-delà de l’évolution législative et des actions très concrètes issues des plans quinquennaux, les situations de discrimination faites aux femmes et les violences intrafamiliales restent un fléau dont l’ampleur est alarmante – votre rapport en témoigne. Victime d’homicide au sein d’un couple, une femme décède en moyenne tous les 2,7 jours en France – c’est un chiffre qui reviendra en boucle. C’est pourquoi jamais nous ne débattrons suffisamment de la question du droit des femmes et des violences qu’elles subissent.
Pourtant, quand une femme est tuée, on parle toujours d’homicide et souvent, dans les médias, ce crime est qualifié de faits divers ou de drame familial. Dans une société misogyne, où les violences masculines contre les femmes sont répandues et banalisées, la haine des femmes va jusqu’au meurtre. Rappelons également que certaines pratiques culturelles prétendent que les filles valent moins que les garçons et que dans différentes cultures, la haine misogyne tue.
Ces crimes passionnels ne sont pas des homicides ; en France, ils doivent être nommés des féminicides. Les mobiles et circonstances de ces meurtres nous en donnent la réponse. Un meurtre intrafamilial survient toujours après une longue série de violences machistes : harcèlement psychologique, violences physiques, viols, menaces de mort.
Un homme tue sa femme pour deux raisons principales, l’adultère réel ou supposé et la séparation. Il perd contrôle de son corps, elle lui montre qu’elle ne lui appartient plus. Elle veut lui échapper, il la tue. Il est temps de reconnaître que le féminicide est un crime spécifique misogyne qui doit être reconnu et jugé comme tel. Comme le disait Simone de Beauvoir « nommer c’est dévoiler, et dévoiler c’est agir ». Alors n’hésitons plus à dire les choses.
La France a ratifié le 4 juillet 2014 la convention d’Istanbul, qui avait pour objectif de protéger les femmes contre toutes formes de violence. Pourtant, notre droit ignore encore la domination entre hommes et femmes et ne prend pas encore assez en compte la portée misogyne des meurtres de femmes. Il est temps d’appliquer cette convention en reconnaissant et en luttant efficacement contre le féminicide, comme l’ont fait les pays d’Amérique latine, le premier ayant été le Costa Rica. Plus près de chez nous, l’Espagne et l’Italie ont intégré la notion de violence du genre dans leur code pénal.
Oui, il faut reconnaître le féminicide dans la loi. Pour lutter contre ces violences, il faut faciliter le dépôt de plainte. Une fois qu’elle est présentée, elle ne pourra plus être retirée et une suite lui sera donnée. Il faut aussi revoir la question des moyens de lutte contre les violences au sein du couple et de protection des femmes victimes.
Pour prévenir les drames humains, il est nécessaire de mieux assurer la prise en charge rapide et adaptée des femmes victimes de violences, et c’est bien là que le bât blesse, au-delà de l’aspect de la formation des professionnels.
Le lundi matin, dans l’Aisne, dans ma circonscription, nombreuses sont souvent les femmes battues dans ma permanence, à la recherche d’un logement. C’est la double peine pour elles. Comme en Italie, imposons l’expulsion des maris violents du domicile familial et non celle de la femme. Soutenons financièrement les victimes. Souvent, les addictions, alcool, drogue, sont associées aux violences faites aux femmes. Sur ces aspects très concrets, interrogeons-nous sur les moyens mis à disposition des collectivités. J’y reviendrai dans ma question tout à l’heure.
Sur le fond, ayons le courage de rappeler que la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ce qui conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes et prive ainsi les femmes de leur pleine émancipation.
La violence structurelle à l’égard des femmes est fondée sur le genre. C’est l’un des mécanismes sociaux, cruciaux, qui contribue à maintenir les femmes dans une position de subordination par rapport aux hommes.
Nos démocraties sont encore loin d’avoir atteint l’idéalement correct en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
La philosophe Geneviève Fraisse montre clairement que, dans l’histoire de la lutte pour l’émancipation et l’égalité des femmes, la société, que ce soit dans sa sphère publique ou dans sa sphère privée, reste fortement marquée par la séparation des genres, et il faut reconnaître qu’au-delà des progrès réalisés et des évolutions, la place dévolue aux hommes reste bien dominante.
Oui, l’égalité homme femme, c’est l’objectif pour faire reculer la violence mais aussi emporter notre société vers une société plus juste. A l’exemple des thèses de Charles Fourier, féministe convaincu, pour qui l’extension des droits des femmes est le principe général de tous progrès sociaux.
Pas de chemin pour l’émancipation des hommes et des femmes si les femmes n’ont pas la même place que les hommes.
Appeler les femmes sexe faible est une diffamation, c’est l’injustice de l’homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l’humanité, l’avenir appartient aux femmes. Comme Gandhi nous y invite, comme Aragon le citait, faisons de notre avenir le choix de non-violence envers la femme, faisons de la femme l’avenir de l’homme, un avenir plus juste, plus humain et plus fraternel. (Applaudissements sur tous les bancs.)
M. le président. La parole est à Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui des avancées et des améliorations à apporter à la politique de lutte contre les violences faites aux femmes.
Vous évoquez, madame Crozon, le cas de Jacqueline Sauvage, et vous rappelez qu’au-delà de ce seul cas, 223 000 femmes sont victimes chaque année de ces violences sous leur forme physique ou sexuelle, sans compter toutes les victimes de violences psychologiques exercées par les hommes. Je voudrais commencer en vous remerciant, chère collègue, pour ce rapport qui apporte, dans ses recommandations, des solutions concrètes pour faire reculer ces violences.
Nous le savons, les violences contre les femmes prennent racine dans un système d’oppression des hommes sur les femmes et concourent à l’assignation et à la domination de ces dernières. Parmi ces violences, je souhaiterais aborder particulièrement la question des assassinats de femmes parce qu’elles sont des femmes. Je parle ici du féminicide, un terme, et, au-delà, une prise de conscience que nous souhaiterions voir se diffuser dans notre société. En effet, il est temps que notre société adopte dès à présent un terme politique pour nommer ce qui est aujourd’hui encore occulté dans le vocabulaire courant et administratif, le meurtre de femmes à raison de leur sexe.
Pour accompagner la reconnaissance de ce phénomène, il est nécessaire que des études voient le jour, comme votre rapport nous le propose, afin que nous ayons un état des lieux précis sur les meurtres et violences commis sur les femmes à raison de leur sexe et qu’une réponse sociétale y soit apportée.
Parmi les priorités que nous devons également mettre en œuvre à la suite de ce rapport, il y a la reconnaissance de l’emprise des victimes de violences, notamment au sein du couple, et la révision à cette aune de la notion de légitime défense.
Le cas de Jacqueline Sauvage nous amène en effet à réfléchir et à étudier la possibilité de reconnaître en droit le syndrome de la victime de violences conjugales, comme le propose le collectif national pour les droits des femmes, c’est-à-dire l’état d’esprit spécifique d’une femme vivant depuis des années dans la terreur et la souffrance. Cela a été dit, il s’agit non pas d’octroyer un permis de tuer mais de nous inspirer du droit canadien, qui, aujourd’hui, propose une définition de la légitime défense permettant de prendre en compte les relations entre les deux parties, leur historique, notamment l’emploi de la force avant les faits.
Je rappellerai également quelques recommandations de ce rapport très riche qui doivent être mises en œuvre pour développer et pérenniser la prévention des violences et l’accompagnement des femmes victimes, notamment la formation des professionnels qui rencontrent ces femmes, la prévention des violences par des campagnes d’information auprès de la population, particulièrement des jeunes, et, bien sûr, la pérennisation des moyens alloués aux droits des femmes et à l’égalité.
Je souhaiterais insister sur deux points.
Le premier, c’est la nécessité d’améliorer l’application de l’ordonnance de protection puisque, selon vos estimations, le délai moyen de délivrance de ces ordonnances serait aujourd’hui de trente-sept jours, ce qui, comme vous le soulignez, est trop long pour un dispositif d’urgence.
Le second point, c’est le droit au séjour pour les femmes étrangères victimes de violences, des femmes qui ont fui, parfois au péril de leur vie, leur pays d’origine en conflit ou en guerre et qui, nouées par la peur d’être renvoyées dans ce pays, taisent les violences qu’elles subissent de la part de leur conjoint. Il est de notre devoir de prendre en compte ces situations mêlant violences conjugales et violences administratives afin de sortir de la situation actuelle qui, de fait, condamne au silence les femmes victimes de violences.
Enfin, en tant que députée mais aussi au nom de l’association des élus contre les violences faites aux femmes, il me semble urgent que la législation française évolue sur la question des élus condamnés pour violences sexistes et sexuelles contre des femmes dans le cadre de leur fonction politique ou professionnelle ou à titre personnel. Nous ne pouvons plus accepter que des représentants de la République condamnés pour violences faites aux femmes exercent leur mandat avec une forme d’impunité politique. C’est pourquoi nous demandons une nouvelle fois que ces élus soient destitués de leur fonction politique et rendus inéligibles à compter de leur condamnation.
Mme Huguette Bello. Bravo !
Mme Eva Sas. Je vous invite donc toutes et tous à réfléchir ensemble à ces éléments pour faire reculer concrètement les violences faites aux femmes. (Applaudissements sur tous les bancs.)
M. le président. La parole est à Mme Huguette Bello.
Mme Huguette Bello. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, 2010 et 2014 sont des années importantes dans la lutte contre les violences faites aux femmes. À moins de faire preuve de mauvaise foi, personne ne conteste que la loi du 9 juillet 2010 et les vingt-sept dispositions de la loi du 4 août 2014 proposent un cadre juridique global et consolidé et ont créé un arsenal varié de dispositifs à la fois pour prévenir les violences, accompagner les victimes et combattre ce fléau qui traverse les époques et les espaces.
Les chiffres sont redoutables. En France, 134 femmes ont perdu la vie en 2014 sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. Ces chiffres sont d’autant plus redoutables qu’ils ne diminuent pas. À la Réunion, le trimestre qui s’achève aura été traumatisant : quatre femmes sont mortes victimes de violences conjugales. C’est terrible.
Loin d’être un paradoxe, la coexistence de ces avancées juridiques et de ces statistiques montre une fois de plus combien les violences intrafamiliales sont spécifiques et s’inscrivent dans une longue histoire de domination et d’inégalité entre les sexes. Elle nous invite aussi à améliorer les outils existants et à continuer d’innover.
À cet égard, il apparaît important de repérer les moments critiques, ceux où les victimes sont fragilisées et encore plus vulnérables, ceux où la situation peut empirer, voire devenir dramatique.
Il ressort des témoignages des femmes elles-mêmes que déposer une plainte non seulement est une démarche difficile mais peut aussi les exposer à des représailles et n’est pas forcément un gage de protection : 41 % des femmes tuées par leur conjoint avaient déposé plainte.
Pour qu’aucune violence déclarée ne reste sans réponse comme le préconise le quatrième plan triennal en cours, il est indispensable que l’accueil des femmes victimes de violences dans les gendarmeries et commissariats figure parmi les priorités et que les protocoles-plaintes soient systématisés rapidement.
Nous savons que, lorsqu’elle intervient dans un contexte de violences, la phase de séparation est aussi une période sensible. Il existe bien sûr depuis 2010 l’ordonnance de protection, qui prévoit un ensemble complet de mesures pour assurer la sécurité physique des victimes des violences et stabiliser leur situation juridique, mais les délais de délivrance sont encore trop souvent bien trop longs. L’urgence que ces situations exigent est incompatible avec une attente de plusieurs semaines, le délai moyen étant évalué à trente-sept jours. Cet outil doit retrouver la vocation de protection et d’urgence que le législateur lui a confiée. Il ne doit ni se confondre avec un dépôt de plainte ni être obligatoirement précédé par lui.
Une autre difficulté, maintes fois soulignée, réside dans les procédures de médiation. Limitée en 2010, la médiation pénale a été strictement encadrée par la loi de 2014. Elle n’est désormais possible que si et seulement si la victime en fait expressément la demande, mais cette condition stricte ne semble pas toujours être appliquée : la médiation pénale est encore souvent proposée et parfois fortement recommandée.
La médiation familiale, elle, ne fait l’objet d’aucune restriction, d’aucune condition, ce qui n’est pas sans une certaine contradiction avec la logique qui inspire les mesures mises place en matière de violences conjugales. Le constat étant unanime pour demander la suppression de la médiation familiale dans les cas de violences, nous devons modifier au plus vite la législation. (Applaudissements.)
En outre, pour limiter les situations à risques, il est important, en présence de jeunes enfants, de généraliser rapidement les dispositifs d’intermédiation entre les parents, comme la mesure dite d’accompagnement protégé actuellement expérimentée en Seine-Saint-Denis, qui se révèle fort efficace.
Depuis le drame de Jacqueline Sauvage, nous ne pouvons plus ignorer les mécanismes d’emprise à l’œuvre dans les violences conjugales. Dans ces situations, le rôle des professionnels de la santé, comme celui de tous ceux qui interviennent aux avant-postes, est encore plus capital.
À cet égard, on n’insistera jamais assez sur l’obligation d’offrir à l’ensemble de ces professionnels une formation initiale et continue sur les multiples facettes de cette réalité. La prévention et la lutte contre les violences envers les femmes sont l’affaire de tous. La société doit protéger et informer les victimes. Lorsque celles-ci décident d’agir pour mettre fin à ces violences, elles doivent être accompagnées et ne plus avoir le sentiment d’affronter une course d’obstacles. L’accès aux différents dispositifs, notamment le téléphone « grand danger », doit être facilité.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Très bien !
Mme Huguette Bello. Nous savons, chers collègues, combien ces situations de violence qui touchent à la sphère privée et à l’intime demandent une approche appropriée et des réponses adaptées. Mais nous sommes persuadés que la honte et la culpabilité, le silence et le déni doivent changer de camp ! (Applaudissements sur tous les bancs.)
M. Guy Geoffroy. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Maud Olivier.
Mme Maud Olivier. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, chers collègues, avec les lois de 2005 et de 2010, avec la loi sur le harcèlement sexuel, avec la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans la loi sur la réforme de l’asile, dans celle sur le dialogue social ou celle relative à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité dans les transports, et bientôt avec la proposition de loi sur le système prostitutionnel, que ce soit dans des textes spécifiquement dédiés ou de façon transversale, nous avons fait clairement progresser dans notre droit la lutte contre les violences faites aux femmes.
Mais force est de constater qu’elles sont toujours d’une cruelle et inacceptable réalité. Que ce soit dans les transports en commun, au travail, au domicile ou dans l’espace public, les violences physiques, économiques, psychiques et sexuelles sont le quotidien d’un très grand nombre de femmes.
J’ai en tête le dramatique témoignage d’une femme qui cherche aujourd’hui des explications au triple assassinat qui a frappé sa famille. Sa sœur, qui avait porté plainte contre son mari violent et qui avait obtenu une ordonnance de protection, a été tuée par balles, en pleine rue, ainsi que ses deux parents, par son conjoint qui avait été laissé en liberté – et ce, malgré les signalements de la victime quant aux menaces dont elle faisait l’objet.
Aujourd’hui, en France, parmi les 130 femmes qui meurent chaque année sous les coups d’un conjoint violent, 40 % ont porté plainte. Pourtant, on sait combien cette démarche du dépôt de plainte est difficile pour les victimes de violences conjugales. L’emprise des agresseurs enferme les victimes dans le silence, la honte, la peur et la culpabilité.
Quand une société – amis, voisins, école ou encore services sociaux – est aveugle aux violences exercées par un homme sur sa femme et ses enfants pendant plusieurs années, c’est qu’elle est malade. Quand notre société laisse une victime face à son bourreau pendant plusieurs dizaines d’années, il se peut que le coup de trop, celui qui rend tous les autres insupportables, amène à se défendre, parce qu’on ne tient plus, parce que ce jour-là on craint plus que les autres jours pour sa vie.
Le terrible verdict rendu dans le procès de Jacqueline Sauvage a profondément touché. Cette femme, victime de violences pendant quarante-sept ans, de la part d’un homme que tout son entourage a décrit au procès comme très violent, a été condamnée à dix ans de prison. Au-delà de son cas personnel, la délégation aux droits des femmes a choisi d’interroger et d’approfondir le débat ouvert dans la société française autour de la légitime défense des femmes victimes de violences et de leur nécessaire protection.
Dans notre code pénal, est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte pour repousser, de nuit, l’entrée d’un agresseur par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou celui qui accomplit l’acte pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ; mais pas un individu mis en état de danger de mort permanent par une personne qu’il côtoie au quotidien. Ne pouvons-nous pas modifier le code pénal pour que l’antériorité et la nature des relations entre les personnes concernées, l’emploi ou la menace d’emploi de la force soient pris en compte dans l’évaluation de la gravité de l’acte commandé par la nécessité de se défendre ?
Malgré les lois et les plans ambitieux mis en œuvre par le Gouvernement, malgré l’action formidable des associations qui travaillent à la prévention des violences et à l’accompagnement des victimes, la dure réalité, c’est que 10 % des femmes dans notre pays sont en danger. Nous devons sans cesse nous demander comment les protéger réellement.
La violence contre les femmes résulte d’une discrimination à leur égard, tant dans le droit que dans les faits, ainsi que de la persistance d’inégalités entre elles et les hommes. Elles perdurent, parce qu’elles ne sont pas comprises comme des violences spécifiques, s’intégrant dans un continuum faisant système, mais comme des drames individuels. On le voit dans le traitement qu’en fait la presse, arguant par exemple que c’est un drame de la jalousie, ou dans les discussions, mais aussi dans notre code pénal aveugle au fait que notre société est toujours construite sur les inégalités entre les femmes et les hommes.
La délégation s’est également interrogée sur la pertinence d’aggraver dans le code pénal les violences aux personnes quand elles ont un caractère sexiste. Ne faut-il pas reconnaître dans le droit, comme pour le racisme ou l’homophobie, la spécificité des violences faites aux femmes et la gravité avec laquelle la société française les considère ? Je le répète, des femmes sont insultées, frappées ou tuées, parce qu’elles sont des femmes dans une société inégalitaire.
Je crois que, pour que la société évolue franchement sur ce sujet, il faut mobiliser l’ensemble de ses membres, mettre plus de moyens encore dans les formations des professionnels et des agents des services publics, mais aussi modifier notre code pénal en ce sens. À l’avenir, aucune violence sexiste ne doit rester sans réponse. (Applaudissements sur tous les bancs.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes.
Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes. Monsieur le président, madame la rapporteure, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, mesdames, messieurs les députés, le rapport d’information de Pascale Crozon sur les violences faites aux femmes, publié le 17 février 2016 au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, était attendu et a été salué. Je me félicite également du travail réalisé.
Ce rapport nous rappelle que les femmes subissent des violences de manière massive, des violences protéiformes, mais constituant un véritable continuum, partant des représentations dégradantes jusqu’aux crimes sexuels et aux meurtres conjugaux. Les violences conjugales sont certainement la forme la plus connue des violences faites aux femmes. Chaque année, 223 000 femmes en sont victimes, et 134 en sont mortes l’année dernière.
Il y a d’autres formes de violences que subissent les femmes dans le cercle proche, les violences sexuelles notamment, puisque 84 000 femmes majeures sont chaque année victimes de viols ou de tentatives de viol et que, dans 90 % des cas, la victime connaît son agresseur. Il y a les violences dans la rue : 100 % des femmes disent avoir été victimes de harcèlement sexiste ou de violences sexuelles, selon un rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il y a les violences au travail : 80 % des femmes salariées considèrent que, dans le monde du travail, elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes. Il y a les violences économiques, comme le non-paiement des pensions alimentaires.
Toutes ces violences, diverses en apparence, sont cependant sous-tendues par la même idéologie qui structure, encore trop souvent, les relations entre les femmes et les hommes. Cette idéologie, c’est le sexisme, qui érige la différence sexuelle, biologique, en différence fondamentale entraînant un jugement sur l’intelligence, les comportements et les aptitudes de la personne qui en est victime.
Les manifestations du sexisme, ce sont les violences que j’ai décrites, mais ce peuvent être également des pratiques qui semblent anodines : des « blagues » sexistes, auxquelles on doit trop souvent rire, quitte à se forcer parce qu’elles ne sont pas toujours drôles ; une publicité ou un clip vidéo, qui représentent une femme dénudée et sexualisée pour vendre davantage de voitures ou susciter de l’audience ; une série qui laisse aux femmes des rôles plus que secondaires, voire de demeurées.
Quelles que soient leurs formes, qu’elles soient visibles ou insidieuses, conscientes ou non, ces violences ont en commun un objectif : rappeler à l’ordre, blesser, humilier, exclure, remettre les femmes « à leur place », comme l’a si bien dit Annie Ernaux. Si la situation vécue par chaque femme est singulière, il y a là un phénomène partagé par toutes les femmes, un phénomène collectif. Nous devons être sûrs de cela : il n’y aura pas d’égalité entre les femmes et les hommes, sans une lutte implacable contre toutes les formes de violences faites aux femmes. La lutte contre les violences est constitutive du combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Pour cela, il faut prévenir les violences, protéger les victimes et sanctionner les auteurs. Ceci est valable en France, et partout sur la planète. Je me réjouis du jugement rendu la semaine dernière par la Cour pénale internationale à l’encontre de Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable de crime contre l’humanité, de crime de guerre, notamment pour les viols commis par ses troupes entre 2002 et 2003 en Centrafrique. Bien sûr, beaucoup reste à faire face à l’ampleur et à la persistance des violences sexuelles dans les conflits. Mais ce jugement, c’est une étape décisive, qui marque la fin du temps de l’impunité.
L’engagement du Gouvernement est total pour faire reculer les violences faites aux femmes. De nouvelles dispositions législatives ont été votées. Dès août 2012, nous avons rétabli le délit de harcèlement sexuel. La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes de 2014 a renforcé les dispositifs de lutte contre les violences : généralisation du téléphone « grand danger » ; éviction du domicile du conjoint violent ; stages de responsabilisation pour les auteurs de violences ; et renforcement de l’ordonnance de protection.
La proposition de loi de lutte contre le système prostitutionnel est un texte historique et de progrès, qui sera adopté définitivement, ici même, la semaine prochaine, et je l’inscris parmi les textes relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes. Jamais le droit n’a été aussi complet. Faut-il aller plus loin ? C’est un vrai débat auquel il faudra associer le garde des sceaux.
Je crois aussi que la loi ne peut pas tout et que la formation de l’ensemble des professionnels, comme vous avez été nombreux à l’évoquer, est aussi une clé. Avec la MIPROF – mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains –, que nous avons créée en 2013, plus de 250 000 professionnels ont déjà été formés.
Pour faire de la loi une réalité, nous avons impulsé et mettons en œuvre trois plans d’action : le quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016 ; le premier plan de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016 ; ainsi que le plan contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes dans les transports. Le travail fourni porte ses fruits et nous pouvons observer des avancées tangibles.
Les moyens spécifiques consacrés aux violences faites aux femmes ont été doublés et s’élèvent à 66 millions d’euros sur une période de trois ans. C’est une priorité de notre action : la lutte contre les violences faites aux femmes représente près de 75 % du budget « droits des femmes » de mon ministère. Des dispositifs ont été créés pour favoriser la dénonciation des violences. Le 3919, numéro unique pour orienter les femmes victimes de toutes violences, gratuit et ouvert sept jours sur sept, a été renforcé. En 2014, plus de 50 000 appels ont été traités.
Un protocole a été établi pour réaffirmer le principe du dépôt de plainte et améliorer la réponse apportée sur le plan judiciaire et social à toute femme qui révèle une situation de violence auprès de la police ou de la gendarmerie ; 81 protocoles départementaux sont désormais signés – leur nombre a été doublé en 2015 ; 241 intervenants sociaux sont désormais présents en commissariats et dans les brigades de gendarmerie – ils seront 350 d’ici à un an – pour que la victime puisse trouver, dès sa première visite en commissariat ou dans une brigade, les réponses utiles à la rassurer sur l’hébergement, la prise en charge de ses enfants ou l’accompagnement judiciaire, social et sanitaire.
Des dispositifs ont été créés pour protéger les femmes victimes : 1 650 nouvelles solutions d’hébergement d’urgence auront été créées d’ici à 2017 – 1 147 l’ayant déjà été, 70 % de l’objectif est atteint. Le téléphone « grand danger » a été généralisé et 400 téléphones sont aujourd’hui actifs. Il y en aura 500 d’ici à la fin 2016. Je rappelle que ce téléphone portable dispose d’une touche « raccourci » préprogrammée, pour joindre en cas de grand danger un service de téléassistance accessible sept jours sur sept et permettre l’intervention la plus rapide des forces de l’ordre. Désormais, ce sont 160 espaces de rencontre qui existent et permettent la continuité des relations entre l’enfant et son père, sans nouvelle mise en danger des enfants ou du parent victime.
Comme je vous l’ai déjà dit, 250 000 professionnels pouvant être au contact de femmes victimes de violences ont été formés, dans la police, la gendarmerie et la justice, des magistrats et des avocats, mais aussi des médecins et des sages-femmes, ainsi que des travailleurs sociaux. La formation est essentielle pour améliorer la connaissance des mécanismes de la violence, notamment l’emprise, pour améliorer le repérage, l’accompagnement et la protection des victimes, et pour faciliter la création d’une culture commune et de partenariats chez l’ensemble des travailleurs en contact avec des publics susceptibles d’être soumis à des violences.
Le Gouvernement agit également contre les violences économiques. Cela est important, car souvent les violences se conjuguent. Les situations de précarité que subissent notamment les femmes cheffes de familles monoparentales sont un sujet connexe aux violences intrafamiliales. Pour cela, les crèches à vocation d’insertion professionnelle sont développées. Nous travaillons actuellement à la création d’une agence de recouvrement des pensions alimentaires, ainsi qu’à des solutions de répit en faveur des familles monoparentales, que nous expérimenterons dans plusieurs territoires.
Enfin, le Gouvernement agit pour faire reculer les stéréotypes, ces représentations qui légitiment les inégalités ou les violences, qui les banalisent et leur donnent l’apparence de normalité. Ce sont des mots, des images, des propos qui n’ont l’air de rien alors qu’ils contribuent à rendre les violences invisibles. En écho à la campagne contre le racisme lancée la semaine dernière par le Gouvernement, dont vous avez probablement vu les spots, nous pouvons dire aussi que le sexisme commence par des mots, continue par des mains aux fesses et finit par des coups, du sang et des bleus. Les mots sont importants, c’est pourquoi, à l’occasion de la soixantième session de la commission des Nations unies sur la condition de la femme, qui s’est réunie il y a deux semaines à New York, j’ai demandé que le féminicide – terme qu’a évoqué Eva Sas – entre dans le vocabulaire diplomatique, et j’ai appelé à la reconnaissance du féminicide des femmes yézidies par Daech.
Je poursuivrai le travail de fond mené depuis maintenant dix ans pour faire reculer les violences faites aux femmes en me donnant trois priorités. Je souhaite que la lutte s’enracine en pratique dans l’ensemble des territoires : tous les acteurs doivent être mobilisés pour faire reculer ces violences, notamment dans les territoires ruraux où nous identifions des zones « blanches » trop importantes en matière d’accès aux associations. En territoire rural, il est parfois plus difficile pour une femme de trouver un interlocuteur. Les associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes ne pouvant couvrir la totalité du territoire, il est nécessaire que l’ensemble des travailleurs sociaux – la maison de famille rurale, le centre social rural, ainsi que tous les services publics en contact avec les enfants, les parents et les familles – soient formés au repérage et à l’accompagnement des femmes victimes de violences intrafamiliales, notamment dans les territoires d’outre-mer.
Les violences à l’encontre des enfants représentent un autre sujet auquel je suis particulièrement sensible. Le périmètre de mon ministère me donne en effet une vue globale des violences intrafamiliales et de leurs victimes : les femmes et les enfants. Comme le note avec raison le juge Édouard Durand, protéger la mère, c’est protéger l’enfant. Des questions méritent encore d’être soulevées, par exemple sur l’exercice de la parentalité dans les situations de violence. Parfois, on pense qu’un un mari ou un compagnon violent peut rester un bon père ; peut-être, mais l’on ne saurait le présupposer et il ne faut avoir aucun a priori sur cette question.
Guy Geoffroy évoquait tout à l’heure à juste titre le silence et le tabou qui, pendant des siècles, ont entouré et isolé les femmes victimes de violences dans les familles. J’ai parfois l’impression que, s’agissant des enfants, nous en sommes encore à cette situation.
M. Guy Geoffroy. C’est vrai.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Pour avoir plusieurs fois dû évoquer l’éducation sans violence et l’absence d’utilité éducative des punitions corporelles pour les enfants, et avoir eu à répondre à des interpellations sur la question de savoir s’il faut ou non une loi pour bannir ces punitions, j’ai été très étonnée par la violence du débat public sur ces sujets. Aujourd’hui, les enfants sont, dans le cercle familial, les dernières personnes qu’on peut frapper sans subir l’opprobre collectif. En fin de compte, on a le droit de frapper les enfants pourvu que ce soient les siens et que les coups soient mesurés. Je pense pour ma part que les violences forment un ensemble. Par ailleurs, les enfants témoins de violences à l’encontre de leur mère en sont également victimes.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Très bien !
Mme Laurence Rossignol, ministre. Enfin, nous devons améliorer la prise en charge sociale, sanitaire et judiciaire des victimes d’agressions sexuelles et de viols. Dans ces combats, notre ennemi, c’est le tabou ; je n’en ai aucun quand il s’agit de protéger les femmes et les enfants victimes de violences. (Applaudissements sur tous les bancs.)
M. le président. Nous en venons aux questions, en commençant par celles du groupe SRC.
La parole est à Mme Catherine Coutelle.
Mme Catherine Coutelle. La semaine de contrôle est le moment de demander au Gouvernement comment sont menées les politiques publiques. Nous partageons l’avis de Guy Geoffroy : depuis le début du vingt et unième siècle, la France s’est dotée de lois contre les violences, sous tous les gouvernements. Deux grandes lois concernent les violences intraconjugales : celle de 2010 et celle de 2014. Depuis 2012, votre Gouvernement a beaucoup insisté sur la mise en place de politiques dans ce domaine. Mais la délégation aux droits des femmes a souvent relevé, dans bien des domaines, le manque de données chiffrées sexuées, qui empêche le législateur d’évaluer efficacement les politiques publiques et le chemin restant à parcourir.
Ce débat prend tout son sens aujourd’hui. Lors de la discussion générale, Pascale Crozon a soulevé les questionnements auxquels nos travaux se sont confrontés : faut-il encore modifier notre droit pour aller plus loin ? Quelle est l’efficacité réelle de nos politiques publiques ? Comment la loi est-elle concrètement appliquée dans les différents territoires, y compris dans les outre-mer ? Mais l’absence de données sexuées bloque souvent notre capacité d’analyse. À l’heure où 200 000 femmes déclarent chaque année être victimes de violences sexuelles de la part de leur conjoint, et où seulement 10 % des 80 000 femmes victimes de viol ou de tentative de viol par an portent plainte, comment faire appliquer la loi partout et en tout temps, pour mieux prévenir, mieux former et condamner le plus efficacement possible ?
Dans son rapport d’information, la délégation aux droits des femmes recommande la remise, par la chancellerie et par votre ministère, dans les meilleurs délais, d’une étude approfondie, chiffrée et sexuée sur l’état de la jurisprudence en matière de légitime défense – nombre de cas concernant les femmes et les hommes, éléments de droit comparé –, et sur les peines prononcées à l’encontre des femmes et des hommes auteurs de violences, et leur exécution. Madame la ministre, pouvez-vous nous apporter des réponses sur ces différents points ?
Enfin, sur un autre aspect, la délégation a révélé les dysfonctionnements de l’ordonnance de protection : délais de délivrance trop longs, hétérogénéité d’accès au dispositif dans les territoires… Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer le nombre d’ordonnances de protection délivrées sur l’ensemble du territoire ? Quels sont les délais moyens et les freins encore à lever ? Nous souhaiterions, dans la mesure du possible, profiter du projet de loi relatif à la justice du XXIème siècle pour faire adopter des amendements sur cette question.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Madame la présidente, je partage votre logique. Plus le diagnostic est précis, plus l’action est efficace. C’est la raison pour laquelle, en 2013, l’on a créé la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, dont le but est de rassembler, d’analyser et de diffuser les informations et les données relatives aux violences faites aux femmes et de contribuer à la réalisation d’études et de travaux de recherche et d’évaluation.
Vous pouvez imaginer combien peut être long le travail d’harmonisation des méthodologies de recueil des données et des définitions utilisées par les différents partenaires de la lutte contre les violences ; mais nous progressons significativement. Ainsi, la lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, publiée le 25 novembre, présente chaque année de nouvelles statistiques. Depuis 2014, le nombre de condamnations pour violences au sein du couple et violences sexuelles, ou encore celui d’ordonnances de protection sont publics. Je demanderai aux hauts fonctionnaires à l’égalité de chaque ministère, que je rencontrerai prochainement, qu’un effort supplémentaire soit fourni pour la production de statistiques sexuées.
L’ordonnance de protection, créée par la loi de 2010 et consolidée par celle de 2014, représente un dispositif exceptionnel et révolutionnaire dans le droit français, qui protège les femmes avant la commission de nouveaux faits. Pour en bénéficier, seuls sont nécessaires des éléments de preuve attestant de la vraisemblance du danger et des violences ; 1 303 ordonnances ont été prononcées en 2014, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2013. Je suis consciente que ce dispositif pourrait être davantage mobilisé, mais il faut aussi veiller à la diversité des solutions. Certaines femmes ne veulent pas rester ; en Seine-Saint-Denis, 60 % d’entre elles choisissent de bénéficier de l’ordonnance de protection.
M. Guy Geoffroy. Oui, le dispositif marche bien.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Pour accompagner la montée en puissance de la nouvelle procédure, la MIPROF a créé un outil de formation des professionnels. Celui-ci est par exemple mobilisé pour former l’ensemble des avocats et des avocates à l’occasion du 25 novembre. Nous devons continuer à progresser. Il faut notamment mener une discussion avec le garde des sceaux ; en effet, une partie des réponses se trouve dans le code pénal.
M. le président. La parole est à Mme Monique Orphé.
Mme Monique Orphé. Ingrid Gonfo, vingt-deux ans, décédée le 9 janvier 2016, Géraldine Nauche, trente-huit ans, décédée le 21 janvier 2016, Jocelyne Bègue, cinquante-six ans, décédée le 26 février 2016, Marie-Andrée Corée, cinquante ans, décédée le 8 mars 2016 : ces quatre femmes sont Réunionnaises et ont comme autre point commun d’avoir été assassinées froidement par leurs compagnons. Ces actes ne sont pas que des faits divers. Ils sont également le reflet des statistiques effrayantes que nous constatons à la Réunion. Ils ne doivent pas être vécus comme une fatalité, mais combattus grâce à des politiques publiques. Madame la ministre, je salue les initiatives du Gouvernement pour améliorer nos dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes, mais les faits survenus en ce début d’année à la Réunion peuvent faire douter de l’efficacité des politiques publiques et décourager les femmes de briser le silence.
Nous avons besoin d’organiser une importante campagne de communication pour sensibiliser la population à cette problématique et changer son regard sur les femmes. Aucune tolérance ne doit être permise face au sexisme et aux agressions. Cette campagne de communication doit toucher tous les publics : les établissements scolaires, le milieu du sport, les médias, l’éducation populaire, la publicité… Il faut communiquer davantage sur la possibilité de recourir au numéro vert 3919 ou au « téléphone grave danger » qui permet aux femmes de demander de l’aide en cas de violences. Il faut que les mains courantes et les plaintes déposées au commissariat soient mieux prises en compte et saisies par la justice, pour que les femmes aient le sentiment que l’État les protège lorsque leur intégrité physique et leur dignité sont atteintes. Je milite enfin pour que l’enfant ait un statut de victime et pour la remise en cause de l’autorité parentale du parent auteur de violences. Madame la ministre, pouvez-vous nous aider à mettre en place cette campagne de communication dans nos territoires ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Madame la députée, les chiffres terribles relatifs au nombre de meurtres de femmes déjà commis dans votre département depuis le 1erjanvier ne doivent pas nous faire douter des politiques publiques. Au contraire ! Malheureusement – les Espagnols en ont fait la cruelle expérience –, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, les résultats ne sont pas aussi rapides que la mise en œuvre des politiques publiques. Il faut au contraire soutenir et renforcer celles-ci en cas de chiffres aussi dramatiques.
Le numéro 3919 et les dispositifs de proximité et de prise en charge des victimes ont été renforcés. Tous les départements d’outre-mer, ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon disposent, depuis 2015, d’accueils de jour qui complètent l’action des lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation. La réponse pénale a également été systématisée : des protocoles de plainte, qui organisent la réponse apportée à toute femme qui révèle une situation de violence auprès de la police ou de la gendarmerie, ont été signés à la Réunion, en Martinique et en Polynésie. Le « téléphone grave danger » est actuellement expérimenté à la Réunion ; quinze y sont d’ores et déjà actifs, et huit en Guadeloupe. L’expérimentation sera prochainement lancée en Martinique.
Nous observons des avancées notables, notamment dans votre circonscription de la Réunion, madame Orphé. L’augmentation des dépôts de plaintes de 35 % depuis 2007 représente un chiffre encourageant. Plus les femmes portent plainte, plus elles parlent, et mieux on peut les accompagner. Parmi les autres faits positifs, citons l’augmentation de 25 % du nombre de femmes hébergées entre 2013 et 2014 et le nombre de femmes accueillies dans les deux accueils de jour en 2014 : près de 500. Enfin, le nombre de procédures civiles de protection lancées pour protéger les femmes victimes de violences a été multiplié par trois depuis 2011.
En matière de statistiques, les enquêtes sont indispensables. J’attache une attention particulière à la future enquête « Violences et rapports de genre », VIRAGE, qui me semble représenter la seule source fiable de statistiques et qui nous fournira des indicateurs utiles.
C’est pourquoi le ministère des droits des femmes a très largement contribué à son financement, à hauteur d’un million d’euros entre 2014 et 2015, ce qui représente une somme substantielle. Dès 2015, avec le ministère des outre-mer, nous avons apporté notre soutien financier à l’Institut national des études territoriales, l’INET, pour engager une phase exploratoire et préparatoire de l’enquête « Violences et rapports de genre » dans les départements de La Réunion et de la Guadeloupe. Là aussi, des financements supplémentaires seront mobilisés pour que l’enquête soit menée dans votre département. Cette phase préliminaire permettra de réaliser un état des lieux des connaissances et d’adapter le questionnaire métropolitain au contexte ultramarin. Elle est en cours et se poursuivra au cours de l’année 2016. Vous le voyez, le Gouvernement est attentif à ce que les territoires ultramarins soient mobilisés et que la politique publique que nous menons soit déclinée et, s’il le faut, adaptée aux territoires ultramarins et aux femmes qui y subissent des violences.
M. le président. Nous en venons aux questions du groupe Les Républicains.
La parole est à Mme Marie-Jo Zimmermann.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Madame la ministre, je voudrais vous interpeller sur les politiques publiques menées à l’égard du conjoint violent. Il me semble, en effet, que c’est un point que nous n’évoquons pas suffisamment. Nous parlons des violences faites aux femmes, des dispositions votées et des dispositifs mis en place en leur faveur, mais que fait-on s’agissant de l’éviction du conjoint violent ?
En effet, dans la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, qui vise à améliorer la réponse pénale à ces violences, nous avions voté une généralisation de la circonstance aggravante, comme l’a très justement rappelé Guy Geoffroy, ainsi qu’une mesure d’éloignement du conjoint violent. Je tiens d’ailleurs à rendre hommage à Guy Geoffroy et à Danielle Bousquet, qui, par-delà leurs divergences politiques, ont jeté les bases des lois du 4 avril 2006 et du 9 juillet 2010, votées à l’unanimité.
On est progressivement monté en puissance, en mettant en place des mesures d’urgence, telles que l’éviction du conjoint violent. Mais cela ne suffit pas. En 2014, nous espérions une mesure supplémentaire : la responsabilisation du conjoint violent. Le procureur de Douai, que nous avions auditionné au sein de la délégation aux droits des femmes et de la commission des lois, mettait en évidence le travail accompli à l’égard des conjoints violents.
Madame la ministre, un certain nombre de mesures ont été votées en faveur des victimes, dont il faut améliorer l’application. Mais que fait-on réellement, dans le cadre des politiques publiques, concernant la responsabilisation du conjoint violent ?
M. Guy Geoffroy et Mme Maina Sage. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Madame la députée, vous avez évoqué l’ensemble des lois qui posent le principe de l’éviction du conjoint et du maintien de la victime dans le logement du couple, lorsque celle-ci le souhaite, ce qui n’est pas toujours le cas. Cela constitue un progrès.
Mme Nicole Ameline. Institué en 2004 !
Mme Laurence Rossignol, ministre. Oui, depuis 2004, en présence d’un danger, le procureur doit systématiquement évoquer la possibilité de l’éviction du conjoint et peut même lui demander de payer tout ou partie du loyer, ce qui est aussi important.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Oui !
Mme Laurence Rossignol, ministre. Toutefois, l’application de ce dispositif dans les territoires est freinée par les difficultés que nous éprouvons à obtenir des statistiques fiables.
Je ne cherche pas, en employant cet argument, une quelconque échappatoire : nous ressentons réellement des difficultés en la matière.
Mme Marie-Jo Zimmermann. C’est vrai !
Mme Laurence Rossignol, ministre. Nous n’avons pas de culture totalement mature, en France, de la statistique et de l’évaluation. Une étude spécifique a été demandée à la sous-direction de la statistique et des études du ministère de la justice, qui possède les données pertinentes, afin d’effectuer une collecte et une analyse poussées des ordonnances de protection prononcées par les juges civils, sur un trimestre. Cela nous permettra probablement d’améliorer les statistiques disponibles. Comme je l’ai évoqué précédemment, en Seine-Saint-Denis, 60 % des femmes victimes ont demandé l’éviction du conjoint et ont fait le choix de rester dans leur logement. De ce point de vue, le dispositif fonctionne bien et répond à l’attente de 60 % des victimes. Le dispositif est par ailleurs bien mobilisé, car les professionnels sont formés, en particulier les magistrats et les avocats. De surcroît, une convention locale permet une prise en charge des conjoints violents, que ce soit sur le plan thérapeutique ou en matière d’hébergement.
J’en viens à l’autre volet de la question : il existe des stages de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales pour prévenir la récidive. Dix services pénitentiaires d’insertion et de probation ont été mobilisés, à la fin de l’année 2014, pour expérimenter la mise en place de stages de responsabilisation d’une durée de trois jours. De manière complémentaire, quatre-vingt-quatre dispositifs ont été dénombrés dans cinquante-huit départements sous forme de stages, de groupes de parole, d’entretiens individuels ; ils ont permis la prise en charge de 1 546 auteurs en 2014. Tels sont les éléments statistiques que je peux vous fournir sur ces dispositifs. Je ne dispose pas d’enquête qualitative ; je serais intéressée par la lecture des verbatim de ces stages, surtout s’ils s’apparentent à ceux permettant de récupérer des points sur le permis de conduire. (Sourires.)
Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Guy Geoffroy. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Georges Fenech.
M. Georges Fenech. Je voudrais d’abord féliciter notre collègue Pascale Crozon pour la qualité de son rapport et lui dire combien je partage ses conclusions sur l’inopportunité de modifier le code pénal, sur l’importance de ne pas donner de permis de tuer, de ne pas créer de légitime défense différée. Les dispositions actuelles du code pénal, notamment celles qui définissent les circonstances atténuantes, les excuses de provocation ou la contrainte morale sont suffisantes pour apprécier in concreto ces douloureuses affaires. Le sujet central est bien celui de la protection des victimes et de leur accompagnement.
Ma question, madame la ministre, concerne l’exécution du quatrième plan triennal de lutte contre la violence faite aux femmes, dont l’objectif affiché en 2014 était de ne laisser aucune violence déclarée sans réponse pénale, sanitaire et sociale. Ce plan, présenté comme le plus ambitieux financièrement, au budget doublé – 66 contre 31,6 millions d’euros – a pour objet de contribuer à faire de ces violences une « priorité de santé publique » et de « sortir les victimes de ce cycle infernal le plus rapidement possible ».
Les principales mesures de ce plan ont été largement évoquées : le numéro d’urgence 3919, gratuit sept jours sur sept, la limitation des recours aux mains courantes au profit des dépôts de plainte, la formation de tous les personnels susceptibles de recueillir la parole des victimes, la mise à disposition d’un tiers des 5 000 nouveaux logements aux femmes victimes de violence et, autre mesure phare, l’accompagnement des victimes dans leurs démarches dès leur première visite aux forces de l’ordre. Citons également l’innovation que constitue la mise en place d’un kit de constatation d’urgence des viols pour effectuer immédiatement des prélèvements, sur le modèle de celui utilisé aux États-Unis, kit présenté sous la forme d’une petite boîte en carton contenant le matériel nécessaire aux premières constatations après une agression sexuelle.
Aujourd’hui, madame la ministre, ce plan triennal arrive à échéance. Selon l’association qui gère le 3919, la ligne d’information téléphonique a reçu, en 2014, deux fois plus d’appels que l’année précédente, ce qui est un point positif. Une étude a dévoilé récemment que 40 % des victimes ont déclaré avoir contacté les services de police ou de gendarmerie et que, sur ce nombre, plus d’une victime sur deux a porté plainte. Mais qu’en est-il du kit de constatation d’urgence des viols, censé assurer une réponse judiciaire et un meilleur suivi des victimes de viol, dont peu encore portent plainte, comme l’étude récente le révèle ? Qu’en est-il des intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries, dont le coût est déjà estimé à 10 millions d’euros ? La création de 550 hébergements d’urgence par an d’ici à 2017 au bénéfice des femmes violentées est-elle en cours d’application ? Lors de l’adoption de ce plan en 2014, la ministre de tutelle reconnaissait que l’on pouvait toujours faire mieux, mais plaidait la patience. Madame la ministre, lors de votre intervention vous avez déjà répondu en grande partie aux questions que nous nous posions, ce dont nous vous savons gré, mais pouvez-vous affirmer qu’à la fin de l’année, tous ces engagements seront respectés ?
M. Guy Geoffroy et Mme Marie-Jo Zimmermann. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Monsieur le député, j’ai déjà répondu à certaines de vos questions dans mon intervention liminaire, s’agissant notamment des moyens engagés et du numéro 3919. Vous avez vous-même fourni des éléments statistiques importants. J’ai évoqué les 81 protocoles départementaux qui ont été signés et les 350 intervenants sociaux qui seront bientôt présents dans les brigades ou les commissariats. J’ai également dit un mot du téléphone grand danger – 400 d’entre eux sont aujourd’hui actifs ; il y en aura 500 d’ici la fin 2016 – et des 1 650 nouvelles solutions d’hébergement qui seront créées d’ici à 2017, 70 % de l’objectif étant d’ores et déjà atteint.
Vous avez plus particulièrement évoqué la nécessité de faciliter l’accès des personnes aux unités médico-judiciaires. Les professionnels de santé ont un rôle à jouer, qui est identifié dans le quatrième plan interministériel de prévention. Les établissements autorisés en médecine d’urgence ont reçu instruction de désigner un référent – ou une référente – « violences faites aux femmes » chargé de sensibiliser ses collègues et d’identifier les partenaires locaux. Les référents seront réunis prochainement et outillés pour prendre en charge les femmes victimes de violences.
La prise en charge de ces femmes a été intégrée à la formation initiale des médecins et des sages-femmes. Pour la formation continue, deux kits, dénommés « Anna » et « Elisa », ont été produits par la MIPROF. Ils sont accessibles sur le site stop-violences-femmes.gouv.fr. Nous travaillons avec le Conseil national de l’ordre des médecins et des sages-femmes pour que ces professionnels, lorsqu’ils rencontrent des femmes victimes de violences, puissent renseigner un certificat médical ou une attestation le plus complètement possible. Sans ces documents, elles ne pourront pas demander à la justice de prononcer des mesures de protection.
S’agissant du niveau de détail attendu de la motivation de la décision de classement sans suite prononcée par les procureurs de la République, je vous suggère que nous y associons le garde des sceaux, avec qui nous menons un travail important.
Plus globalement, j’ai indiqué dans mon intervention que la lutte contre les violences faites aux femmes était une priorité. La mise en œuvre du plan se prolongera à travers de nouvelles actions en 2016. Je suis particulièrement vigilante sur les unités médico-judiciaires, pour les avoir moi-même portées au sujet de la protection de l’enfance. Elles sont indispensables pour assurer un bon accueil des victimes et un suivi satisfaisant des plaintes. Pour les femmes et les enfants victimes de violences, ces structures constituent une condition nécessaire pour que justice leur soit rendue.
M. Guy Geoffroy et Mme Marie-Jo Zimmermann. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Maina Sage, pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants.
Mme Maina Sage. Comme cela a été dit pendant la discussion générale, trop peu de femmes, encore, osent porter plainte. De surcroît, sur les 10 % de femmes qui le font, seuls 1 % obtiennent réparation, ce qui est évidemment insuffisant. Madame la ministre, je souhaite revenir à ces chiffres clés qui démontrent que la démarche consistant, pour les victimes, à porter plainte, paraît insurmontable aux yeux de la grande majorité d’entre elles. De fait, 99 % n’osent pas porter plainte pour des agressions ou des tentatives de harcèlement en milieu professionnel. Ce n’est pas, contrairement à ce que l’on pourrait penser, lié à une subordination hiérarchique : cela survient entre collègues de même niveau. S’agissant des violences intraconjugales, intrafamiliales, près de 90 % de femmes ne portent pas plainte.
Ce sont bien évidemment des femmes qui sont principalement concernées par ces agressions et qui n’accèdent pas aussi facilement à ces dispositifs qui ont vocation à les accompagner et à faire reconnaître leurs droits. Je tenais à le souligner et à vous dire que ce qui est essentiel, à nos yeux, est d’identifier les raisons pour lesquelles ces femmes ne le font pas. Il faut tenir compte du contexte, du fait que les agresseurs sont, dans 99 % des cas, connus par les victimes, ce qui rend très difficile d’engager une démarche et exige de leur part énormément de courage. Surtout, l’accueil n’est pas favorable, et cela se sait. Les femmes savent qu’il n’est pas si aisé de porter plainte. La présomption est souvent inversée ; il n’est pas rare que l’on mette en question le bien-fondé de leur plainte. Aussi je sollicite votre concours sur la formation initiale à l’accueil, à l’accompagnement de ces victimes, ainsi que sur la formation continue du personnel.
Comment, très concrètement, comptez-vous améliorer les choses sur ce point ? Trop d’exemples nous sont fournis, dans chacune de nos circonscriptions, de femmes encore mal accueillies, que l’on soupçonne d’affabuler, alors que nous savons que statistiquement, ces cas ne concernent que 5 % des femmes. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles elles ne parviennent pas à franchir ce pas.
J’espère que dans quelques années, on pourra sortir du seul débat entre femmes sur ces questions. Il faut que les hommes y soient encore plus sensibilisés. J’en profite pour remercier ceux qui sont présents aujourd’hui, y compris vous, monsieur le président.
M. le président. Je vous remercie tout de même de conclure, ma chère collègue.
Mme Maina Sage. Si l’on veut progresser, il me semble essentiel aussi que l’éducation à l’inégalité soit considérée comme un défi permanent à la fois en milieu scolaire et dans le milieu professionnel.
M. Bertrand Pancher. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Madame la députée, vous m’interrogez sur les raisons pour lesquelles les femmes ne déposent pas toujours plainte contre les auteurs des violences dont elles ont été victimes. Les raisons ont été identifiées, et elles sont nombreuses. Mais il est intéressant de constater que leur connaissance progresse également. Ainsi, la notion d’emprise n’a été identifiée et est entrée dans le débat public plutôt récemment. Nous avons tout à l’heure évoqué à plusieurs reprises le cas de Jacqueline Sauvage, mais parmi les bonnes nouvelles, il est apparu que ce n’était pas un débat de femmes. Je vois bon nombre de députés masculins présents cet après-midi, et c’est une bonne chose.
M. Guy Geoffroy. En effet !
Mme Laurence Rossignol, ministre. Notons aussi que la pétition en faveur d’une révision de sa condamnation a rencontré un écho qui n’aurait probablement pas été aussi grand il y a quelques années…
M. Guy Geoffroy. C’est vrai !
Mme Laurence Rossignol, ministre. …et qu’il est avant tout significatif d’une nouvelle prise de conscience dans la société française qui rejette de plus en plus les violences à l’encontre des femmes. Par conséquent, la société évolue, il faut accompagner cette évolution. Cela passe par identifier la question des violences faites aux femmes à travers un travail de recherche, un véritable travail scientifique. Ce travail n’a pas toujours été fait. Il n’y a pas tant de laboratoire de recherche que cela dont l’objet est d’étudier les violences faites aux femmes. Pourtant, ils auraient au moins le mérite de contribuer à répondre à la question que vous posez en substance : pourquoi les femmes ne portent-elles pas plainte ?
Et puis il faut former, encore et encore ; je pense en premier lieu bien sûr aux personnels qui recueillent les plaintes. Je sais qu’on peut me citer des cas, même récents, de dépôts de plaintes classées sans suite ou de mauvais accueils à la gendarmerie, mais les enquêtes révèlent globalement que la qualité de l’accueil des femmes victimes de violence a progressé dans les postes de police et de gendarmerie grâce à une formation adéquate des personnels concernés. Bien sûr il y a le week-end où celui qui a reçu une formation n’est pas de permanence, ou les périodes d’absence… Il peut toujours y avoir des dysfonctionnements, c’est pourquoi il faut aussi former l’ensemble des personnels. Je pense aussi aux médecins de famille : ils ne sont à l’origine que de moins de 5 % des signalements. Nous pourrions en tirer les mêmes conclusions et les mêmes leçons. De plus, je rappelle qu’une nouvelle loi va offrir aux médecins encore davantage de protection contre d’éventuelles diffamations.
Mme Catherine Coutelle. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jacques Krabal, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
M. Jacques Krabal. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, dans la continuité du rapport pour lequel nous ne remercierons peut-être jamais assez Pascal Crozon, et de celle de l’intervention que j’ai faite tout à l’heure sur l’éducation à l’égalité et à l’émancipation de tous les êtres humains pour faire progresser la société, et au-delà du problème des modifications éventuelles de notre droit et de la banalisation du féminicide, il apparaît nécessaire de consolider les avancées déjà majeures en matière de lutte contre les violences familiales car nous ne pouvons pas répondre à la mise en sécurité et à l’accompagnement des victimes par des demi-réponses, souvent sources d’injustice et d’inégalité d’un point de vue territorial, vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État.
La prise en charge du traumatisme des violences intrafamiliales est conditionnée à la réactivité et à la proximité ! Lorsque la femme violentée, qui plus est souvent la mère des enfants, doit dans la majorité des cas quitter avec eux le domicile, cela s’apparente à une double peine. Il lui est insoutenable également de devoir déraciner ses enfants – changement d’école, rupture du réseau primaire… –, les récits de vie en attestent. Les refus de propositions d’hébergement forcément éloignées conduisent donc au retour au domicile de la victime.
Vous avez raison de parler de la nécessité de renforcer l’accompagnement et la formation spécifique, mais je tiens à dire que le recentrage des fonds publics sur les opérateurs privés amène à une gestion départementalisée, et les propositions d’hébergement et d’accompagnement délocalisés couvrent parfois une distance de plus de cinquante kilomètres du domicile alors que les structures publiques de proximité – la ville via son centre communal d’action sociale et d’autres collectivités par leur socle de compétences – pourraient, elles aussi, apporter des solutions d’hébergement et d’accompagnement.
Aussi, madame la secrétaire d’État, même si les moyens ont augmenté, dans quelles mesures le Gouvernement peut-il renforcer les compétences et les moyens donnés aux échelons publics locaux pour que des réponses locales soient garanties aux victimes de violences intrafamiliales directes et indirectes ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Vous vous souvenez probablement, monsieur le député, que le 25 novembre 2012, le Président de la République avait souhaité que 1 650 places d’hébergement soient créées d’ici 2017 pour les femmes victimes de violence. J’ai indiqué tout à l’heure que nous étions aujourd’hui à 70 % de l’objectif.
Par ailleurs, la loi ALUR prévoit que le plan départemental évaluant les besoins en termes de logement doit prendre en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein du couple ou de leur famille, ainsi que celles menacée de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des violences ou des menaces de tels actes. La loi ALUR facilite donc le fait de concéder en location des logements conventionnés en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement-relais pour les personnes victimes de violences au sein du couple. J’ajoute que la prochaine loi « Égalité et citoyenneté » permettra de faire entrer les victimes de mariage forcée dans le public prioritaire dans l’attribution des logements sociaux.
Afin d’identifier précisément les besoins locaux et l’adéquation des réponses proposées, une démarche de diagnostic a été lancée avec l’objectif d’associer sur chaque territoire l’ensemble des acteurs concernés, en particulier les représentants des associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette démarche a été complétée par une enquête menée pendant l’été 2015 par les équipes territoriales aux droits des femmes, en lien avec les associations concernées, pour disposer d’une vision plus détaillée des réponses à apporter en termes d’hébergement et de relogement des femmes victimes de violences. Sur le terrain, il y a 1 147 nouvelles places depuis 2012, mais nous allons travailler pour atteindre 100 % de l’objectif : le chiffre de 70 % demeure insuffisant.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Massonneau, pour le groupe écologiste.
Mme Véronique Massonneau. Monsieur le président, madame la rapporteure, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, je note au préalable que Mme la ministre a déjà plus ou moins répondu à ma question à l’occasion de plusieurs excellentes interventions de mes collègues, mais je vais tout de même la poser.
M. François Rochebloine. Elle va compléter ses réponses précédentes ! (Sourires.)
Mme Véronique Massonneau. Le 8 mars 2016, comme tous les 8 mars depuis maintenant plusieurs années, nous avons regardé le monde à travers les yeux des femmes. Lors de cette journée, encore plus que lors de toutes les autres, il est impossible de ne pas voir en face les violences faites quotidiennement aux femmes. Les chiffres sont alarmants et malheureusement toujours d’actualité. Je n’y reviendrai pas, nous les connaissons toutes et tous, ils ont déjà été évoqués dans ce débat. Ils justifient pleinement le rapport rendu au nom de la délégation aux droits des femmes, et je profite de mon intervention pour saluer le travail accompli par ma collègue Pascal Crozon ainsi que par l’ensemble de la délégation et sa présidente.
Les avancées en matière de protection des femmes sont indiscutables : la volonté de faire entrer dans le vocabulaire courant et administratif le mot féminicide est à souligner ; le droit pénal est aujourd’hui en pleine progression pour faire reconnaître et condamner les violences faites aux femmes. Mais beaucoup de professions sont confrontées à cette question. Ainsi, les médecins, les avocats, les magistrats, les assistantes sociales, les fonctionnaires de polices… autant de corps de métiers qui seront confrontés au cours de leur carrière à des femmes victimes de violences. Le 30 novembre 2012, la MIPROF s’est vu confier le soin de définir un cahier des charges d’un plan de formation transversal et interministériel afin d’assurer une formation optimale à tous les professionnels confrontés aux violences faites aux femmes. Parmi les efforts accomplis depuis 2012, je citerai notamment la mise en place de kits de formation. Cependant, l’effort de formation de ces professionnels doit être encore plus poussé. Si l’on prend l’exemple des magistrats, leur formation se fait sur la base du volontariat… Or quand on sait l’importance de l’accueil et des premiers mots échangés avec les victimes de violences, quand on sait que l’ensemble de ces professions joue un rôle majeur dans l’accompagnement de ces femmes victimes de violences, quand on sait à quel point il est difficile pour une femme de se tourner vers ces professionnels pour se confier et ainsi s’extirper d’une situation de violences quotidiennes, ma question est la suivante : que comptez- vous faire, madame la secrétaire d’État, pour qu’une formation dédiée devienne la règle et pour que chaque corps de métiers soit doté des clés pour accompagner les femmes victimes de violences qu’il sera susceptible de rencontrer au cours de sa carrière ?
M. François Rochebloine. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Madame la députée, ayant déjà en effet répondu sur ce qui concerne la formation, votre question me permettra de préciser l’action que nous menons auprès des magistrats.
Dans le cadre de la formation initiale dispensée par l’École nationale de la magistrature, quatre des huit pôles d’enseignement traitent du thème des violences conjugales et une journée annuelle est consacrée aux violences faites aux femmes, avec un focus sur celles au sein du couple, journée à laquelle est associée la MIPROF, son personnel venant assurer lui-même la formation. Les auditeurs de l’École nationale de la magistrature peuvent effectuer un stage pratique en immersion dans une association d’aide aux femmes victimes de violences. En formation initiale, les modules d’enseignement à ce sujet ne sont donc pas optionnels.
En ce qui concerne la formation continue au niveau national, différents stages nationaux ont été mis en place, avec une session annuelle d’une durée de trois jours qui porte exclusivement sur les violences conjugales. Une autre session annuelle est consacrée à la traite des êtres humains, et une autre, de trois jours également, sera, à partir de cette année, dédiée aux violences sexuelles. Elle sera copilotée par Ernestine Ronai, coordinatrice de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la MIPROF. Enfin, je précise que le stage de spécialisation en vue de devenir juge des affaires familiales ou juge des enfants inclut une séquence sur les violences faites aux femmes et sur l’ordonnance de protection.
Dans le cadre de la formation continue déconcentrée, des actions portant sur les violences conjugales sont également organisées. Ces sessions sont aussi ouvertes aux autres professionnels. En 2016, des sessions dédiées au dispositif «téléphone grave danger » vont être ouvertes.
Mais, comme vous m’y invitez, je vais regarder précisément et avec plus d’attention encore ce qui est obligatoire et ce qui est optionnel.
Un mot sur la notion de féminicide, évoquée également par Eva Sas : j’ai demandé à l’ONU que le mot entre dans le vocabulaire diplomatique, en particulier au vu de ce que subissent les femmes yézidies. On peut également utiliser ce terme pour le sort des jeunes filles enlevées par Boko Haram. Je crois que ce qui se passe actuellement au Soudan du Sud relève incontestablement du féminicide. Et puis on a tous en tête le meurtre de jeunes étudiantes, en 1989, à l’École Polytechnique de Montréal où un individu était entré en criant : « Je hais les féministes ! », et avait assassiné seize jeunes filles et en avait blessé au moins autant. Au moins ici c’était clair : le féminicide était clairement exprimé. Pour le moment, j’avance pour que ce terme soit admis pour désigner des phénomènes collectifs. Installons-le déjà dans le vocabulaire diplomatique, désignons comme tels les persécutions et les meurtres collectifs à l’encontre des femmes. Je conclurai en rappelant que féminicide et génocide sont souvent liés car c’est par le premier qu’on aboutit au second en éteignant la transmission d’un groupe.
M. le président. La parole est à M. Gaby Charroux, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine et pour l’ultime question de notre débat.
M. Gaby Charroux. Madame la secrétaire d’État, il est vrai que cette question étant la dernière, je crois qu’elle arrive après quelques répétitions, mais cela permet, comme l’a dit ma collègue Véronique Massonneau, d’exprimer les choses dans toute leur ampleur. Venant d’un homme, c’est un moment qui compte tout particulièrement.
M. Gérard Menuel. Démagogie !
M. Gaby Charroux. Peut-être que cela ne compte pas pour vous, mon cher collègue, mais pour moi cela compte beaucoup. Je remercie d’ailleurs nos collègues du groupe SRC d’avoir pris l’initiative de ce débat.
Le 19 mars, dans ma circonscription des Bouches-du-Rhône, j’ai moi-même inauguré un centre d’accueil et d’hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a parallèlement voté la création de vingt logements d’accueil dans le département. Il faut reconnaître que ce type d’initiative relève en priorité des collectivités territoriales, accompagnées par l’État, notamment les services de la justice, et du travail exemplaire des associations d’aide aux victimes de violences. Mais cela ne peut pas suffire.
On estime qu’il manque, dans mon département, 160 places d’hébergement d’urgence : c’est dire si le problème est majeur. Face à la souffrance des victimes, il est urgent de le résoudre. Les femmes victimes de violences ne sont pas des femmes à la rue, mais des victimes en danger chez elles, au sein de leur foyer : elles ont des besoins spécifiques, auxquels nous devons répondre.
Je ne reviendrai pas sur les chiffres de la violence conjugale, qui font froid dans le dos. Il nous faut agir au-delà de ce qui est fait aujourd’hui, par exemple pour faciliter l’aide aux victimes, en rehaussant à 1 300 euros le plafond de l’aide juridictionnelle, en accordant systématiquement cette même aide aux associations qui se portent parties civiles et en proposant, plutôt qu’une simple rétribution, une juste rémunération aux avocats, comme le demandent la majorité des associations qui agissent dans ce domaine.
Enfin, un plan ambitieux de création de places d’hébergement d’urgence et d’insertion est nécessaire, tant la carence est aujourd’hui criante. Madame la ministre, quelles dispositions compte prendre le Gouvernement pour mettre en œuvre un plan d’envergure, à la hauteur des enjeux et de cette réalité insoutenable ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Monsieur le député, je ne reviendrai pas non plus sur les chiffres, déjà évoqués. Vous avez par ailleurs indiqué l’ambition et la volonté du Gouvernement d’atteindre les objectifs du Plan pour l’hébergement des femmes victimes de violences.
Je saisis cette occasion de saluer non seulement le travail réalisé dans les Bouches-du-Rhône, avec l’inauguration d’un centre d’accueil et la création de nombreuses places d’hébergement, mais aussi les actions menées par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. En assurant un maillage du territoire, ces structures de proximité représentent un premier recours pour les victimes et facilitent le dépôt des plaintes. En effet, le sentiment de honte est le lot commun des femmes battues ; et si elles n’ont personne à qui s’adresser avant de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie, il est fréquent qu’elles renoncent à porter plainte.
À cet égard, les associations réalisent un travail remarquable. En tant que ministre des droits des femmes, j’ai souvent l’occasion de présenter le tissu associatif, davantage encore que les fonctionnaires, comme « mes services extérieurs ». Notre budget témoigne d’ailleurs de cette réalité.
Comme je l’expliquais dans mon propos liminaire, les associations réfléchissent à la manière dont elles peuvent former d’autres travailleurs sociaux à repérer et accompagner des femmes victimes de violences. Cet accompagnement est parfois nécessaire pour aboutir à une plainte car la démarche n’est pas si facile à accomplir. En outre, ne désespérons pas, les associations réalisent un important travail de prévention, pour éviter que ces violences ne se répètent.
Source: Assemblée nationale