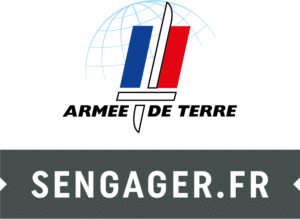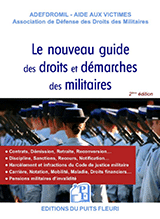Commission de la défense nationale et des forces armées
Présidence de Mme Patricia Adam, présidente
— Audition, ouverte à la presse, de M. Éric Trappier, président du comité défense du Conseil des industries de défense (CIDEF), président-directeur général de Dassault Aviation, et de M. Hervé Guillou, président-directeur général de DCNS, sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 2779).
— Examen, ouvert à la presse, de la proposition de loi visant à expérimenter un service civique de défense (n° 2732) (M. Yves Fromion rapporteur)
La séance est ouverte à dix-sept heures trente.
Mme la présidente Patricia Adam. Compte tenu de l’impact sur l’exécution de la loi de programmation militaire (LPM) des succès à l’export de nos industries de défense, et des nombreuses questions posées sur le sujet par les membres de la commission au cours de nos travaux liés à l’actualisation de cette LPM, nous allons entendre M. Éric Trappier, au nom du CIDEF, et M. Hervé Guillou, pour DCNS.
M. Éric Trappier, président du comité défense du Conseil des industries de défense (CIDEF), président-directeur général de Dassault Aviation. Je m’exprimerai, dans mon propos liminaire, comme président du comité défense du CIDEF.
Lors de l’élaboration de la loi de programmation militaire de 2013, conduite en partenariat entre le ministère de la Défense et l’industrie, celle-ci avait consenti beaucoup d’efforts pour entrer dans le costume un peu étroit de ce qu’il était convenu d’appeler « le 31,4 » – le budget de la défense devant être « sanctuarisé » à hauteur de 31,4 milliards d’euros par an. Une clause de revoyure était prévue à la fin de l’année 2015 pour faire le point, notamment sur deux hypothèses importantes : les recettes exceptionnelles (REX) portées par des sociétés de projet et la réussite de contrats de vente à l’export, en particulier du Rafale.
L’industrie salue la remontée de l’effort budgétaire : le remplacement des sociétés de projet et des recettes exceptionnelles par des crédits budgétaires va supprimer l’incertitude quant à la soutenabilité de l’effort financier. Quant à l’augmentation de la dotation au maintien en condition opérationnelle et à l’annonce de commandes supplémentaires, elles devraient redonner un peu de souplesse aux armées, dont certains parcs de matériels sont très éprouvés par les engagements en opérations extérieures (OPEX).
Nous souhaitons, nous, industriels, que cet effort soit poursuivi. Ainsi que l’a recommandé l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) lors du sommet de Newport en 2014, un bon budget de la défense pour un pays comme la France doit représenter 2 % du produit intérieur brut (PIB), niveau indispensable pour assurer la pérennité de notre modèle. Or, avec 1,47 % du PIB, nous en sommes loin.
À l’issue de l’actuelle LPM, nous entrerons dans une période charnière qu’il conviendra de mettre à profit pour réfléchir aux grands enjeux : renouvellement de la force de dissuasion et de la composante télécom spatiale, lancement des programmes de drones de combat et de surveillance, lancement de programmes dans le secteur naval… Or toutes ces décisions qui doivent contribuer au maintien du potentiel des armées ne peuvent pas s’accommoder d’un budget de 31,4 milliards d’euros. Il importera de veiller à la sanctuarisation du budget annoncée par le chef de l’État.
Nous saluons, dans l’actualisation de la LPM, l’augmentation de 3,8 milliards d’euros pour financer, notamment, l’opération Sentinelle ; le milliard d’euros en faveur des équipements ; la moindre prise en charge des surcoûts des OPEX par le budget général ; la diminution des enveloppes en fonction de l’inflation des prix, qui reste très inférieure à celle du coût des facteurs de production.
Nous estimons que le niveau juste suffisant de la LPM, conçue avant le déclenchement des opérations en cours, n’autorise aucune encoche. La situation budgétaire du ministère de la Défense, avec plus de trois milliards d’euros de report de charges fin 2014, ne permet plus de financement à crédit de l’outil de défense. Toute diminution budgétaire aura maintenant des conséquences en matière d’effectifs dans le secteur industriel.
Le programme 146 ne doit plus être ponctionné pour compenser les sous-dotations constatées en matière de fonctionnement. C’est, en effet, le programme qui concerne les développements futurs.
Nous réaffirmons l’impérieuse nécessité du maintien de l’effort en matière de recherche et technologie (R&T), si l’on veut financer les programmes au-delà de 2019. La sanctuarisation du programme 144 est donc plus que jamais nécessaire. Les discussions en cours sur la création d’un éventuel dispositif de financement de la recherche de défense au niveau européen ne doivent pas faire oublier que nous sommes quasiment seuls en Europe à assumer un effort important en matière de défense. La remontée de l’effort budgétaire observée depuis 2014 chez certains de nos partenaires européens ne doit pas masquer le recul régulier des budgets d’investissement depuis près de dix ans. Il leur faudra des années avant de revenir à un niveau acceptable. Les sommes versées au fonds de la Commission européenne ne doivent pas être compensées par une baisse en France, sous peine d’avoir des soucis en matière de R&T.
Pour nous, industriels, les exportations sont fondamentales pour compenser la baisse du budget de la défense, et donc la baisse de la quantité des matériels à livrer aux armées françaises. Nous avons obtenu de très bons résultats en 2013 et 2014, et 2015 devrait être une bonne année grâce à la vente de Rafale et de frégates multi-missions (FREMM). Ces succès viennent de ce que nos équipements sont éprouvés – leur qualité a été démontrée au combat par les forces armées de la France ; ils sont également dus aux besoins réels des pays acheteurs qui doivent renforcer leur défense et leur sécurité, à la volonté de certains États de se tourner vers la France pour des raisons politiques, et également à une bonne coordination entre l’État et l’industrie. On peut penser que les réussites récentes doivent beaucoup à cette conjonction de facteurs, assez rare. Nous appelons à la poursuite des efforts en matière de soutien à l’exportation, vitale pour l’industrie française.
Il ne faut toutefois pas croire que ces succès vont constituer une rente pour les industriels – finalement, il ne s’agit que de rediriger des matériels prévus pour la France vers l’exportation. En revanche, ils vont permettre d’atténuer les effets des baisses de cibles d’acquisitions nationales et d’étaler les commandes passées alors que les outils industriels étaient en mode de production minimale. Il était ainsi impossible de produire moins d’un Rafale par mois. Les bons résultats à l’export permettent, en outre, de maintenir des chaînes de production, des équipes ou encore des filières, qui comptent de nombreux sous-traitants. Ils vont, enfin, augmenter le solde commercial de la filière tout en soulageant l’effort fourni à court terme par la Nation.
Le bénéfice de ce contexte pour les armées réside avant tout dans le maintien sur le territoire national d’une industrie dévouée, apte à comprendre leurs besoins et à fournir sans risque d’interdiction de vente et d’emploi des équipements nécessaires à leurs missions.
En conclusion, l’industrie souhaite rappeler l’importance d’un effort budgétaire continu en faveur de la défense, qui devrait être rétabli à 2 % du PIB. Il convient, d’ailleurs, de plaider au niveau européen pour que nos partenaires prennent également ce chiffre comme référence. L’utilisation des matériels français sur les théâtres d’opération constitue une vitrine utile à la réussite de l’exportation. Ainsi, outil militaire et outil industriel fonctionnent-ils en un écosystème.
Mme la présidente Patricia Adam. En ce qui concerne la part du budget de la défense dans le PIB, il y a plusieurs normes OTAN. Souvent, le chiffre de 2 % intègre les pensions et, dès lors, le bon chiffre, concernant la France, n’est plus 1,47 %. Il est important de bien préciser les termes afin de savoir de quoi l’on parle.
M. Éric Trappier. Nous excluons les pensions de notre calcul.
Mme Geneviève Gosselin-Fleury. Des informations diverses et contradictoires nous ont été données s’agissant de la date de livraison du sous-marin d’attaque Suffren. Alors que la LPM la prévoyait pour 2017, la LPM actualisée mentionne l’année 2018. La semaine dernière, le délégué général de l’armement, M. Collet-Billon, nous a dit vous avoir précisé qu’il n’y aurait aucune modification ni révision du contrat Barracuda, en particulier pour ce qui est des délais. Le lendemain, l’amiral Rogel nous expliquait qu’il y aurait un décalage de six mois en raison du retard pris par DCNS. Or vendredi dernier, le directeur de l’établissement de Cherbourg me disait prévoir toujours une livraison pour fin 2017. Qu’en est-il exactement ?
M. Hervé Guillou, président-directeur général de DCNS. L’avenant à la LPM a confirmé l’effort en matière de dissuasion, le programme Barracuda étant conforté par l’arrivée du sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) de troisième génération, fondamentale pour le maintien des compétences à Cherbourg, à Lorient et dans différents établissements.
Pour en revenir à votre question, d’une certaine manière, tout le monde a raison : chacun voit midi à sa porte. Vous connaissez bien l’existence de certains décalages dus à des difficultés de production et qui restent relativement mineurs : nous les estimons à six mois, un an au maximum. Les dates de livraison du Suffren ont donc été revues tout récemment avec la marine, le début des essais étant prévu pour le second semestre 2016 et l’entrée en service à la fin 2017. Les variations de délais sont normales et c’est pourquoi nous prenons des précautions, en particulier pour prévoir la montée en puissance des équipages de la marine. Aussi exerçons-nous une pression sur nos équipes à Cherbourg pour qu’elles ne « mangent » pas les marges. Il est donc tout à fait normal qu’à six mois près, le directeur de l’établissement de Cherbourg ait des objectifs managériaux plus ambitieux que ceux qui résultent de nos discussions avec l’état-major ou la direction générale de l’armement (DGA). Ces écarts tout à fait mineurs sont à rapporter à un objet qui représente 10 millions d’heures, 2 000 personnes, et sept années d’études et de construction.
M. Gilbert Le Bris. Dans un budget de la défense équivalent à 2 % du PIB vers lequel nous devons tendre, 20 % devraient être consacrés à l’équipement et à l’investissement de défense. Or, en la matière, la France est largement au-dessus de la moyenne. Certains pays, comme la Pologne, semblent vouloir faire un effort dans cette direction ; d’autres, comme la Belgique, n’en font pas. C’est collectivement que nous devrions tirer vers le haut.
Le ministre de la Défense a récemment annoncé que la marine nationale commanderait cinq frégates de taille intermédiaire (FTI) pour remplacer les frégates La Fayette. Ces FTI sont très adaptées à l’export. Dès lors, le montage industriel les concernant devrait être différent de celui des FREMM. Dans ce cadre, pouvez-vous nous indiquer vos priorités au regard, d’une part, de l’utilisation de la base industrielle et technologique de défense (BITD), et, d’autre part, de l’utilisation de la sous-traitance françaises ?
M. Hervé Guillou. La LPM confirme la capacité de quinze frégates de premier rang, socle sur lequel le ministre de la Défense s’est engagé vis-à-vis de la marine. La réorganisation du calendrier de livraison des frégates est le résultat de l’effet vertueux évoqué par Éric Trappier. La grande complicité de « l’équipe de France » a permis d’exporter très rapidement une frégate en Égypte, et de prévoir une frégate de plus à Lorient d’ici à 2019.
Les ressources engrangées grâce aux exportations nous permettront d’accélérer le programme de cinq FTI : c’est l’opportunité d’obtenir beaucoup plus tôt que prévu, à savoir dès 2023, un modèle de référence exportable, pourvu de toutes les technologies modernes. Un nouvel équilibre peut ainsi être atteint entre les développements et la production, de nature à redonner presque dix ans de visibilité à DCNS dans le secteur des bâtiments de surface – à Lorient, à Toulon pour les systèmes de combat, à Indret, près de Nantes, pour les appareils propulsifs et à Ruelle pour les équipements.
La FTI représente 1,5 million d’heures d’études et, potentiellement, entre 1 million et 1,5 million d’heures pour la construction des séries. On doit également compter 600 000 heures de sous-traitance par bateau. Enfin, près de 2 milliards d’euros devraient être engagés dans la BITD et en direction de nos principaux partenaires industriels, au premier rang desquels Thales, non seulement pour les nouveaux radars à panneaux fixes – qui sont un bon produit d’appel à l’export, fruit d’une maîtrise technique unique en Europe qui permet à l’électronique de faire tourner le faisceau de façon artificielle –, mais aussi pour ce qui concerne la guerre électronique et les communications. Parmi nos autres partenaires, nous comptons MBDA, Nexter pour l’artillerie, Sagem pour la navigation optronique et les leurres, MTU pour les systèmes propulsifs, Airbus Défense, je l’espère, pour les drones hélicoptères Tanan.
Si, comme prévu, nous engageons en 2016 le plein contrat de développement, nous pourrons proposer cette frégate sur le marché dès 2017-2018. Il s’agit d’un segment de marché très actif, où les opportunités sont nombreuses – on les estime à quarante sur la période. Cela supposera de travailler en design to cost, c’est-à-dire de dessiner cette frégate en fonction de son exportabilité et non pas seulement des envies de mes ingénieurs ou des souhaits de nos officiers de marine. Il est parfaitement clair avec Bernard Rogel et Laurent Collet-Billon que nous concevons une frégate qui a d’abord vocation à répondre à un marché global et au budget de la marine.
Colombie, Pérou, Chili sont parmi les pays les plus intéressés. Les pays de la péninsule arabique offrent de belles potentialités, tout comme l’Indonésie et la Thaïlande. Au Canada, les problématiques de politique industrielle sont plus compliquées et le Brésil est confronté aux problèmes budgétaires que vous savez.
Quarante frégates, c’est un marché formidable. Si nous en prenons 20 % – notre part légitime sur ce marché où nous ne sommes pas très nombreux, surtout si nous nous différencions par la technologie –, cela représente huit frégates à construire. L’actualisation de la LPM nous offre donc une très belle opportunité.
M. Alain Moyne-Bressand. Nous ne pouvons que nous féliciter de la vente d’équipements très performants – le Rafale en particulier –, très positive pour notre économie. Reste que ces commandes sont arrivées assez brutalement et en grand nombre. Dassault et ses sous-traitants sont-ils à même d’y répondre ? Ne désorganisent-elles pas trop les entreprises ?
Pouvez-vous nous donner des informations sur la part de technologies vendues à l’Inde ?
Enfin, qu’en est-il des coûts de fonctionnement et d’entretien des deux bâtiments de projection et de commandement (BPC) qui ne sont pas livrés ? N’est-ce pas lourd à assumer pour DCNS, en attendant qu’une décision politique soit prise ?
M. Éric Trappier. C’est la décision prise dans la LPM de ne livrer que vingt-six avions qui a déstabilisé l’industrie. Nous avons accepté de ne produire qu’un avion par mois depuis longtemps alors que le programme Rafale en prévoyait deux ou deux et demi par mois. À un rythme de onze avions par an, nous aurions produit soixante-six avions au terme de la LPM, soit un surplus de quarante appareils. Un insuccès à l’exportation aurait signifié tout simplement l’arrêt de la chaîne Rafale. À l’inverse, la conclusion des deux premiers contrats au bon moment permet une stabilisation. Ils prévoient la livraison de deux fois vingt-quatre avions, qui vont en partie se substituer aux quarante avions français que je viens d’évoquer. Le « trou » de livraison à la France va un peu au-delà du terme de la LPM puisqu’un arrêt de livraison était prévu pendant quatre ans et demi suivi d’une reprise à partir de 2016. Pour l’instant, en phase de substitution, nous en sommes toujours à la cadence d’un avion fabriqué par mois et au lieu, donc, que les appareils produits soient livrés à la France, ils le seront à l’Égypte et au Qatar.
L’arrivée d’un troisième contrat va nous obliger à remonter en cadence, ce qui était prévu depuis longtemps. Le succès appelant le succès, nous sommes en mesure de monter – Dassault, SNECMA, Safran et l’ensemble de l’écosystème Rafale – jusqu’à une cadence de quatre appareils par mois. Aussi disposons-nous d’une large marge de manœuvre puisque, si l’Inde signait un contrat, nous n’en serions pas encore à ce rythme. Nous ne sommes donc pas inquiets concernant les prises de commande.
L’Inde, précisément, après la visite de son premier ministre au Président de la République, a décidé, pour des raisons de sécurité et de défense, d’accélérer le processus engagé en 2012, année pendant laquelle nous avons remporté la compétition. La difficulté était qu’il fallait produire pratiquement tous les composants du Rafale sous licence en Inde, ce qui aurait pris du temps pour le réaliser mais aussi pour le contractualiser en raison des nécessaires discussions avec l’ensemble des industriels indiens. N’ayant plus le temps d’attendre, les Indiens ont demandé la livraison immédiate de trente-six avions, soit deux fois plus que dans le contrat originel. Nous ne savons pas si, par la suite, d’autres tranches sont à prévoir et si elles devront s’inscrire dans le cadre de la nouvelle politique indienne du make in India impulsée par le Premier ministre Modi. Pour l’heure, nous nous concentrons sur l’application d’un contrat d’État à État, de gré à gré, sans transfert de technologie et sans transfert de fabrication.
M. Hervé Guillou. Je rappelle que la décision de livrer les BPC à la Russie appartient au seul Président de la République et qu’elle n’est pas encore prise. En tant qu’industriel, nous exécutons pour l’instant le contrat. Les Russes ayant interrompu leur paiement à partir du mois d’octobre, nous assurons la fin de la construction du second navire dont les essais en mer sont sur le point d’être terminés. Nous irons jusqu’au bout. Nous assurons, depuis le mois de novembre, l’entretien à quai, à coût minimal, du BPC numéro un.
En cas d’annulation, les mécanismes de compensation via la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) joueront. J’ai compris que le Président de la République avait donné des instructions aux services pour que l’industrie ne soit pas pénalisée financièrement s’il décidait de ne pas livrer les Mistral.
M. Gwendal Rouillard. En tant que rapporteur du budget de la marine, je souhaite vous poser deux questions à l’un et à l’autre.
Pouvez-vous, monsieur Trappier, expliciter votre conception des opérations SOUTEX – concours apportés par les armées aux actions commerciales à l’exportation – et, plus précisément ici, entre le groupe Dassault et l’armée de l’air ? S’agissant de la patrouille maritime, le taux de disponibilité de nos ATL2 est de 25 %. Je sais que des discussions sont en cours à la fois sur la maintenance, dans laquelle vous êtes concerné, et sur la rénovation. Que pensez-vous de la situation de l’ATL2, et quel est votre point de vue sur l’étude PATMAR 2030 ? La patrouille maritime est l’un de nos joyaux, et nous sommes attentifs à son avenir.
Monsieur Guillou, pouvez-vous préciser les aspects concrets de la nouvelle stratégie de développement à l’international que vous avez évoquée ? S’agissant du SOUTEX, je vous poserai la même question qu’à M. Trappier, cette fois entre DCNS et la marine nationale.
En tant que député de Lorient, je tiens à souligner le fait que la ville et son agglomération sont attentives à la qualité de l’accueil des délégations étrangères – j’y veille moi-même particulièrement. Ensuite, nous sommes pleinement mobilisés pour le développement de l’alternance et, en particulier, celui de l’apprentissage ; ainsi, exemple parmi d’autres, nous venons d’inaugurer un nouveau centre d’apprentissage de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) en Bretagne, qui accueillera dès les prochaines semaines des centaines d’apprentis, notamment dans le secteur de la construction navale. Enfin, via l’université de Lorient et quelques entreprises liées à la filière aéronautique, nous contribuons, à vos côtés, à façonner un écosystème autour des matériaux composites.
Pour finir, je salue l’engagement de nos industriels, quel que soit leur domaine d’activité.
M. Éric Trappier. Le SOUTEX avec les armées se passe très bien. Dès lors qu’était identifiée dans la LPM la mission d’exporter le Rafale, industriels et militaires étaient contraints d’intensifier leur effort de soutien à l’exportation – que les uns et les autres pratiquaient du reste depuis déjà longtemps. D’abord, de façon naturelle, lorsqu’un matériel est utilisé au cours d’opérations – par exemple, le Rafale dans l’armée de l’air –, il gagne en visibilité donc en publicité. Ainsi, la prise de conscience de la capacité du Rafale en termes de soutien a été importante dans les campagnes à l’exportation. Ensuite, dans le cadre de coopérations entre armées de l’air, nous avons besoin d’envoyer des avions pour des démonstrations. S’il s’agit d’une opération export, les coûts sont entièrement pris en charge par les industriels et réglés, aux termes de conventions, à l’armée de l’air, à l’exception du personnel et de l’amortissement de l’avion – ce fut le cas en Inde où nous avons envoyé le Rafale pendant plus d’un mois. Chacun s’y retrouve, car l’armée de l’air en profite pour avoir une expérience avec des armées de l’air avec lesquelles elle entretient de bonnes relations.
J’en viens à l’exécution des contrats. L’Égypte, par exemple, souhaite disposer d’avions en avance de phase. Le pouvoir politique a considéré que, pour gagner la partie – et compte tenu de l’enjeu au regard de la LPM –, il fallait dériver à l’export deux séries de trois biplaces afin qu’ils soient livrés rapidement. Ces six Rafale, initialement prévus pour la France, seront toutefois « rendus », leur livraison étant un peu différée sans que soit contrariée la montée en puissance du deuxième escadron nucléaire de l’armée de l’air française. En attendant, nous avons effectué des prêts de matériels aux Égyptiens, toujours aux termes de conventions passées entre l’armée de l’air et l’industriel.
Pour ce qui est du training, le cas par cas prévaut. Il est réalisé tantôt par les pilotes Dassault, tantôt par l’armée de l’air, mais il est toujours le fruit d’une concertation entre l’armée de l’air et Dassault Aviation, d’accords et de conventions. Nous ne pouvons pas faire, par exemple, ce que l’armée de l’air ne peut pas faire. Certes, la flexibilité est d’autant plus réduite que l’armée de l’air est contrainte d’un point de vue budgétaire. Les enjeux précédemment évoqués obligent donc à une plus grande souplesse qui accroît la pression sur les industriels et les aviateurs, pression que la relation forte entre l’armée de l’air et l’industrie permet de prendre en compte.
La marine contribue également au SOUTEX quand elle déploie son porte-avions mais cela fait partie de ses missions au port de s’intégrer dans des dispositifs avec un certain nombre de pays alliés.
Il faut continuer dans cette voie et, à cette fin, il est nécessaire que les armées disposent de moyens qui aident l’industrie à exporter, dès lors que l’exportation d’un matériel a été déclarée d’intérêt national.
Pour ce qui concerne la patrouille maritime, nous tenons beaucoup à l’ATL2. Nous travaillons avec DCNS, Thales, les services de l’État et des sous-traitants dans le cadre de plateaux d’intégration système, dans le dessein de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de développement de typeProduct Lifecycle Management – PLM système. Nous tenons beaucoup à ce programme en dépit d’une difficulté bien connue : il n’y a pas beaucoup d’avions et le soutien de certains matériels, en particulier de l’ATL2, n’est pas très simple. Mais nous soutenons ce dernier avec les moyens du bord et avec la bonne volonté des militaires, de l’État et des industriels associés. Pour ce qui est du programme de modernisation, nous sommes dans les temps malgré de petits aléas imputables à certaines obsolescences. Un travail est actuellement mené entre les services industriels de l’État et les industriels – Dassault, Thales, DCNS – afin de rester dans les créneaux de livraison prévus.
M. Hervé Guillou. DCNS a toujours exporté une portion croissante de son chiffre d’affaires : 10 % dans les années 80, 20 à 25 % au début des années 2000 et la part de prise de commandes à l’export est, pour 2014 et 2015, de 40 %. Quant à la part de la production destinée à l’export, elle a dépassé 33 % – 35 ou 37 % selon les mesures.
Notre stratégie consiste à répondre à l’évolution du marché en tenant compte du fait que les pays émergents veulent avoir sur leur sol, tout à fait légitimement, une partie de leur BITD, en particulier pour des matériels aussi critiques que les navires de guerre. Il s’agit également de répondre à une concurrence beaucoup plus mondialisée, non seulement avec nos collègues européens habituels – ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) pour les sous-marins, Damen pour les bateaux de surface –, mais aussi désormais avec des Coréens, des Chinois et d’autres.
Un des enjeux de la prochaine décennie pour DCNS est d’accélérer son développement international en adaptant ses offres de produits aux besoins des marchés émergents et en croissance. Cette démarche avait été mise en œuvre au cours de la décennie précédente sur les sous-marins, avec l’offre Scorpène qui avait connu un certain succès auprès du Chili, de la Malaisie et de l’Inde.
Ensuite, il importe d’internationaliser la société : 95 % de nos effectifs sont en France, mais cette proportion devra changer pour que nous passions le cap de la prochaine génération. Nous ne pouvions pas, tant que nous étions une administration publique, nous déployer à l’international. Depuis onze ans que nous sommes devenus une véritable société, de gros efforts ont été accomplis, que je souhaite accélérer. Nous sommes présents en Inde, à Bombay, où nous construisons des sous-marins ; nous avons une société à Itaguaí, au sud de Rio et un bureau d’études à São Paulo, où nous travaillons avec la marine brésilienne à la fois sur les sous-marins et sur la refonte des porte-avions ; nous avons, en Malaisie, une joint-venture à Kota Kinabalu, sur l’île de Bornéo, où sont construits des sous-marins, et une autre près de Kuala Lumpur où sont produites des frégates. Cela reste néanmoins insuffisant par rapport au déploiement de la concurrence qui, après la chute du mur de Berlin, a investi très rapidement l’international. TKMS, notre concurrent allemand, dispose par exemple de seize sociétés hors d’Allemagne et a vu, par effet d’un cercle vertueux, son chiffre d’affaires croître en Allemagne même ; Fincantieri a vingt-trois implantations hors d’Italie et Damen en a vingt-sept hors des Pays-Bas.
Nous nous déployons dans trois cercles. Le premier, où nous nous trouvons déjà et où nous pouvons donc accélérer en croissance organique, est composé de la Malaisie, du Brésil et de l’Inde. Le deuxième est constitué de zones de prospection : l’Australie, qui a lancé un énorme appel d’offres de sous-marins ; l’Arabie Saoudite, où nous allons commencer par un investissement dans l’entretien-flotte ; l’Égypte, où il faudra accompagner l’effort sur les corvettes ; enfin, peut-être, la Pologne, où notre programme se développe. Le dernier cercle est l’Europe, en laquelle j’ai la foi du charbonnier. J’ignore si les étoiles vont s’aligner ou non, mais si un train passe, qu’il soit allemand, italien ou autre, il ne faudra pas le rater. Nous gardons à l’esprit qu’il faudra être ouvert à la discussion.
Pour ce qui est du SOUTEX, nous entretenons une relation très étroite avec la marine. Je remercie l’amiral Rogel et l’équipage de l’ex-Normandie du sacrifice auquel ils ont consenti pour nous aider en Égypte. Nous sommes mobilisés pour que leur capacité opérationnelle ne s’en trouve pas pénalisée, et nous avons immédiatement accéléré la construction des FREMM suivantes. Ils auront donc leurs six frégates de lutte anti sous-marine (ASM) en 2019.
L’engagement avec la marine prend des formes très variées. Nous bénéficions, tout d’abord, d’une facilité puisque nous pouvons profiter des traversées de longue durée pour, en escale, présenter nos équipements, nos systèmes et nos solutions. Ainsi, rien qu’au cours des douze derniers mois, leDixmude est l’un des BPC qui, avec la frégate La Fayette Aconit, est allé à Cochin, à Singapour, à Djakarta. La frégate Chevalier Paul s’est, pour sa part, rendue très récemment au Qatar puis, avec le porte-avions Charles de Gaulle, en Inde. Les autorités qataries ont visité une FREMM et une frégate Horizon. La marine a également envoyé une FREMM au Canada, au Brésil…
Un autre modèle de coopération a été amorcé avec le patrouilleur hauturier L’Adroit que nous avons construit à nos frais. Nous avons passé une convention avec la marine, à laquelle la corvette n’a rien coûté, et qui s’en sert pour un certain nombre d’opérations. C’est L’Adroit qui a récupéré une partie de nos ressortissants au Yémen il y a quelques semaines. Dans le même temps, au cours des six derniers mois, nous avons fait une campagne de promotion au Kenya, en Afrique du Sud, au Congo-Brazzaville et au Cameroun.
Par ailleurs, le soutien et l’expertise opérationnels sont pour nous très importants. Ainsi, en Arabie Saoudite, la marine va aider la flotte de l’Ouest, à Djeddah, à améliorer ses concepts de maintenance et de disponibilité opérationnelle. Nous en profitons pour promouvoir le modèle français de MCO et, comme complément naturel de la marine, nous trouvons toute notre place dans ces discussions.
Cette coopération vaut également pour la formation. Ainsi, tout l’équipage de la première FREMM destinée à l’Égypte se trouve précisément à Lann-Bihoué et à Lorient pour prendre des cours dispensés, d’une part, par Défense conseil international (DCI) pour la partie industrielle, et, d’autre part, par la marine nationale. Il est indispensable de créer et d’entretenir le dialogue de marine à marine sur les concepts opérationnels, sur les opérations elles-mêmes, afin de susciter une relation de confiance.
Enfin, sans la marine, nous ne saurions pas faire tous ces efforts de promotion, ne serait-ce que parce que nous ne disposons pas de bateaux en propre.
M. Michel Voisin. Je reviens sur le souhait exprimé par l’OTAN que l’effort de défense représente 2 % du PIB – je me souviens, au passage, qu’il y a quelques années il était question de 4 %. Quels sont les pays membres à s’y être engagés ?
Pendant des années, notre avion, le Rafale, a démontré toutes ses capacités et ses performances et aussi qu’il était, sur les différents théâtres, l’avion sans doute le mieux équipé. Les commandes inscrites dans les différentes LPM ont contribué à l’amortissement des coûts de recherche et développement. Logiquement, ces coûts s’éteignant, pour reprendre la terminologie de la gestion d’entreprise, nous passons au coût marginal : plus les commandes augmentent et plus les coûts diminuent. Compte tenu des commandes à l’exportation et de la livraison différée de ses Rafale, quel est le coût que peut espérer le budget de la défense en atténuation ?
M. Daniel Boisserie. Monsieur Trappier, vous avez partiellement répondu à Alain Moyne-Bressand. Je vous ai trouvé très modeste : on a l’impression que tout se passe naturellement et que les commandes importantes qui vous ont été passées ne vous posent pas trop de problèmes pour l’instant. J’ai tout de même le sentiment que, comme le succès engendre le succès, vous devez vous préparer un peu à l’avenir. Vous avez une politique de formation, de recrutement ; disposez-vous de suffisamment d’ingénieurs, de techniciens ? En outre, êtes-vous satisfait de vos relations avec les régions en matière d’aides à la formation ?
Par ailleurs, êtes-vous sollicités pour l’installation d’unités de fabrication dans les pays où vous vendez vos avions ?
Enfin, comment la maintenance va-t-elle être assurée ?
M. Éric Trappier. Un budget de la défense représentant 4 % du PIB est une référence américaine. Au Royaume Uni, il avoisine 2 % ; en France, il est à 1,5 % mais est en baisse. D’autres pays, comme la Pologne, commencent à faire des efforts mais achètent beaucoup américain. Nous préférerions que l’Europe se mobilise pour acheter européen. Quitte à choquer, je n’ai pas peur d’affirmer qu’une Europe politique, si elle veut être souveraine, devrait favoriser des acquisitions de matériels européens et non américains.
Pour ce qui est du Rafale, si j’étais bon gestionnaire, je vous enverrais une facture. Je vous rappelle que les industriels ont autofinancé quelque 25 % du développement de cet avion. Cette part n’est pas amortie et passe par pertes et profits chez l’ensemble des industriels concernés. S’agissant de la courbe de décroissance, le prix d’un Rafale payé par l’armée de l’air, par la marine ou par l’export ne comprend pas d’amortissement de développement passé. En revanche, il peut comprendre du développement à venir – on fera ainsi payer des modifications demandées par un client.
Le prix d’un Rafale de la tranche 4 est beaucoup moins élevé que celui d’un Rafale de la tranche 3. La France a fait mieux que la fameuse courbe de Wright grâce à l’intégration massive – sur fonds propres – des outils du PLM, que nous utilisons pour le civil dans la compétition avec nos grands amis américains qui ont des coûts bien moindres que les nôtres, du fait du plus faible coût de la main-d’œuvre et de taxes moins fortes. Sous l’effet de la décroissance naturelle de Wright et de celle liée à l’utilisation massive des outils du numérique, le prix du Rafale pour la défense française est tombé. Et il devrait se vérifier que le prix de chaque avion de la tranche 5 sera inférieur à celui des appareils de la tranche 4, cela alors même que nos cadences sont loin d’être infernales : le F35, aux États-Unis d’Amérique, est en train d’être produit à 4 000 ou 5 000 exemplaires alors que nous en sommes, nous, à quelques dizaines de Rafale.
M. Alain Moyne-Bressand. Quel est le prix d’un Rafale ?
M. Éric Trappier. Je ne peux pas vous répondre, car on ne peut déterminer de prix sans s’appuyer sur des hypothèses. Vous devriez interroger la DGA qui achète le Rafale par sous-ensembles. Le prix est exclusivement lié aux conditions prévues par le contrat. La Cour des comptes a publié des informations assez justes sur le sujet. Le prix de l’appareil est en baisse et les coûts de développement sont payés. Nous avons commandé le nouveau standard du Rafale, dit « F3R », il y a un an, pour un milliard d’euros de développement. Pour Dassault, Thalès et l’ensemble des sous-traitants, ce sont, j’y insiste, des frais fixes qui ne sont pas intégrés dans le prix de l’avion de série. Il ne vous aura pas échappé, par ailleurs, qu’une des raisons du succès récent du Rafale est la remontée du dollar face à l’euro. Le prix américain a augmenté, pour des pays comme l’Égypte ou le Qatar, de quelque 25 % en un an.
Pour ce qui concerne la formation, nous gérons un écosystème et nos équipes sont capables de travailler autant sur nos programmes civils que sur nos programmes militaires, qui représentent respectivement 70 % et 30 % de l’activité de Dassault. Mon inquiétude, notamment en Aquitaine, était d’avoir à poursuivre la baisse de la fabrication. Nous n’avons aucun souci pour embaucher : Dassault attire ; on aime travailler pour nous, que ce soit directement ou bien en tant que sous-traitant – nous respectons nos PME. Nous avons établi des partenariats avec certains corps de formation, comme Aérocampus – créé à l’initiative de la région Aquitaine –, qui forme des apprentis. Ceux que nous prenons en stage, s’ils ont révélé l’aptitude et la rigueur requises dans le secteur exigeant qu’est l’aéronautique, vont se battre pour venir travailler chez Dassault Aviation. Nous avons acheté, juste à côté de l’usine Dassault qui a accès à la piste de l’aéroport de Bordeaux, un terrain pour installer un nouveau centre de maintenance des Falcon. Nous allons faire venir des personnels de la région parisienne pour démarrer cette activité puis nous embaucherons. Je suis résolument optimiste tout en étant très réaliste, conformément à la méthode Dassault : quand on le dit, c’est qu’on sait faire.
Nous sommes dans une spirale très positive avec la région Aquitaine, mais aussi avec d’autres. La signature des nouveaux contrats est très bien perçue et de nature à dynamiser les régions puisque, certains l’oublient parfois, en économie, c’est l’industrie qui fait vivre un pays. Si celle-ci est en bonne santé, le pays va bien. Les États-Unis d’Amérique l’ont très bien compris, qui ont porté leur budget de la défense à 4 % du PIB, investi dans les entreprises et favorisé les exportations, ce qui a contribué à créer de l’emploi.
M. Jean-François Lamour. Malgré nos questions répétées, nous avons obtenu très peu d’informations sur le milliard supplémentaire destiné à l’acquisition d’équipements, qui résulterait de l’évolution favorable du coût des facteurs. Vous avez commencé à nous apporter des éléments de réponse par vos précisions sur le prix du Rafale. Si je comprends bien, l’étude menée conjointement par le ministère de la Défense et par Bercy détermine un certain nombre d’économies liées, schématiquement, au coût de production des matériels. Il semble donc qu’on doive réaliser un milliard d’euros d’économies sur un brouillard d’indicateurs composé, entre autres, du coût du matériel brut, de celui de sa transformation, du coût de la taxation de la main-d’œuvre, de celui des loyers.
Je souhaite savoir si vous avez été directement interrogé par cette inspection conjointe. Sinon, comment cette dernière aurait-elle pu déterminer ce gain non négligeable de un milliard et, surtout, déterminer ce qui va constituer l’essentiel des moyens supplémentaires destinés à la production de matériels très diversifiés et très importants pour nos forces – lancement des FTI, du NH90, du Tigre, de Pods de désignation laser à caméra technique, sans parler des jumelles de vision nocturne destinées à nos forces spéciales ?
Comment estimez-vous, vous-même, ce gain de pouvoir d’achat ? Sa montée en puissance correspond-elle aux acquisitions de matériels telles que prévues par la DGA ? Il s’agirait de nous éclairer car, jeudi prochain, nous aurons à débattre en séance de ces coûts de facteurs et de ces gains de pouvoir d’achat.
M. Philippe Folliot. L’excellence française, en matière de défense, est la juste combinaison entre les hommes et le matériel. Nous savons tous les contraintes budgétaires de l’État et donc la difficulté d’assumer un volume de commandes suffisant pour notre industrie. Aussi, hors l’export point de salut. Les deux groupes que vous représentez en sont l’illustration. Les succès à l’export s’expliquent par la qualité des matériels issus de la recherche et des savoir-faire de vos personnels, mais aussi par le contexte international particulièrement dégradé qui implique qu’on se réarme un peu partout, à l’exception de l’Europe, ainsi que par des éléments conjoncturels liés aux taux d’intérêt, au cours du dollar.
Nos exportations sont, du reste, bien encadrées : la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG) joue son rôle avec rigueur et efficacité ; vous-mêmes appliquez un certain nombre de recommandations, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption menée par l’OCDE.
Aujourd’hui ont été publiés les chiffres de l’évolution du taux de chômage : ils sont catastrophiques. Il y a quelques jours, ceux du commerce extérieur non plus n’étaient pas vraiment bons. Pouvez-vous nous renseigner sur le poids dans l’économie nationale, en matière d’emplois, de la filière que vous représentez ? Quelles sont vos perspectives d’embauches ?
En outre, si notre balance commerciale accuse un déficit de quelque 90 milliards d’euros par an, la balance du secteur de la défense est, pour sa part, excédentaire de cinq milliards d’euros par an. Pouvez-vous nous préciser ces chiffres et nous indiquer quelles sont vos perspectives, pour les années qui viennent, notamment au regard de l’excellente nouvelle que constitue la signature des récents contrats à l’export ?
Nous ne pouvons que partager vos propos, monsieur Trappier : un pays qui a de l’avenir est un pays qui a une industrie. C’est d’autant plus vrai pour l’industrie de défense que les enjeux d’indépendance, de souveraineté ne sont pas négligeables.
M. Éric Trappier. Pour répondre à la question de M. Lamour, nous n’avons pas apporté de contribution à l’inspection conjointe. Quand j’évoque la baisse du coût du Rafale, il s’agit de prix révisables, c’est-à-dire des prix en fonction de nos coûts de main-d’œuvre et de matières au moment de la négociation. LA DGA provisionne ensuite, de façon à être en mesure de payer, au moment de la livraison des matériels, la révision de prix liée à l’évolution de ces coûts. Je suppose, par conséquent, qu’elle fait une estimation de cette évolution. Ces calculs sont complexes. La baisse de l’inflation a certes entraîné une baisse des révisions de prix, mais, compte tenu des facteurs importants que sont le niveau des salaires et le prix des matières premières, les prix des produits de haute technologie augmentent largement plus que le taux d’inflation.
Nous finançons également, nous-mêmes, industriels, l’État quand il rencontre des problèmes de paiement ; des calculs savants permettent de déterminer les taux d’intérêt auxquels il nous remboursera.
M. Jean-François Lamour. Vos estimations portent sur des périodes de combien de temps ?
M. Éric Trappier. Quand on établit un contrat à l’export, de nombreux clients nous demandent des contrats fermes et non révisables. En concertation avec Bercy, nous calculons l’évolution des prix de la matière première, de l’augmentation de nos salariés sur quatre, cinq ou six ans en intégrant un coefficient de risque : il faut éviter qu’une entreprise se retrouve déficitaire à cause de mauvaises prévisions. De nombreuses formules sont envisageables avec nos clients : révisable, avec coefficient de risque intégré, plafonnée ou pas. Reste que je ne sais pas comment on parvient au gain de un milliard d’euros évoqué.
M. Hervé Guillou. Nous ne le savons pas non plus. Nous connaissons les prix de nos contrats et les formules de révision, en particulier pour les contrats France. À la différence des contrats de vente d’avions, ceux concernant les bateaux couvrent des périodes beaucoup plus longues : vingt-trois ans pour les FREMM, vingt-sept ans pour les Barracuda. Les formules de révision de prix de la DGA s’en trouvent, par conséquent, d’autant plus compliquées – elles évoluent souvent moins vite que les coûts réels, en particulier moins vite que les salaires chargés. Ainsi, la productivité doit progresser plus vite que l’écart entre les formules de révision de prix des marchés publics et nos coûts, ce qui est un challenge.
Pour ce qui est de l’export, il s’agit de se couvrir sur les périodes les plus courtes possibles afin de ne pas prendre de risques de change, ni d’inflation différentielle, ni de masse salariale que nous ne contrôlons pas dans les pays étrangers – comment déterminer, par exemple, l’évolution de la masse salariale en Australie dans les dix années à venir pour évaluer le prix de sous-marins ?
M. Éric Trappier. L’excellence des sociétés françaises est liée à l’écosystème qui, au sein du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) plus que du CIDEF, combine l’industrie de défense et l’industrie aéronautique, avec Dassault et Airbus notamment. Cette filière, dans son ensemble, représente environ 48 milliards d’euros, 330 sociétés, 170 000 personnels ; elle réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires à l’export. Si l’activité militaire baisse, nous augmentons la part de l’activité civile et inversement. L’aéronautique civile et militaire est un puissant moteur pour l’emploi grâce à sa capacité technologique. Les Américains sont nos principaux concurrents. Nous sommes parvenus récemment à les supplanter dans le domaine militaire grâce à une conjonction de faits favorables : le développement, avec les pays acheteurs, d’une relation politique et stratégique particulière, les besoins nés des circonstances géopolitiques locales, la baisse, en creux, de l’influence américaine dans certains pays arabes, le rapport entre l’euro et le dollar.
Dassault comme Airbus, dans le secteur civil, souscrivent des assurances destinées à moduler les effets des variations du cours du dollar. Nous sommes, par ailleurs, pour compenser, obligés d’embaucher aux États-Unis d’Amérique, où nous créons des usines. Nous n’en avons pas moins énormément d’emplois en France et nous en compterons d’autant plus que l’entreprise se portera bien. Or la filière, qu’il s’agisse des avionneurs, des motoristes, des électroniciens, ou des sous-traitants, embauche à un rythme soutenu.
Mme Nathalie Chabanne. Les normes ITAR (International Traffic in Arms Regulations) peuvent constituer un vrai obstacle à l’exportation de nos produits. Les succès récents que nous avons remportés ne sont-ils pas susceptibles de provoquer des blocages à l’exportation ? Ne faites-vous pas des envieux ? Qu’en est-il, dans cette perspective, de la création de filières françaises, voire européennes, sachant que nous rencontrons également des problèmes au sein de l’Europe ?
En outre, vous avez bien précisé que les contrats étaient passés de gré à gré et sans transfert de technologies. Il ne s’agit donc pas de contrats signés entre les États mais de contrats garantis par l’État via la COFACE. Pouvez-vous préciser la nature juridique de ces contrats, qui semble suffisante pour permettre la signature de contrats à l’exportation très importants ?
M. Philippe Nauche. Où en est votre réflexion sur l’après-Rafale ?
M. Éric Trappier. La question des normes ITAR est très sensible et continue de défrayer la chronique dans le domaine des satellites. Les Américains utilisent, en effet, ces règles pour limiter certaines exportations vers des pays pourtant amis, pour des raisons souvent plus politiques que juridiques. Tout dépend, en fait, du degré de sensibilité des produits exportés. Le Rafale, comme tous les matériels militaires français, comprend des composants ITAR, mais dans une proportion assez faible, au point que nous pourrions presque le livrer en nous en passant. Il ne serait donc pas de l’intérêt de l’industrie américaine de se priver de ce genre d’exportations dès lors qu’elles sont réalisées vers un pays qui n’est pas l’ennemi des États-Unis. Nous aurions sans doute plus de difficultés si nous voulions exporter des Rafale vers la Russie…
Il s’agit de contrats commerciaux bien organisés qui s’inscrivent dans le cadre de partenariats intergouvernementaux stratégiques qui définissent des règles liant les États concernés. C’est pourquoi ceux-ci sont fortement impliqués et pourquoi des assurances sont données – il s’agit tout de même de matériels de guerre, qui coûtent cher et d’engagements à long terme puisqu’il faut assurer ensuite l’approvisionnement de pièces de rechange.
J’en viens à la question de l’après-Rafale. Pour tout vous dire, je trouve que nos armées et l’ensemble de la profession de défense sont exclusivement mobilisés sur leurs tableurs Excel – c’est la LPM ! Je vois peu de penseurs préparer le futur, non que les militaires n’aient pas envie de s’y consacrer, mais leur préoccupation du jour est telle qu’elle en devient pour eux inhibante. C’est inquiétant. La DGA, elle, pense en termes de technologie mais, quand on prépare l’avenir à vingt ans, on a besoin de confronter les savoir-faire technologiques, et il faudra bien discuter avec les états-majors pour savoir ce que sera la guerre de demain – quand bien même personne ne la souhaite, il faut s’y préparer. Nous accusons, par exemple, du retard dans le domaine des drones dont la technologie a davantage été mise en valeur par nos amis américains et israéliens qui en ont très rapidement compris l’utilité. Il nous faut donc rattraper notre retard en matière de drones de combat – c’est l’objet du démonstrateur nEUROn, mais il ne s’agit que d’un démonstrateur. Nous constatons une première prise de conscience de ce que les technologies de demain peuvent apporter en matière de guerre aérienne : nous allons devoir intégrer des systèmes de plus en plus complexes.
La boucle entre état-major des armées, état-major de telle ou telle arme, DGA et industriels est un peu longue et la circulation lente, car on ne veut pas donner à ces derniers l’idée de lancer des programmes alors qu’il n’y a pas d’argent. Seulement, à suivre cette logique, on finit par ne plus rien lancer. Nous le faisons tout de même par d’autres moyens, notamment grâce à l’export et à la coopération. Il faudrait retrouver des méthodes de coopération pragmatique sur des besoins communs, qui permettraient, pourvu que les états-majors se soient consultés et aient élaboré des fiches-programmes ou des fiches de besoins opérationnels communs, de lancer des programmes européens. Ainsi, pour ce qui est des drones de combat, sommes-nous en train de développer le programme franco-britannique FCAS-DP, avec nos amis de BAE Systems, Rolls-Royce, Safran, Thales et Selex UK. Nous nous rapprochons, par ailleurs, des Allemands et des Italiens pour ce qui est des drones de surveillance afin de préparer, pour les années 2020, non pas un Reaper bis mais l’après-Reaper.
De la même manière, le programme PATMAR 2030 ne vise pas forcément à remplacer l’ATL2 mais à concevoir la patrouille maritime de demain, la mission de surveillance pouvant d’ailleurs très certainement être accomplie par des drones qui tourneraient 24 heures sur 24, des avions d’armes pouvant intervenir très rapidement pour traiter les menaces sous-marines ou de surface. Un important travail de préparation reste donc à effectuer en même temps que les mentalités doivent changer, de façon à être capable de répondre à des questions comme celle de savoir, par exemple, si les avions de combat de demain devront aller dans l’espace.
C’est bien le programme 144, « Environnement et prospective de la politique de défense », qui doit y contribuer. Plus encore, c’est aussi une affaire de mobilisation des industriels, de la DGA et des états-majors – ces derniers devant s’intéresser au futur, quitte à détacher des personnels à cette fin. C’est fondamental si la France veut rester au bon niveau de développement des technologies et des produits. Tâchons d’agir en ce sens au plan européen, à condition, de grâce ! que cette Europe se montre pragmatique, contrairement à ce qu’elle fait aujourd’hui en annonçant des choses qu’elle ne fait pas – tout au moins en matière de défense. Que les États qui souhaitent coopérer élaborent une fiche programme commune, nous trouverons toujours les moyens, ensuite, nous industriels, de coopérer – même Dassault et Airbus le peuvent, c’est vous dire !
M. Hervé Guillou. Je souscris entièrement à ce que vient de souligner Éric Trappier : il faut voir loin, et la cyberdéfense en est le meilleur exemple. La semaine dernière, j’ai alerté les technologues de DCNS réunis en convention sur le fait que lorsque la FTI que nous allons lancer sera à mi-vie, en 2038-2040, nous en serons à la 10 G avec probablement 20 téra adresses IP ! Il est fondamental qu’en matière de cybersécurité, de cyberdéfense et de cyber-offensive nous n’ayons pas un train de retard ! Si nous ratons le train de la FTI à cet égard nous prendrons trente ans de retard. C’est pourquoi, s’il nous faut, par le biais d’exportations en volume suffisant, maintenir notre compétitivité, il importe également de lever le nez de l’obstacle et, avec les états-majors, la DGA et les universités si nécessaire, voir loin, c’est-à-dire à au moins vingt ans, c’est-à-dire la moitié de la durée de vie de nos matériels.
Mme la présidente Patricia Adam. Je vous remercie, messieurs, d’avoir éclairé nos débats.
*
* *
La commission procède à l’examen, ouvert à la presse, de la proposition de loi visant à expérimenter un service civique de défense (n° 2732) (M. Yves Fromion rapporteur).
M. Yves Fromion, rapporteur. Ayant eu un retour peu positif du ministère de la Défense sur cette proposition de loi, je comprends que les députés n’aient pas été encouragés à se mobiliser en sa faveur. Reste que les auspices n’ont jamais été aussi favorables, puisque j’ai compris que le Président de la République voulait promouvoir le service civique au point de le rendre universel. Le texte que je présente s’inscrit tout à fait dans cette dynamique en ce qu’il vise à offrir une nouvelle forme d’engagement à la jeunesse, en tirant parti des possibilités offertes par la loi du 10 mars 2010 qui prévoit que le service civique se développe au profit de missions de défense voire de sécurité civile. Toutefois, le « statut » des volontaires du service civique ne correspondant pas vraiment à celui des militaires, je suis parvenu à la conclusion que seules des dispositions législatives permettraient l’expérimentation d’un service civique de défense.
Certains jeunes se trouvent dans une situation de marginalisation qui ne favorise pas leur imprégnation par les principes républicains. S’engager dans un service civique au sein de nos forces armées leur permettrait de développer un sentiment d’appartenance à notre collectif et d’adopter une attitude nouvelle.
Le jeune volontaire resterait six mois d’affilée au sein d’une unité, alors que, dans le service civique actuel, ces six à huit mois, voire un an, sont effectués par tranches de vingt-quatre heures par semaine. Nous proposons ici une réelle immersion des jeunes au sein de nos forces armées où ils recevraient une formation initiale de deux mois – que l’enrayement de la déflation des personnels devrait permettre d’assurer. On songe, bien sûr, à ce qui se passait autrefois pendant le service national : au bout de deux mois, nous avions des jeunes à même de remplir des missions militaires. Après, donc, deux mois de formation, les jeunes vivraient les quatre derniers mois au rythme de leur unité : préparation aux opérations, entretien des infrastructures, participation éventuelle aux opérations de protection de la population, à l’exception de l’engagement opérationnel hors du territoire métropolitain. Ils pourraient, par exemple, participer à l’opération Sentinelle avec un encadrement particulier.
Mme la présidente Patricia Adam. Quel serait leur statut dès lors ?
M. le rapporteur. Le jeune volontaire bénéficierait d’un statut particulier qui pourrait s’inspirer de celui du volontariat dans les armées. Un décret prévoirait les dispositions qui permettraient au jeune de remplir la mission qui lui serait proposée. Il préciserait également les conditions de vie des intéressés qui recevraient une gratification de l’ordre de 600 euros par mois –équivalente à celle versée aux volontaires en service civique –, sans doute majorée parce qu’ils ne seraient pas limités à une présence de vingt-quatre heures par semaine. J’insiste sur le fait que l’intégration devrait se faire sur le même modèle que l’incorporation autrefois, par paquets homogènes, de façon à les former en même temps.
Pour ce qui est du financement du dispositif, une partie serait assumée par l’Agence du service civique (ASC), les armées apportant une contribution supplémentaire.
Comment attirer les jeunes dans une aventure si particulière ? Certains sont très demandeurs, d’autres nécessiteraient d’y être poussés, la finalité de la démarche étant, au fond, la même que celle des établissements publics d’insertion de la défense (EPIDE). Ce qui leur est ainsi offert, c’est la possibilité de vivre, pendant six mois, une expérience où ils vont se retrouver face à eux-mêmes, de vivre une vie différente de celle qu’ils ont pu connaître auparavant. Un suivi permettra également d’établir un bilan de leurs capacités, de leurs lacunes, de les aider à préparer un projet et éventuellement de les mettre en contact avec les organismes ad hoc. Tous pourront passer gratuitement leur permis de conduire, qui est un élément très important de l’intégration professionnelle, alors que, dans le cadre du service militaire adapté (SMA), seule une préparation aux épreuves théoriques est proposée.
En somme, nous nous inspirons du service national d’autrefois – dont personne ne peut imaginer qu’il puisse être relancé.
On peut estimer que le service civique de défense pourrait être accompli par environ 5 000 jeunes par périodes de six mois, soit 10 000 jeunes par an à peu près, ce qui représente une ressource considérable. Je n’épiloguerai pas compte tenu de l’issue qu’on peut attendre de l’examen du texte, pourtant il s’agirait d’une opération « gagnant-gagnant », car les armées disposeraient en permanence de 5 000 jeunes motivés, formés, susceptibles de participer à des missions, comme l’opération Sentinelle.
Quand j’étais officier, j’ai eu à commander des unités d’appelés qui, au bout de deux mois, montaient la garde, armés – les choses se passaient ainsi en Algérie. J’ai ensuite appartenu à des unités de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT) dont l’écosystème était formé par l’ensemble des professionnels et des appelés. Au sein du groupement opérationnel, dont j’ai été commandant en second, des forces spéciales du premier régiment de parachutistes d’infanterie de marine (1er RPIMa), c’était des appelés qui faisaient fonctionner le système au sein de la citadelle – alors qu’aujourd’hui, ce sont les membres du même groupement opérationnel qui vont en nettoyer les fossés. Les gendarmes auxiliaires vont aussi sur le terrain au bout de deux mois. On ne peut donc pas raisonnablement soutenir que les jeunes ne peuvent être formés dans ce laps de temps.
Le gain du dispositif que nous proposons est évident et pour les jeunes et pour les armées, sans compter qu’il peut constituer un vivier pour les réserves.
M. Bernard Lesterlin. J’ai été l’un des initiateurs, avec Françoise Hostalier, du texte auquel Yves Fromion se réfère. La proposition de loi recèle de très nombreuses bonnes idées de nature à alimenter notre réflexion sur l’enrichissement de la loi de mars 2010. Elle s’appuie toutefois sur une erreur dont je me sens coresponsable, avec Françoise Hostalier, puisque nous sommes les co-auteurs de l’amendement qui a rédigé l’article L. 120-1 du code du service national, qui dispose que le service civique concourt à « des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention ». Nous avons, en effet, oublié de mettre le mot « civile » au pluriel, alors que nous entendions nous inscrire totalement dans une démarche de prévention et non dans une démarche de défense militaire. Nous avions ajouté le titre Ier bis audit code précisément pour donner un cadre au service civil que nous intitulions « service civique ». Cette disposition de l’article L. 120-1 était, par conséquent, censée évoquer « la défense et la sécurité civiles », à savoir la défense civile et la sécurité civile, mais en rien la participation à une défense à caractère militaire.
Par ailleurs, on ne peut pas créer un nouveau titre du code du service national pour conduire chaque ministère à inventer des missions d’intérêt général pour les jeunes. Il ne me semble pas justifié qu’un nouveau titre du code du service national évoque le service civique de la défense, alors que le service militaire volontaire (SMV) est en cours de mise en place et fait l’objet de nombreuses réflexions, non seulement au sein de l’armée elle-même, mais également au sein du Parlement.
En outre, malgré tout l’intérêt qu’il présente, ce texte est en infraction avec un pilier même du service civique tel qu’il a été conçu et tel que le Parlement l’a voté en 2010 : le service civique ne se substitue pas à l’emploi.
Enfin, puisqu’il est ici proposé d’expérimenter le SMA en métropole et puisqu’il s’agit d’une expérimentation, rien ne justifie de donner au dispositif un support législatif. Le SMA relève du pouvoir réglementaire. L’idée est certainement très bonne, mais il ne faut pas la présenter sous cette forme. Mes objections sont donc de nature juridique.
M. Christophe Guilloteau. Je regrette de ne pas être cosignataire de cette proposition de loi. Reste que je n’ai pas tout à fait saisi de quelle manière cette belle idée devait être financée. Si j’ai bien compris, une partie le serait par l’ASC et l’autre par le budget de la défense – qui, comme on sait, est quelque peu tendu.
Monsieur Lesterlin, si le service civique de défense constitue une substitution à l’emploi, les 100 000 emplois aidés nouveaux n’en prendraient-ils pas, eux aussi, la forme ?
M. Philippe Nauche. La proposition de loi semble avoir un objet similaire au dispositif proposé par le ministre de la Défense dans le projet de loi d’actualisation de la programmation militaire que nous avons adopté en commission la semaine dernière. En outre, je ne saisis pas très bien en quoi elle diffère de l’ancien service national dont elle paraît reprendre des aspects qui n’étaient pas parmi les plus appréciés de nos jeunes concitoyens. Au fond, en marge du cœur de la force d’une unité, vous proposez de confier aux volontaires les petits boulots, au risque de transformer un parcours de citoyenneté en parcours ancillaire. Aussi le groupe Socialiste, républicain et citoyen sera-t-il amené à ne pas adopter ce texte.
M. le rapporteur. Notre proposition n’a rien à voir avec le SMA ni avec le SMV, qui visent à former des jeunes dans une optique professionnelle sans que les armées y trouvent un retour – la Nation est gagnante mais pas les armées. Il s’agit ici de former des jeunes, certes, mais qui participent aux missions de l’unité à laquelle ils appartiennent. Leur osmose avec les jeunes professionnels doit susciter l’évolution de la personnalité des volontaires.
Le dispositif que nous proposons se rapproche plutôt de l’EPIDE – que nous aurions par ailleurs tout intérêt à développer –, même s’ils n’ont plus grand-chose de militaire.
Certes, et j’en puis témoigner, monsieur Nauche, le service national n’avait pas très bonne presse chez les jeunes. On se fait d’ailleurs, aujourd’hui, beaucoup d’illusions sur le service national tel qu’il était. La différence – qui change tout –, c’est qu’à l’époque, il était contraint, alors qu’il est volontaire dans le texte que nous proposons. La question du rejet, de la mauvaise volonté n’a donc pas d’objet ici.
Je ne suis pas entré dans le détail du financement. Il serait mixte et assuré pour partie par l’ASC et pour partie par la structure qui reçoit le jeune. Cette modalité existe déjà dans le cadre du service civique : l’ASC verse un peu moins de 500 euros et la structure qui reçoit le jeune peut apporter un complément de rémunération si elle le juge utile.
Enfin, comme Christophe Guilloteau, je pense qu’on ne saurait parler ici de substitution à l’emploi. Les armées ont leurs effectifs définis par le Livre blanc, la LPM. On permet seulement à des jeunes d’être formés dans le cadre d’une vie militaire qu’ils doivent bien partager – sinon, autant les parquer dans des camps de jeunesse. Nous voulons qu’ils sentent que leur engagement a une finalité, mais ils n’ont en rien vocation à se substituer aux professionnels.
La commission en vient à l’examen de l’article unique de la proposition de loi.
Article unique
La commission rejette l’article unique de la proposition de loi.
En raison du rejet de l’article unique, il n’y a pas lieu pour la commission de se prononcer sur l’ensemble de la proposition de loi, qui est ainsi rejetée.
Mme la présidente Patricia Adam. Je rappelle que la proposition de loi sera examinée en séance publique le jeudi 11 juin prochain.
La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq.
*
* *
Membres présents ou excusés
Présents. – Mme Patricia Adam, M. Nicolas Bays, M. Daniel Boisserie, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Nathalie Chabanne, M. Jean-David Ciot, Mme Geneviève Fioraso, M. Philippe Folliot, M. Yves Foulon, M. Yves Fromion, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Christophe Guilloteau, M. Francis Hillmeyer, M. Laurent Kalinowski, M. Marc Laffineur, M. Gilbert Le Bris, M. Alain Moyne-Bressand, M. Philippe Nauche, M. Gwendal Rouillard, M. Alain Rousset, M. Michel Voisin
Excusés. – M. Olivier Audibert Troin, Mme Danielle Auroi, M. Claude Bartolone, M. Sylvain Berrios, M. Philippe Briand, M. Jean-Jacques Candelier, M. Guy Delcourt, M. Éric Jalton, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Frédéric Lefebvre, M. Bruno Le Roux, M. Maurice Leroy, M. Damien Meslot, M. François de Rugy, M. Stéphane Saint-André, M. Philippe Vitel
Assistaient également à la réunion. – M. Jean-François Lamour, M. Bernard Lesterlin
Lire le compte rendu au format pdf:
Source: Assemblée nationale