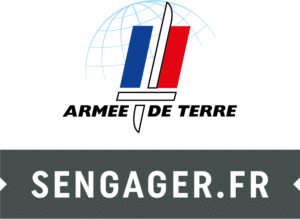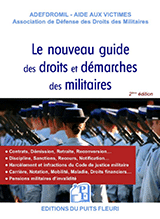Panthéon – Paris – Mercredi 27 mai 2015
Aujourd’hui, la France a rendez-vous avec le meilleur d’elle-même. Ils étaient quatre : deux femmes, deux hommes. Ils sont quatre à entrer aujourd’hui dans le monument de notre mémoire nationale. Ils sont quatre inséparablement liés dans cette célébration qui veut que des personnalités remarquables soient données en exemple à la France tout entière pour inspirer les générations nouvelles. Ils sont quatre. Admirables sans avoir voulu être admirés, reconnus sans avoir cherché à être connus, célébrés sans avoir imaginé être célèbres.
Ils sont quatre, deux hommes, deux femmes. Quatre destins, quatre chemins, quatre histoires qui donnent chair et visage à la République en en rappelant les valeurs. Quatre héros si différents par leurs origines, leurs opinions et leurs parcours. Qu’y a-t-il donc de commun entre ces deux femmes rescapées de l’enfer des camps et ces deux hommes disparus atrocement dans les derniers jours de l’Occupation ? Entre ces deux catholiques qui mirent leur vie au service de la dignité humaine et ces deux francs-maçons qui eurent très jeunes des responsabilités politiques importantes ? Entre ces deux sœurs de combat pour un monde commun et ces deux précurseurs d’une République nouvelle ?
Pourtant, ces deux femmes, ces deux hommes, chacun si singulier, ont été gouvernés par les mêmes forces, animés par les mêmes passions, soulevés par le même idéal, unis les uns, les autres par le même dépassement, indissociablement soudés par le même amour, l’amour de leur patrie. Quatre grandes Françaises et Français qui incarnent l’esprit de la Résistance, l’esprit de résistance. Face à l’humiliation, à l’Occupation, à la soumission, ils ont apporté la même réponse : ils ont dit non tout de suite, fermement, calmement.
En juin 1940, Pierre BROSSOLETTE a 37 ans. Capitaine dans l’armée française, il s’apprête à être démobilisé après une guerre qu’il avait jugée inéluctable. Rendu à la vie civile, il poursuit d’une autre façon le combat. Il devient libraire à Paris, pas simplement pour l’amour des livres mais parce que c’est une couverture qu’il choisit pour des actions clandestines. Il rejoint le réseau du Musée de l’Homme parce que, comme il le dira lui-même : « il faut bien faire quelque chose ». Très vite, il participe à l’action clandestine. Il se rend à Londres à la fin avril 1942, devient l’un des dirigeants des services secrets de la France combattante aux côtés des chefs de la France libre.
Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ, à ce moment-là, n’a pas 20 ans et se nomme DE GAULLE. Le 17 juin 1940, quand elle entend l’insupportable demande d’armistice, elle n’attend pas. Elle n’attend pas l’appel de Charles DE GAULLE, son oncle. Ce sera le lendemain, le 18 juin. Elle le précède parce que, dit-elle : « il y a des moments dans la vie où les uns et les autres se disent tout à coup : c’est inacceptable ». Alors, elle aussi entre tranquillement, sereinement, en clandestinité, non pas pour fuir à cause du nom qu’elle porte, mais pour en être digne. Non pour jouer les utilités mais pour prendre des responsabilités. Non pas pour être une femme à côté des hommes mais pour être une résistante parmi les résistants. Elle participe à la rédaction d’un journal, Défense de la France. Elle se consacre à multiplier les portraits d’un homme qu’elle connaît, Charles DE GAULLE, pour le rendre plus familier encore. Elle brave l’occupant, transmet des renseignements, des informations, elle prend des risques. Elle est arrêtée le 20 juillet 1943 à Paris, déportée six mois plus tard à Ravensbrück. C’est là qu’elle rencontrera Germaine TILLION.
En juin 1940, cette ethnologue a 33 ans. Elle revient d’une mission de six ans dans les Aurès, en Algérie. Elle aussi est membre dès les premiers jours du réseau du Musée de l’Homme, admirable groupe, avec le linguiste Boris VILDE, l’anthropologue Anatole LEWITSKY, qui seront tous deux exécutés au Mont Valérien en 1942 avec la bibliothécaire Yvonne ODDON qui elle, sera déportée. Ce groupe de chercheurs n’est pas simplement des scientifiques révoltés, c’est un groupe organisé qui mène des opérations, un groupe qui ajoute à la rigueur scientifique l’exigence morale. Comme le rappelle Germaine TILLION, « c’est par amour pour notre patrie que nous nous sommes groupés, mais nous ne lui sacrifierons jamais la vérité. » Germaine TILLION est dénoncée, arrêtée en août 1942, gare de Lyon, par la police allemande. Détenue à Fresnes pendant près d’un an, elle est déportée à Ravensbrück le 31 octobre 1943. Elle y éclairera de sa fièvre lumineuse les fantômes en loques parmi lesquels elle retrouve sa propre mère qui périt dans les chambres à gaz en 1945.
En juin 1940, Jean ZAY a 36 ans. Il avait démissionné huit mois plus tôt du gouvernement pour se porter volontaire et rejoindre l’armée française parce qu’il voulait partager le sort de cette jeunesse pour laquelle il avait travaillé au mieux depuis 40 mois comme ministre de l’Éducation. Au moment du désastre, il embarque sur le Massilia. C’était le 20 juin, avec 26 parlementaires dont Pierre MENDÈS FRANCE, Georges MANDEL, Édouard DALADIER. Leur espoir : continuer la guerre depuis l’Afrique du Nord. Arrivé à Casablanca, il est arrêté par les autorités de Vichy, ramené en France, condamné par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand à la dégradation et la déportation au bagne. La même peine que celle infligée à Alfred DREYFUS. C’était sa fierté au moment où il apprit le verdict. Prisonnier politique, Jean ZAY écrit sans cesse. Ses textes sortent de la cellule où il est emmuré grâce à la témérité et à l’ingéniosité de son épouse Madeleine qui cache les documents secrets dans le landau d’une de ses filles. Admirable famille rassemblée dans le malheur et dans l’honneur.
Deux hommes, deux femmes, qui incarnent la Résistance. Pas toute la Résistance, la Résistance a tant de visages : des glorieux, des anonymes, ces soutiers de la gloire, ces soldats de l’ombre qui ont patiemment construit leurs réseaux. Ces partisans pour qui la défense de la patrie s’ajoutait à l’idéal qui les transcendait. Il y avait des Français, il y avait des étrangers qui étaient venus donner leur sang au sol qui les avait accueillis. La Résistance a tant de martyrs : des fusillés, des déportés, des torturés. Communistes, gaullistes, socialistes, radicaux et même royalistes. Ce qu’ils étaient hier, ils ne se le demandaient plus. Ce qu’ils voulaient être, c’est être tous compagnons de la même Libération.
Pierre BROSSOLETTE, Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ, Germaine TILLION et Jean ZAY ne sont pas seuls à se distinguer par l’héroïsme de leurs actes ou la force de leurs exploits. D’autres auraient pu être accueillis ici pour leur dévouement et pour leur bravoure. S’ils sont là, ce n’est pas parce qu’ils sont différents de tous leurs camarades, c’est parce qu’ils symbolisent dans le même ensemble la constance, l’engagement et le courage.
Courage quand Pierre BROSSOLETTE est interpellé en février 1944 en Bretagne et qu’il ne dit rien de son identité. Courage quand il est transféré à Paris au siège de la Gestapo, avenue Foch, et torturé pendant deux jours. Sous les coups de fouet, les châtiments, il ne parle toujours pas. Ce n’est pas le spectacle de ses chairs déchirées, de son sang répandu, ce n’est pas la douleur de sa mâchoire brisée, de ses doigts écrasés qui l’effraient. Non, il pourra tout supporter. Mais le doute le saisit. Et s’il venait à perdre sa lucidité ? S’il venait à dire ce qu’il ne voulait pas avouer, lui, l’homme de raison, lui dont l’intelligence si brillante irradiait jusqu’à irriter, lui que rien ne pouvait arrêter ? Alors, il se précipite du haut de l’immeuble où il est retenu, préférant s’écraser sur le bitume d’une avenue que de se soumettre sur la chaise du tortionnaire. En tombant, il crie encore : « Je ne renonce pas ! » Mourir libre. Oui, mourir pour la liberté.
Courage, quand Jean ZAY, apprenant le succès du Débarquement, le 6 juin, sait alors que sa fin est proche. Que lui importe ! Il a le cœur tranquille. La victoire est acquise. Il peut mourir, la République renaîtra, la patrie vivra, et l’espérance triomphera. Il attend ses assassins. Ils ont déjà perdu la partie. Le 20 juin, ils sont là : des misérables, des miliciens. Ils le sortent de son cachot de la prison de Riom, le traînent quelques kilomètres, l’abattent d’une rafale au lieu-dit « le puits du Diable », comme s’ils voulaient eux-mêmes signer l’infamie de leur forfait. Il a encore le temps de lancer au visage de ses meurtriers : « vive la France ! ». Ils ensevelissent alors son corps sous des rochers comme pour en finir avec le corps même de la République, pour qu’il ne soit jamais retrouvé. Il le fut, en 1948, et Jean ZAY, reconnu « résistant isolé ».
Deux hommes morts quelques jours avant la Libération. Deux hommes qui avaient accompli de grandes choses, mais auraient pu aussi réaliser tant d’autres s’ils n’avaient été ainsi arrêtés.
Germaine TILLION, elle, aura vécu 100 ans. Et durant cette longue existence, elle n’aura laissé aucun répit à la fatalité. Son courage, il est d’abord physique. Jeune ethnologue, elle passe plusieurs années, avant la guerre, avec les Chaouias en Algérie, vivant seule avec eux dans des grottes, sous la tente pour étudier leurs rites, leur culture, leurs usages. Quand, déportée quelques années plus tard, elle porte fièrement sur ce qui lui tient lieu de vêtement, les deux lettres qui identifient « Nuit et Brouillard », elle sait parfaitement que c’est la marque de ceux qui doivent disparaître sans laisser de trace.
Son courage, il est intellectuel. Elle est la voix du savoir et de la connaissance. Elle cherche à décrire méticuleusement le fonctionnement des camps, à le déchiffrer, à le démonter pour mieux s’en dégager, s’en évader, s’en libérer par la force de la raison. Pour expliquer l’inexplicable, pour comprendre l’incompréhensible, pour nommer l’innommable. Au terme de son travail dans la déportation, elle conclut : « nous pouvions lutter puisque nous pouvions comprendre ». Son courage, il est dans sa capacité à s’affranchir du mal en le défiant.
A Ravensbrück, cachée dans des caisses en carton, Germaine TILLION écrit une opérette, pour que le rire généreux de ses camarades déportés puisse répondre au rictus lâche de leurs bourreaux. Oui, une opérette pour pouvoir défier le mal par le rire.
Son courage, il est politique. Elle n’était membre d’aucun parti sauf celui de la chair souffrante de l’Humanité. Courage quand elle dénonce dès 1948 avec David ROUSSET, l’univers concentrationnaire au-delà du Rideau de fer, car pour elle, il n’y a pas de frontière dans l’horreur. Courage quand elle dénonce, dès 1957, la torture en Algérie, la révèle au monde, dénonce l’engrenage et la mécanique infernale de la répression aveugle. Courage quand elle rencontre secrètement les dirigeants du FLN lors de la bataille d’Alger parce qu’elle croit à une impossible trêve et comprend que la paix passe par l’indépendance. Courage parce que, jusqu’aux mois ultimes de sa longue vie, elle a épousé la souffrance humaine, vilipendé l’esclavage contemporain, dénoncé le sort fait aux migrants, le délabrement des prisons françaises ; parce que ce qu’elle voulait, ce qu’elle cherchait, c’était à protéger les victimes de l’avenir, plutôt que de venger celles du passé. Le courage donc comme un cri d’indignation, mais comme un appel à la justice, répété autant de fois qu’il le faut pour que l’intolérable ne soit pas toléré.
Courage que celui aussi de Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ. Elle a pensé tant de fois sa fin prochaine. Arrêtée en 1943, face à la Gestapo, elle ne dissimule rien de son identité. DE GAULLE ? Elle s’en réclame. DE GAULLE, elle clame qu’elle porte ce nom. Elle le proclame. DE GAULLE comme une invocation, DE GAULLE comme une provocation, DE GAULLE comme une vocation.
A Ravensbrück où elle est déportée, l’odeur de la chair brûlée enveloppe le camp comme une brume qui ne se dissipe jamais. Il y a là des femmes venues de toute l’Europe, soumises aux violences, aux expérimentations médicales, aux humiliations, aux stérilisations. Il y a là des femmes sublimes : Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, Anise POSTEL-VINAY, Jacqueline PERY D’ALINCOURT, ces femmes qui seront des sœurs de souffrance et d’espérance.
Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ est à bout de force, harassée, battue, malade, presque aveugle. C’est alors qu’elle est installée dans une cellule individuelle où elle pouvait manger, dormir parce qu’elle était devenue, à la fin de la guerre, une monnaie d’échange pour les Nazis, en raison du nom qu’elle porte. C’est lorsqu’elle perd la présence de ses camarades déportées, c’est dans cette solitude, qu’elle pense alors au soulagement que pourrait lui procurer la mort. C’est là qu’elle connaît, comme elle l’a décrit elle-même, « la traversée de la nuit ». C’est là qu’elle comprend et qu’elle veut faire comprendre que la véritable force est dans la solidarité humaine, et qu’il n’y a pas de courage s’il n’est pas partagé.
Deux femmes, deux hommes, quatre engagements.
Jean ZAY, c’est la République. La République parlementaire dont il est l’un des plus talentueux représentants ; il y siège à l’âge de 27 ans. La République laïque, qu’il défend comme ministre de l’Education, en rappelant, par voie de circulaires – elles valent encore aujourd’hui – que « les écoles doivent rester les asiles inviolables où les querelles des hommes ne pénètrent pas ». La République sociale, qu’il considérait comme l’aboutissement du chemin vers l’égalité. La République émancipatrice qui travaille inlassablement à promouvoir l’accès de tous au savoir, à la connaissance, à la culture, à tout ce qui est beau et qui élève l’esprit autant que les conditions, qui donne une âme à la conscience commune.
Assassiner Jean ZAY, c’était pour ses meurtriers, profaner la République. Il rassemblait sur lui les haines dont Vichy s’était emparées. Haine du protestant, haine du juif, parce qu’il était, par ses origines familiales, les deux à la fois. Haine du franc-maçon, du libre penseur, haine du Front populaire, haine de la Ligue des Droits de l’Homme, haine de la démocratie.
Soixante-dix ans après, ces haines reviennent, avec d’autres figures, dans d’autres circonstances, mais toujours avec les mêmes mots et les mêmes intentions. Elles frappent des innocents, des journalistes, des juifs, des policiers, et c’est pour conjurer cette résurgence funeste que les Français, le 11 janvier, se sont levés. Parce qu’ils n’ont jamais peur, jamais peur de défendre la liberté. Tous n’étaient pas là, ce jour-là. Mais la marche était pour tous. Pour la liberté.
C’est au nom de la liberté que Pierre BROSSOLETTE s’est convaincu, lui l’apôtre d’Aristide BRIAND, le pacifiste, l’européen, que la guerre et la force, étaient le prix de la sauvegarde de l’essentiel. C’est la liberté qui lui avait donné la lucidité de s’élever contre le fascisme, contre le nazisme, contre le totalitarisme. C’est la liberté qui avait fait de lui un antimunichois contre le lâche soulagement. C’est la liberté, la liberté toujours qui le poussa à unir la Résistance intérieure autour des réseaux et des mouvements, et pas des partis politiques.
La refondation de la République, pour Pierre BROSSOLETTE, ne devait pas se résumer à son rétablissement. Il n’aspirait pas à une réplique mais à une renaissance. C’était un Français libre au point de négliger les consignes de Londres parfois. C’était un socialiste libre au point de travailler au dépassement de sa propre formation politique. C’était un gaulliste libre au point de braver l’autorité du Général DE GAULLE en considérant qu’une conscience peut toujours parler d’égal à égal à une autre conscience.
Liberté qu’il a choisie jusqu’à l’ultime seconde de sa vie. Entendons le message qu’il avait adressé comme un testament le 18 juin 1943 à Londres : « les morts de la France combattante ne nous demandent pas de les plaindre, mais de les continuer. Ils n’attendent pas de nous un regret, mais un serment ; pas un sanglot, mais un élan. » Ce message, il résonne en cet instant en chacun d’entre nous : continuer, jurer que nous serons fidèles à ceux qui sont tombés pour notre liberté. Avoir cet élan qui permet d’essuyer les plaies et les peines pour aller vers l’essentiel.
Entendons aussi Germaine TILLION nous prévenir : « il n’existe pas un peuple qui soit à l’abri d’un désordre moral collectif ». Elle s’est attachée à en comprendre les causes. Historienne des camps nazis, elle en avait décrypté les logiques intrinsèques. Ethnologue de l’Algérie, elle avait anticipé ce que la colonisation allait produire. Scientifique émérite, elle avait analysé les enchaînements des servitudes, des soumissions, des exploitations. Elle voulait comprendre pour porter l’idée lumineuse de l’Humanité.
C’est au nom d’une Humanité blessée qu’elle est solidaire des peuples victimes. C’est au nom de l’Humanité oubliée qu’elle est aux côtés des opprimés, des minorités, des réprouvés. C’est au nom de l’Humanité humiliée qu’elle s’élève toujours pour l’émancipation, la dignité, l’égalité des femmes. Aujourd’hui, Germaine TILLION serait dans les camps de réfugiés qui attendent les exilés de Syrie et d’Irak. Elle appellerait à la solidarité pour les Chrétiens d’Orient. Elle se serait sans doute mobilisée pour retrouver les filles enlevées par Boko Haram au Nigéria. Elle s’inquiéterait du sort des migrants en Méditerranée. Pour elle, la compassion n’est pas la charité. Elle n’est pas une élégance de l’âme, elle est une force de l’esprit, elle est l’honneur d’une nation.
En République, la compassion s’appelle Fraternité. C’est au nom de la Fraternité que Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ voulait inscrire dans le marbre de la loi le droit à la dignité. Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ s’était convaincue à Ravensbrück que ce qui reste à un être affamé, épuisé, battu, c’est son identité. Elle avait compris que, ce que voulaient les nazis, en mettant les déportés dans la boue, c’était les confondre, les réduire à la boue. Elle avait saisi, dans la nuit qu’elle avait traversée, qu’il suffisait d’un regard, d’une main, d’un sourire pour que l’espoir revienne.
Elle eut cette révélation lorsqu’un soir d’octobre 1958, elle visite avec le Père Joseph WRESINSKI, un regroupement de 252 familles entassées dans des baraques à Noisy-le-Grand, sur un terrain clos de grillages. Elle y voit des visages qui lui rappellent les fantômes de son passé. Sa vie sera alors désormais avec les invisibles : ne pas être leur voix mais les faire parler, ne pas les assister mais les libérer, ne pas les soulager mais les relever. Elle utilisera son nom, DE GAULLE, comme un drapeau pour éradiquer les bidonvilles, pour mobiliser le peuple du Quart-monde, pour lancer à son tour elle-même son appel contre la pauvreté, la misère, l’exclusion. Elle lève elle aussi une armée, une armée des ombres : celle des pauvres, pacifique, exigeante, prête encore aujourd’hui à demander ses droits.
Une vie de principes, de vertus, de dévouement ne vaut pas à elle seule d’entrer dans ce haut lieu de la République, le Panthéon, et d’être érigé en exemple. Il faut y ajouter une trace, un legs, une œuvre.
Celle de Jean ZAY comme ministre de l’Education nationale est considérable. La République lui doit les trois degrés d’enseignement, l’unification des programmes, la prolongation de l’obligation scolaire, les classes d’orientation, les activités dirigées, les enseignements interdisciplinaires, la reconnaissance de l’apprentissage, le sport à l’école, les œuvres universitaires… On croirait qu’il s’agit d’un programme d’aujourd’hui. Son audace réformatrice ne s’arrêta pas là. C’est Jean ZAY qui conçut le Centre national de la recherche scientifique. C’est Jean ZAY qui créa le Musée des arts et traditions populaires, le Musée d’art moderne, la Réunion des théâtres nationaux et même le Festival de Cannes.
Nul ne doit imaginer, le temps ayant passé, que ce fut facile. Les blocages furent multiples, les oppositions rudes et les préjugés nombreux. Mais il tint bon parce que la justice sociale exige que, quel que soit son point de départ, chacun puisse aller dans la direction choisie, aussi loin et aussi haut que ses aptitudes le lui permettent. Ce projet, ce beau projet, est toujours le nôtre. C’est par l’école que la République reste fidèle à sa promesse, c’est par l’excellence qu’elle élève le plus grand nombre et qu’elle renforce le rayonnement du pays. C’est par la laïcité qu’elle dresse un mur infranchissable devant ceux qui veulent diviser les Français et c’est par l’intégration qu’elle fait aimer la France. Que les collégiens, lycéens d’aujourd’hui dont l’établissement porte le nom de Jean ZAY soient fiers de voir entrer ici celui qui a imaginé le siècle suivant, c’est-à-dire le vôtre, comme celui de la démocratisation de la connaissance.
Pierre BROSSOLETTE, lui, n’a jamais gouverné, il n’en a pas eu le temps. Il n’a donc laissé aucune loi, aucun règlement, aucune circulaire, pas même un programme. Mais, il a fait davantage : il a appelé à la réforme, à l’audace, au renouvellement. Il ne demandait pas une République. Il n’appelait pas le retour de la République. Il voulait une République moderne, une République ouverte, une République généreuse, une République exigeante.
La tâche n’est toujours pas finie. Nous devons la mener jusqu’au bout pour un Etat plus simple, pour des territoires équilibrés, pour des procédures modernisées. Réformer pour ne rien refermer, réformer pour progresser, réformer pour avancer, réformer pour transformer.
Pour Pierre BROSSOLETTE, c’est la jeunesse combattante qui avait « effacé les rides qui fanaient les visages de la patrie, qui avait essuyé les larmes de l’impuissance, qui avait racheté les fautes dont le poids la courbait. ». Encore aujourd’hui cette jeunesse qui est toujours combattante réclame qu’on lui fasse confiance. La jeunesse est la première qualité que doit savoir garder un vieux pays comme le nôtre. A nous de lui faire la place, la place qu’elle mérite, de lui donner ses chances, de lui offrir l’espoir de la conquête, de la regarder avec bienveillance et de ne jamais distinguer entre nos enfants. Et quand certains rencontrent des difficultés, de ne jamais leur fermer la porte. Et si l’intégration connaît des ratés, et il y en a, ce n’est pas la faute de la République, c’est faute de République.
Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ est sans doute l’une des femmes, elle, qui sans jamais avoir été parlementaire a pu s’exprimer à la tribune de l’Assemblée nationale et donner son nom à une loi : la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Parce qu’elle voulait, cette grande dame, porter son combat sur le terrain du droit. Parce qu’elle entendait sortir son peuple de l’ombre par la lumière de l’expression de la volonté générale. Parce qu’elle estimait que la pauvreté n’est pas une fatalité individuelle mais une défaillance collective. Parce qu’elle voulait inscrire le respect de la dignité de tous dans le marbre de la République. Elle savait bien qu’il ne suffit pas d’une loi pour éradiquer la pauvreté et assurer l’accès de tous aux droits fondamentaux.
En près de 20 ans, hélas, le nombre d’enfants pauvres, de familles pauvres, n’a pas diminué. Alors il nous revient d’agir encore pour que le droit au travail, à la santé, au logement, à la culture, ne soient pas des mots pieusement conservés dans les journaux officiels de la République française mais soient d’ardentes obligations que seul un sursaut de l’ensemble de notre pays pourra réussir à honorer. Pour que la solidarité ne soit pas regardée comme de l’assistance, pour que les pauvres ne soient pas soupçonnés de vouloir le rester et pour en finir avec la stigmatisation de l’échec. Pour que nous ne soyons pas indifférents.
L’indifférence, voilà l’ennemi contemporain. Indifférence face au fanatisme, au racisme, à l’antisémitisme. Indifférence face aux injustices, aux inégalités, aux indécences. Indifférence face aux catastrophes, au désordre climatique, à l’épuisement de notre planète.
Face à l’indifférence, chaque génération a un devoir de vigilance, de résistance. Et chaque individu a le choix d’agir. Tout commence par un choix, même si l’on mesure rarement à l’avance là où il peut conduire. Jusqu’à quels abandons, jusqu’à quels renoncements si ce choix est mauvais, jusqu’à quel accomplissement, à quel dépassement s’il est bon.
C’est le choix qui distingue, qui élève ou qui abaisse. Qui transfigure ou qui défigure. Comme hier dans la tragédie de la guerre, quand des hommes et des femmes de toutes les opinions, de tous les milieux, de tous les âges, ont décidé de faire quelque chose. Ils l’ont fait parce qu’ils l’ont choisi. Et à notre tour, nous devons faire les choix qui correspondent aux défis d’aujourd’hui.
Ces deux femmes, ces deux hommes, ont en commun d’avoir fait de leur vie un destin et d’avoir donné à leur patrie une destinée. Tel est le sens de cette cérémonie.
L’histoire, la nôtre, l’histoire de France, nous élève. Elle nous unit quand elle devient mémoire partagée. L’histoire, elle nous montre la grandeur des femmes et des hommes qui l’ont faite. Elle nous montre aussi ce que sont nos forces et ce que peuvent être nos faiblesses. L’histoire, elle nous donne bien plus qu’un héritage à célébrer, bien davantage qu’un patrimoine à entretenir. L’histoire nous transmet l’éminente responsabilité d’être à la hauteur, à la hauteur du passé, à la hauteur des défis d’aujourd’hui et de demain.
En sachant que l’histoire n’est pas une nostalgie, l’histoire, elle est ce que nous en ferons. L’histoire, elle est notre avenir.
La France vient de loin. La France porte au loin. La France doit voir loin. Ces quatre grandes figures aimaient plus que tout la France et en l’aimant, en l’aimant si chèrement, ils servaient l’humanité tout entière. Chacune, chacun dans sa singularité a cherché au fond de lui-même ou d’elle-même ce qu’il avait de meilleur à donner et c’est pourquoi tous les quatre, ces deux femmes, ces deux hommes, ont valeur d’exemple.
Il nous appartient de les suivre, non pas de répéter ou de reproduire – les circonstances ont changé – mais de poursuivre et d’inventer. La République n’est pas figée. Ce n’est pas un corset dont il faudrait régulièrement recoudre les boutons. La République, c’est un mouvement, c’est une construction, c’est une passion, une passion généreuse, une passion rationnelle, une passion rassembleuse, avec toujours, toujours le refus de la fatalité. Ne pas plier, ne pas se replier, espérer et lutter. Tel est l’esprit inextinguible, inépuisable de la Résistance, de l’esprit de résistance.
Pierre BROSSOLETTE, Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ, Germaine TILLION, Jean ZAY, prenez place.
Vous êtes accompagnés par le long cortège des jeunes qui vibrent à l’idée de prendre la relève de la France combattante. Vous êtes accompagnés par les femmes qui savent, à votre exemple, qu’aucune porte ne peut plus leur être fermée. Vous êtes suivis par les déshérités qui entrent grâce à vous dans la lumière. Vous êtes auréolés du respect des peuples du monde qui, comme le 11 janvier, partagent avec le nôtre le même amour de la liberté.
Pierre BROSSOLETTE, Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ, Germaine TILLION, Jean ZAY, prenez place ici, c’est la vôtre.
Vive la République et vive la France !
Source: site http://www.elysee.fr droits de reproduction réservés et strictement limités.