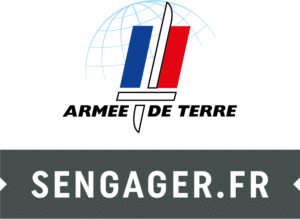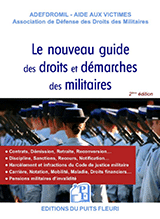5° Violation de l’article 14 de la Convention en ce que les arrêts du 11 décembre 2008 et du 4 mars 2009 considèrent comme légitime la discrimination pratiquée à l’égard de la requérante et concernant son droit d’ester en justice.
52 – En premier lieu, l’Adefdromil fait l’objet d’une discrimination sans fondements objectifs par rapport aux autres associations qui sont comme elle régulièrement déclarées et dont l’objet social n’a jamais été contesté devant le juge judiciaire. Toutes, conformément à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 peuvent ester en justice.
53 – En second lieu, l’Adefdromil fait l’objet d’une discrimination par rapport à d’autres associations ou fédération d’associations s’occupant de la condition militaire des personnels en activité de service et dont l’action n’est pas entravée. Tel est le cas de l’Union Nationale des Parachutistes, dont l’un des buts est de « défendre les intérêts moraux et sociaux des parachutistes et de leurs familles.. » (pièce n°60). C’est aussi celui de La Saint Cyrienne, association regroupant les anciens élèves de Saint Cyr, école militaire qui forme en France les officiers de l’armée de terre et de la gendarmerie. La Saint Cyrienne publie une revue trimestrielle intitulée « Le Casoar », dont le numéro daté d’octobre 2006 est consacré à la condition militaire comme l’atteste la page de couverture (pièce n°61). Il en est de même de l’Union Nationale des Personnels en Retraite de la Gendarmerie qui édite un mensuel : « L’Essor de la Gendarmerie Nationale », dont le numéro 397 de décembre 2007 traite, par exemple et sans retenue, de la condition militaire des gendarmes (pièce n°62). En contradiction complète avec le contenu des débats sur le statut général des militaires (pièce n° 29), les associations de retraités sont d’ailleurs invitées régulièrement, soit par le ministre de la défense ou ses services, soit par le président de la commission de la défense et des forces armées de l’Assemblée Nationale à exposer leur point de vue sur la condition militaire des personnels en activité de service comme l’atteste le compte-rendu de leur audition en date du 28 janvier 2009 (pièce n°66). Le Mouvement des Femmes de Gendarmes (pièce n°8), qui avait sollicité la requérante en 2001 pour qu’elle participe à des manifestations de rue est devenu depuis l’association d’aide aux membres et familles de la gendarmerie (AAMFG). Sur son site, cette association affirme : « il n’en demeure pas moins que ce mouvement associatif d’expression corporatiste sera en mesure de se faire entendre y compris par des moyens sortant de l’ordinaire ». Les buts et les moyens clairement affichés de l’association n’ont pas dissuadé pour autant les sénateurs de l’entendre dans le cadre du rapport sur la gendarmerie en 2008 (pièce n°52).
La discrimination infligée à la requérante est encore plus évidente lorsqu’on compare sa situation avec celle dela FNAME : Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures qui regroupe des anciens militaires et des militaires en activité de service, ayant effectué des missions extérieures.
Cette association a pour objet (pièce n°63) :
« Titre I : Constitution
Article 1 : Constitution et Dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, personnes physiques ou morales, une association dénommée Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures. Cette Fédération est régie par la loi du 01 juillet 1901.
Cette Fédération est constituée d’Associations Régionales et Départementales des Anciens des Missions Extérieures.
Article 2 : Objet
Cette Fédération nationale a pour but de permettre aux personnes qui ont fait des Missions Extérieures et des Opérations Extérieures (OPEX) de :
- se regrouper pour faire connaître leur mission,
- venir en aide à leurs compagnons blessés,
- faciliter la réinsertion de leurs compagnons (emploi, logement, moral),
- contribuer à des actions humanitaires et de paix,
- établir des relations entre leurs compagnons restés en mission pour leur assurer un soutien moral,
- oeuvrer pour l’obtention d’une carte et d’un statut d’Ancien Combattant,
- promouvoir l’esprit civique et la valeur morale de l’armée,
- réfléchir dans les domaines de la défense, de la diplomatie et de la stratégie,
- nouer des liens avec d’autres associations d’Anciens Combattants nationales et internationales,
- établir des échanges entre l’armée professionnelle, l’armée de réserve et les associations patriotiques. »
Dans les faits, les bénéficiaires de l’action de cette association sont aussi bien des anciens militaires que des militaires en activité de service ayant effectué des opérations extérieures. Elle s’occupe donc de la condition militaire de personnels en activité de service. Elle constitue par conséquent un groupement professionnel au sens de l’article L4121-4 du code de la défense qui a repris les termes du statut général de 1972.
En 1997, la FNAMEforme un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler le décret n° 97-424 du 29 avril 1997 portant création de la médaille d’Afrique du Nord. Sa requête est examinée au fond par le Conseil d’Etat et rejetée, le 29 avril 1998 (pièce n°64), aux motifs suivants :
« Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret attaqué du 29 avril 1997 :”Le diplôme dénommé titre de reconnaissance de la nation qui reconnaît les services rendus à la nation par les militaires et civils ayant participé aux opérations d’Afrique du Nord, donne droit au port d’une médaille dite “médaille d’Afrique du Nord”” ;
Considérant que le décret du 29 avril 1997, portant création de la médaille d’Afrique du Nord au profit des militaires et civils, titulaires du titre de reconnaissance de la nation, ayant participé aux opérations d’Afrique du Nord, n’a méconnu ni l’article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre, ni le principe d’égalité ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES n’est pas fondée à soutenir que ledit décret est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES et au secrétaire d’Etat aux anciens combattants. »
A aucun moment, le défaut d’intérêt à agir de cette association n’est soulevé par le ministre.
En 2003, l’association revient devant le Conseil d’Etat. Elle demande au Conseil d’Etat d’enjoindre à l’administration de prendre un acte reconnaissant, conformément aux dispositions de l’article R.14a du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice d’une campagne double aux militaires français qui ont participé aux opérations militaires de la guerre du Golfe à compter du 30 juillet 1990.
Par un arrêt du 17 mars 2004 (pièce n°65), le Conseil d’Etat fait droit à la requête de l’association :
« Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES a, par une lettre du 25 novembre 2002, reçue le 2 décembre, saisi le ministre de la défense d’une demande tendant à que soit prise une décision accordant le bénéfice de la campagne double aux militaires français ayant participé aux opérations de la guerre du Golfe à compter du 30 juillet 1990 ; que le silence gardé sur cette demande par le ministre pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat par la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES doivent être regardées comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée de ce que la requête ne comporterait que des conclusions aux fins d’injonction, ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : (…) c) bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer ; qu’aux termes de l’article R. 14 du même code : Les bénéfices de campagne prévus à l’article L. 12 c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après…
Considérant que les dispositions qui précèdent font obligation à l’administration de prendre les décisions de nature réglementaire définissant la nature et la durée des bénéfices de campagne attribués aux militaires français pour le temps pendant lequel ils sont effectivement engagés dans des opérations de guerre ;
Considérant qu’il est constant que la guerre du Golfe, menée, sur la base de la résolution n° 678 du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, pour rétablir la souveraineté internationale du Koweit, a comporté des opérations militaires qui ont présenté le caractère d’opérations de guerre et dans lesquelles des forces françaises ont été engagées ; qu’elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme des opérations de maintien de l’ordre, au sens des dispositions de la loi du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances ; que, par suite, l’arrêté interministériel du 30 octobre 1990 qui ouvre le bénéfice des dispositions de la loi du 6 août 1955 aux militaires ayant accompli des services au cours des opérations militaires conduites dans la région du Golfe Persique et du Golfe d’Oman à compter du 30 juillet 1990, n’a pu constituer la décision rendue nécessaire par les dispositions précitées de l’article R.19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu’il suit de là que la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS DES MISSIONS EXTERIEURES est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que n’était pas satisfaite la condition relative à l’existence d’opérations de guerre au sens des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ;
Considérant que la présente décision d’annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une décision déterminant les conditions dans lesquelles les militaires français ayant servi dans les forces françaises engagées dans les opérations de la guerre du Golfe bénéficient des dispositions de l’article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Aussi bien dans le cas du PACS (Adefdromil) que dans celui de l’attribution d’un bénéfice de campagne (FNAME), il s’agit d’un problème de condition militaire touchant des personnels en activité de service. Les requêtes formulées ont toutes deux des implications financières non négligeables.
Or, le Conseil d’Etat fait droit à la requête de la FNAME tandis qu’il déboute l’Adefdromil de sa demande d’annulation pour « défaut d’intérêt à agir ».
Il appartient donc à la haute partie contractante de donner les raisons objectives justifiant selon elle la différence de traitement appliquée à l’Adefdromil. A défaut de produire des éléments probants au jugement de votre haute juridiction,la Francedevra être condamnée pour discrimination injustifiée et contraire à l’article 14 de la convention, du fait des arrêts du Conseil d’Etat du 11 décembre 2008 et du 4 mars 2009.
6° Violation de l’article 11 de la Convention en ce que les arrêts du 11 décembre 2008 et du 4 mars 2009 considèrent que l’interdiction d’ester en justice infligée à une association légalement déclarée et dont la licéité de l’objet n’est pas contestée peut faire partie :
a) des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ;
b) des restrictions légitimes à l’exercice du droit d’association par les membres des forces armées prévues par l’article 11-2° de la convention.
54 – La mesure n’est pas nécessaire.
Il est évident que l’interdiction d’ester en justice infligée à une association régulièrement déclarée n’est pas nécessaire, dans la société française, à la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d’autrui.
Elle n’est pas non plus nécessaire au maintien de la discipline militaire dans l’armée française.
En effet, une action en justice est par définition un mode de règlement pacifique, légal et légitime et de résolution des conflits sociétaux.
En refusant à l’Association de Défense des Droits des Militaires d’ester en justice, le Conseil d’Etat rejette ce principe et indique que les militaires ou une association qui défend leurs intérêts commettent un acte d’indiscipline en usant d’une voie de droit.
Dans les faits, les actions de l’Adefdromil n’ont jamais débouché sur des actes d’indiscipline. Bien au contraire, la requérante a toujours pris soin de prôner un strict respect de la légalité républicaine et démocratique. En particulier, elle n’a jamais appelé à des manifestations de militaires, d’ailleurs pénalement sanctionnables. Elle ne s’est jamais livrée à des distributions de tracts à la porte des casernes.
Il appartient donc à la France de démontrer en quoi un recours pour excès de pouvoir peut menacer la discipline militaire et en quoi l’interdiction d’ester en justice était « nécessaire ».
Le problème a d’ailleurs été bien analysé par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions (pièce n°39) : « Avec l’article L.4121-4 du code de la défense, vous êtes confrontés à une situation a priori différente, qui appelle une réponse moins implicite mais aussi moins évidente, compte tenu, entre autres, de la rédaction du texte qui, littéralement, n’interdit pas le syndicalisme militaire mais le proclame « incompatible avec la discipline militaire ».
On peut certes y voir une périphrase de l’interdiction – c’est le sens des débats parlementaires même s’ils n’expliquent pas le choix des termes employés– et par suite en déduire, comme le ministre, l’incapacité de l’association à agir pour défendre son objet. Il y aurait là l’effet de cette loi conjugué avec l’idée que la légalité et la licéité ne doivent faire qu’une seule et même chose au regard de la recevabilité de l’action en justice.
Mais ce n’est pas la seule lecture ni la seule construction juridique possibles. L’existence formelle d’une personne morale – ici la déclaration de l’association et l’accomplissement des formalités de publicité ou même sa seule existence – pourraient suffire pour agir en justice, d’autant plus que cette action pourrait en l’espèce n’être pas regardée par principe comme « incompatible avec la discipline militaire ».
En effet, tant que l’association n’a pas été dissoute, elle existe légalement et ce qui est incompatible avec la discipline militaire, ce sont, pour reprendre les propos de la commission de révision « l’ingérence dans l’activité des forces, la remise en question de la cohésion des unités, voire de la disponibilité et du loyalisme des militaires » et non le recours pour excès de pouvoir.
L’action contentieuse n’emporte pas, de prime abord, des risques aussi élevés que l’action revendicative dans les enceintes militaires ou sur les théâtres d’opération puisqu’à titre individuel les militaires n’en sont pas privés. Par ailleurs, le droit au recours ou le droit au juge – que n’invoque pas l’association mais qui peuvent servir de guide à l’interprète – pourraient exiger que les restrictions de capacité soient justifiés par des motifs supérieurs, surtout s’agissant du REP, comme le montrent nombre de vos arrêts (entre autres Ass. 17 février 1950 Ministre de l’agriculture c/ Dme Lamotte p 110) et surtout s’agissant du recours pour excès de pouvoir d’une association. Alors même que la loi du 1er juillet 1901 dispose que les associations ne « jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5 », c’est-à-dire à la déclaration, vous avez dans la décision Syndicat de défense des canaux de la Durance donné raison au commissaire du Gouvernement Riboulet qui dans l’affaire Polier déclarait « l’action de cassation administrative n’est pas fonction de la capacité juridique de celui qui l’invoque ». Enfin, il est loisible à l’administration de poursuivre la dissolution de l’association si elle estime que les risques sont trop importants. Elle les tolère aujourd’hui, jugeant préférable de ne pas voir à nouveau surgir dans le débat public cette question sensible.
Cette solution, qui ne diffèrerait que par ses seuls motifs, de celle que nous avons écartée tout à l’heure, mais aurait le mérite, difficilement contestable en soi de reposer aussi sur une interprétation de l’article L.4121-4 du code de la défense, ne nous satisfait pas non plus.
Ecartons le droit au juge ou au recours dont aucune juridiction nationale ou internationale n’a à notre connaissance affirmé qu’il était absolu, et donc non subordonné à la capacité et à l’intérêt à agir, comme l’est, avec d’autres, le recours pour excès de pouvoir. Il n’y a donc aucun déni de justice, contrairement à ce que soutient l’association, à se convaincre de l’illégalité des dispositions réglementaires attaquées tout en lui refusant le droit de les contester, sachant que d’autres étaient ou sont recevables à le faire par voie d’action et d’exception. »
Malheureusement, sans doute par pusillanimité, M. Boulouis, haut fonctionnaire et membre du Conseil d’Etat, ne va pas jusqu’au bout de son raisonnement et préfère écarter la reconnaissance du droit d’ester en justice de la requérante, au motif que ce droit aurait pu être exercé à titre individuel par des militaires lésés par les décrets attaqués. Cet argument de pure forme ne tient nullement compte de la réalité de la vie militaire. Un militaire qui intente un recours pour excès de pouvoir contre un décret est immédiatement « catalogué » et même si sa démarche ne figure pas systématiquement dans son dossier, sa hiérarchie prend discrètement les dispositions pour l’écarter de postes de responsabilité, pour lui donner une affectation peu intéressante, pour sanctionner la moindre de ses erreurs et le contraindre à quitter l’institution. C’est d’autant plus facile lorsqu’il s’agit d’un militaire sous contrat (70 % environ de l’armée française), puisqu’il suffit de ne pas renouveler le contrat à l’échéance. Ainsi, dans l’ouvrage particulièrement célèbre en droit français dénommé « Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (15ème édition), les auteurs, messieurs Long, Weil, Braibant, Devolvé, et Genevois, précisent dans le commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 1906 –Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges– que « fréquemment les fonctionnaires hésitent à former eux-mêmes un recours qui pourrait leur attirer l’animosité de leurs supérieurs et qu’ils seraient mieux à même de défendre leurs droits si l’action syndicale était plus largement accueillie. » (pièce n°38).
55 – La mesure est illégitime.
La loi française (Loi du 1er juillet 1901 – pièce n°3) dispose à son article 6 :
« Article 6 Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels… »
L’association n’a jamais fait l’objet d’une action en justice pour faire déclarer l’illicéité de son objet social selon la procédure prévue par l’article 7 de la même loi :
« Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 7
En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. »
De plus, l’intérêt à agir a été reconnu dans la décision du 27 novembre 2002, qui a rejeté au fond un recours pour excès de pouvoir de la requérante (pièce n°42).
La jurisprudence de la Cour.
S’agissant de l’intérêt à agir, la Cour a statué de la manière suivante dans une décision du 15 janvier 2009 (CINQUIÈME SECTION : AFFAIRE LIGUE DU MONDE ISLAMIQUE ET ORGANISATION ISLAMIQUE MONDIALE DU SECOURS ISLAMIQUE c. France – Requêtes nos 36497/05 et 37172/05) :
« 48. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Ce principe de la sécurité des rapports juridiques, en tant qu’il constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, exige que soit assurée une voie judiciaire effective permettant à chaque justiciable de revendiquer ses droits civils (Brumarescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII).
49. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
50. La Cour rappelle à cet égard que les restrictions à la capacité d’ester en justice doivent être strictement limitées. Ainsi dans l’arrêt Eglise catholique de la Canée c. Grèce (16 décembre 1997, §§ 40-42, Recueil 1997- VIII), elle a considéré qu’en jugeant que la requérante se trouvait dans l’incapacité d’ester en justice, faute de disposer de la personnalité juridique, les juridictions civiles n’avaient pas seulement sanctionné l’inobservation d’une simple formalité nécessaire à l’ordre public, mais lui avaient imposé une véritable restriction l’empêchant de faire trancher par les tribunaux tout litige relatif à ses droits de propriété (voir aussi Les Saints Monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 83, série A no 301-A).
51. En outre, la Cour a affirmé, à plusieurs reprises, que la notion de « droit » ou de « loi », qui figure explicitement ou implicitement dans tous les articles de la Convention, implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (voir, notamment, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002).
52. La Cour note que la loi du 1er juillet 1901, en ses articles 2 et 5, règle les questions afférentes à la création d’associations et à la reconnaissance de la capacité juridique de celles-ci, qui se fait au moyen d’une déclaration préalable auprès des autorités préfectorales. Plus précisément, l’article 5 alinéa 3 de la loi prévoit que lorsqu’une association a son siège social à l’étranger, la déclaration préalable en vue de l’obtention de la capacité juridique doit être faite à la préfecture du département où se situe le siège de son principal établissement. Or, de par les termes utilisés, cet alinéa a vocation à s’appliquer aux associations étrangères qui souhaitent s’établir sur le territoire français pour exercer une activité. Il ne vise pas expressément la question de la capacité d’ester en justice d’une association, comme les requérantes, qui a son siège social à l’étranger, n’exerce aucune activité en France, mais souhaite introduire ponctuellement une action en justice pour défendre ses droits de caractère civil. »
En outre, il est rappelé que la jurisprudence de votre Cour a considéré que l’interdiction imposée à des fonctionnaires municipaux de créer un syndicat violait l’article 11 de la Convention. Mutatis mutandis, il en est de même pour l’interdiction faite aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements professionnels comme cela a été démontré au paragraphe 47 supra. (Affaire DEMIR et BAYKARA contre Turquie : litige opposant la Turquie à deux de ses ressortissants turcs auxquels il avait été interdit de créer un syndicat. Requête no 34503/97. Arrêt de la grande chambre du 12/11/2008) :
« a) Les requérants, en leur qualité de fonctionnaires municipaux, peuvent-ils bénéficier des dispositions de l’article 11 de la Convention ?
33. La Cour est amenée à se pencher sur l’exception du Gouvernement tirée d’une incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention résultant de ce que l’article 11 de la Convention ne serait pas applicable aux « membres (…) de l’administration de l’Etat ».
Elle rappelle à ce propos que le paragraphe 2 in fine de l’article 11 implique nettement que l’Etat est tenu de respecter la liberté d’association de ses employés sauf à y apporter, le cas échéant, des restrictions légitimes s’il s’agit de membres de ses forces armées, de sa police ou de son administration (Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, § 37, série A no 20).
34. La Cour considère à cet égard que les restrictions pouvant être imposées aux trois groupes de personnes cités par l’article 11 appellent une interprétation stricte et doivent dès lors se limiter à l’« exercice » des droits en question. Elles ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser. Sur ce point, la Cour ne partage pas l’avis de la Commission suivant lequel le terme « légitimes » de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 11 signifie simplement que les restrictions en cause doivent avoir une base en droit interne et ne pas être arbitraires, et non qu’elles doivent être proportionnées (Council of Civil Service Unions et autres c. Royaume uni, no 11603/85, décision de la Commission du 20 janvier 1987, Décisions et rapports 50, p. 256). Pour la Cour, il incombe en outre à l’Etat concerné de démontrer le caractère légitime des restrictions éventuellement apportées au droit syndical de ces personnes. La Cour estime par ailleurs que les fonctionnaires municipaux, dont les activités ne relèvent pas de l’administration de l’Etat en tant que tel, ne peuvent en principe être assimilés à des « membres de l’administration de l’Etat » et voir limiter sur cette base l’exercice de leur droit de s’organiser et de former des syndicats (voir, mutatis mutandis, Tüm Haber Sen et çınar c. Turquie, §§ 35 – 40 et 50)…
b) Principes généraux
35. La Cour rappelle que l’article 11 § 1 présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particuliers de la liberté d’association (Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, § 38, série A no 19, et Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, précité, § 39). La Convention n’opère aucune distinction entre les attributions de puissance publique des Etats contractants et leurs responsabilités en tant qu’employeurs. L’article 11 ne fait pas exception à cette règle. Bien au contraire, son paragraphe 2 in fine implique nettement que l’Etat est tenu de respecter la liberté d’association de ses employés sauf à y apporter, le cas échéant, des « restrictions légitimes » s’il s’agit de membres de ses forces armées, de sa police ou de son administration (Tüm Haber Sen et Çnar, précité, § 29). Aussi l’article 11 s’impose-t-il à l’Etat employeur, que les relations de ce dernier avec ses employés obéissent au droit public ou au droit privé (Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, précité, § 37).
36. La Cour rappelle également que si l’article 11 a pour objectif essentiel de protéger l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l’exercice des droits qu’il consacre, il peut impliquer en outre l’obligation positive d’assurer la jouissance effective de ces droits. …
d) Observation de l’article 11
i. Prévision par la loi et poursuite d’un but légitime
37. Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs buts légitimes et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
38. La Cour relève que l’ingérence litigieuse était conforme à la loi nationale telle qu’interprétée par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’arrêt litigieux, dans la mesure où il visait à empêcher une disparité entre la loi et la pratique, tendait à défendre l’ordre (Tüm Haber Sen et Çınar, précité, §§ 33-34).
ii. Nécessité dans une société démocratique
39. Quant à la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle que des restrictions légitimes peuvent être imposées à l’exercice des droits syndicaux par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. Cependant, il faut aussi tenir compte de ce que les exceptions visées à l’article 11 appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à la liberté d’association. Pour juger en pareil cas de l’existence d’une « nécessité », et donc d’un « besoin social impérieux », au sens de l’article 11 § 2, les Etats ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite, laquelle se double d’un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, y compris celles de juridictions indépendantes (voir, par exemple, Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, § 40, Recueil 1998-IV). La Cour doit aussi considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés dans la disposition concernée de la Convention et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, par exemple, Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, § 51, CEDH 2002‑II)…
40. Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention à raison de la non-reconnaissance aux requérants, fonctionnaires municipaux, du droit de fonder des syndicats. »
Dès lors, l’argument selon lequel l’interdiction d’ester en justice serait accessoire de l’illicéité prétendue de l’objet social de l’association doit être rejeté.
56 – L’interdiction d’ester en justice est dépourvue de raisons objectives.
Le motif invoqué par le Conseil d’Etat pour refuser tout droit de s’organiser aux militaires en activité de service est : « l’incompatibilité des groupements professionnels avec les règles de la discipline militaires ».
C’est donc cette même « incompatibilité avec les règles de la discipline militaire » qui fonde l’interdiction d’ester en justice opposée à l’association.
Il s’agit évidemment d’un postulat non démontré qui relève de la pure idéologie et non d’une motivation objective.
Rappelons à cet égard l’extrait des conclusions du commissaire du gouvernement déjà cité : « L’action contentieuse n’emporte pas, de prime abord, des risques aussi élevés que l’action revendicative dans les enceintes militaires ou sur les théâtres d’opération puisqu’à titre individuel les militaires n’en sont pas privés. Par ailleurs, le droit au recours ou le droit au juge – que n’invoque pas l’association mais qui peuvent servir de guide à l’interprète – pourraient exiger que les restrictions de capacité soient justifiés par des motifs supérieurs, surtout s’agissant du REP, comme le montrent nombre de vos arrêts (entre autres Ass. 17 février 1950 Ministre de l’agriculture c/ Dme Lamotte p 110) et surtout s’agissant du recours pour excès de pouvoir d’une association. Alors même que la loi du 1er juillet 1901 dispose que les associations ne « jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5 », c’est-à-dire à la déclaration, vous avez dans la décision Syndicat de défense des canaux de la Durance donné raison au commissaire du Gouvernement Riboulet qui dans l’affaire Polier déclarait « l’action de cassation administrative n’est pas fonction de la capacité juridique de celui qui l’invoque ». Enfin, il est loisible à l’administration de poursuivre la dissolution de l’association si elle estime que les risques sont trop importants. Elle les tolère aujourd’hui, jugeant préférable de ne pas voir à nouveau surgir dans le débat public cette question sensible. »
Ce n’est donc pas pour des motifs légitimes et fondés en droit que l’intérêt à agir de la requérante a été rejeté. Si le droit de recours pour excès de pouvoir des militaires à titre individuel ne menace pas la discipline militaire comme le reconnait le commissaire du gouvernement, a fortiori, ce droit accordé à une association non représentée en tant que telle dans les unités à ce jour, ne peut nuire à la discipline des armées.
Par ailleurs, l’explication de la tolérance du ministère à l’égard de l’existence même de l’association au motif qu’on ne souhaite pas « voir surgir à nouveau dans le débat public cette question sensible » est totalement subjective et même spécieuse. Le ministre de la défense avait tout loisir pour engager une action en dissolution depuis 2001 et s’il tolère l’existence de l’association, cette situation relève de sa seule responsabilité. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la carence du ministère à agir ne peut en aucun cas justifier que l’Adefdromil soit privée arbitrairement de son droit d’ester en justice.
Enfin, l’interdiction d’ester en justice proclamée par les arrêts de décembre 2008 et réaffirmée par ceux du 4 mars 2009 est en contradiction totale avec la reconnaissance de ce droit telle qu’elle résulte de l’arrêt du Conseil d’Etat n°234748 du 27 novembre 2002 (pièce n°42) par lequel cette juridiction avait accepté d’examiner au fond les arguments de la requérante sans que le défaut d’intérêt à agir, moyen d’ordre public, n’ait été soulevé, ni par le ministre de la défense, ni par la juridiction, elle-même, agissant de manière indépendante et impartiale.
En tout état de cause, l’interdiction d’ester en justice est totalement disproportionnée par rapport au but à atteindre. Elle n’est justifiée par aucune raison légitime.
***
Il est encore demandé de constater que la France a violé les termes de la Convention en raison de la privation du droit d’ester en justice infligée à la requérante.
La requête de l’Adefdromil devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme
La requête de l’Adefdromil devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Suite)