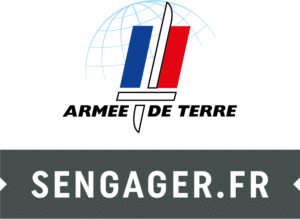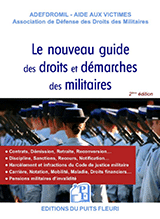3° Violation des articles 6 et 13 de la Convention en ce que les décisions du 11 décembre 2008 et du 4 mars 2009 violent le droit légitime d’accès de la requérante à un tribunal et la privent de tout recours effectif.
42 – En fait, les arrêts de rejet du 11 décembre 2008, confirmés par les décisions du 4 mars 2009, violent le droit d’accès légitime et garanti d’accès à un tribunal et privent la requérante de tout recours effectif pour exercer son objet social.
La requérante a déjà exposé, supra aux paragraphes 24 et suivants, les circonstances qui ont conduit le directeur de cabinet civil et militaire de Madame Alliot-Marie, ministre de la défense à interdire aux militaires en activité de service d’adhérer à l’Adefdromil (pièce n°9).
43 – La décision du directeur du cabinet du ministre de la défense du 28 novembre 2002 (pièce n°10).
MINISTERE DELA DEFENSE
Cabinet du Ministre Paris, le 28 NOV 02
N° 016119 DEF/CAB/SDBC/CPAG
NOTE
A l’attention des
« destinataires in fine »
OBJET : Adhésion à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
REFERENCE : Article 10 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
L’article 10 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, précise que « l’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire »
L’Association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL) a pour objet : « l’étude et la défense des droits, des intérêts matériels, professionnels et moraux, collectifs ou individuels des militaires relevant de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ». Son objet confère à cette association un caractère syndical.
En conséquence, les destinataires de la présente note prendront toutes les mesures qu’ils jugeront utiles afin d’informer les militaires en activité de service relevant de leur autorité qu’ils ne peuvent adhérer à cette association, sous peine de sanctions disciplinaires. De plus, il conviendra d’inviter ceux dont l’appartenance à l’ADEFDROMIL serait connue, à en démissionner, faute de quoi il vous appartiendra d’engager une procédure disciplinaire à leur encontre.
Le directeur du cabinet civil et militaire
Philippe MARLAND
44 – Le contentieux de la décision d’interdiction d’adhérer à l’ADEFDROMIL.
Très subtilement, la note de M. Philippe Marland, n°2 du ministère de la défense, ne constitue pas une attaque frontale contre l’Adefdromil, mais vise à la priver de ses adhérents en interdisant aux militaires d’en devenir membres.
Au regard du droit administratif, c’est une mesure dite d’ordre intérieur qui ne fait pas grief à la requérante et qui ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cette analyse est confirmée par la réponse de Mme le ministre de la Défense à une réponse posée le 16 novembre 2004 par le député Jérôme Lambert, publiée au journal officiel (Assemblée Nationale) du 28 décembre 2004 (pièce n°68).
En revanche, pour le juge « judiciaire », la mesure prise par le préfet Marland était susceptible de constituer une « voie de fait » rendant sa pleine et entière compétence au juge judiciaire, protecteur naturel des libertés publiques.
C’est pour cette raison et dans ces conditions que l’Adefdromil a assigné en référé Madame Alliot Marie, es-qualité de ministre de la défense et Monsieur Philippe Marland, directeur de cabinet du ministre devant le tribunal de grande instance de Paris le date 2003 (pièce n°15)
45 – La décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2003, le président du tribunal de grande instance a débouté l’Adefdromil de ses demandes en se déclarant incompétent et en renvoyant la requérante à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif (pièce n°16).
Celle-ci, s’en tenant à la qualification de mesure d’ordre intérieur de la note du Préfet Marland, n’a pas souhaité engager de contentieux devant la juridiction administrative.
46 – La privation de recours effectif constitue une sanction non prévue par la loi.
Ayant tenté vainement de se pourvoir devant le juge judiciaire et ayant vu son droit légitime d’ester en justice refuser par le Conseil d’Etat, l’Adefdromil est ainsi privée de tout recours.
En droit interne, le droit à un recours effectif a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle dans une décision du 21 janvier 1994, confirmée par une décision du 9 avril 1996. Le Conseil constitutionnel a ainsi rattaché le droit des individus à un recours effectif devant une juridiction en cas d’atteintes substantielles à leurs droits à l’article 16 dela Déclarationdes droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui fait partie du bloc de constitutionnalité.
Un des arguments avancés par le commissaire du gouvernement pour débouter l’Adefdromil de ses recours en excès de pouvoir, c’est que ce type de recours est ouvert aux individus, c’est-à-dire aux militaires. L’argument est pour le moins tendancieux. En effet, la formation d’un recours à titre individuel par un fonctionnaire et a fortiori par un militaire le désigne à sa hiérarchie et peut faire craindre le risque de représailles indirectes. Ainsi, dans l’ouvrage particulièrement célèbre en droit français dénommé « Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (15ème édition), les auteurs, messieurs Long, Weil, Braibant, Devolvé, et Genevois, tous éminents juristes de droit public, précisent dans le commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 1906 –Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges- que « fréquemment les fonctionnaires hésitent à former eux-mêmes un recours qui pourrait leur attirer l’animosité de leurs supérieurs et qu’ils seraient mieux à même de défendre leurs droits si l’action syndicale était plus largement accueillie. » (pièce n°38).
Au niveau européen, ce droit est protégé par l’article 13 dela Conventionqui prévoit le droit à un recours effectif pour toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention auraient été méconnus et par l’article 6 qui protège le droit au juge, dont a été privée la requérante dans le cas d’espèce.La Courde justice des communautés européennes en a fait un principe général du droit communautaire (15 mai 1986, Johnston).
***
Les arrêts du Conseil d’Etat du 11 décembre 2008 (pièce n°41) et du 4 mars 2009 (pièce n°45) ont privé la requérante de son droit à accéder à un juge indépendant et impartial garanti par l’article 6 de la convention. Ces décisions ont supprimé tout droit à un recours effectif sans raisons légitimes, sans nécessité, sans motifs objectifs et en tout cas de manière disproportionnée.La Convention a donc été violée de ce chef parla France.
4° Violation de l’article 11 de la Convention en ce que les arrêts du 11 décembre 2008 et du 4 mars 2009 considèrent comme légitime au sens du 2° de cet article, l’interdiction totale du droit d’association des militaires.
47 – L’interdiction totale de s’organiser imposée aux militaires français n’est pas légitime. Elle est contraire tant au doit interne qu’à la jurisprudence la plus récente de votre haute juridiction.
En droit interne, la décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971 (pièce n°36) énonce : « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; qu’en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable. »
Un arrêt du Conseil d’État du 11 juillet 1956 « Amicale des annamites de Paris », reconnaît ce principe : « aux termes de l’article 81 de la Constitution de la République française : Tous les nationaux français et les ressortissants de l’Union française ont la qualité de citoyens de l’Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution ; qu’il résulte de cette disposition que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés par le préambule de ladite Constitution sont applicables sur le territoire français aux ressortissants de l’Union française ; qu’au nombre de ces principes figure la liberté d’association ; que, dès lors, le Ministre de l’Intérieur n’a pu, sans excéder ses pouvoirs, constater par l’arrêté attaqué en date du 30 avril 1953 la nullité de l’association déclarée des Annamites de Paris, dont les dirigeants et les membres étaient des ressortissants vietnamiens« .
La jurisprudence de votre Cour, quant à elle, a eu à prendre position dans un litige opposant la Turquie à deux de ses ressortissants turcs auxquels il avait été interdit de créer un syndicat (Affaire DEMIR et BAYKARA contre Turquie. Requête no 34503/97. Arrêt de la grande chambre du 12/11/2008) :
« a) Les requérants, en leur qualité de fonctionnaires municipaux, peuvent-ils bénéficier des dispositions de l’article 11 de la Convention ?
1. La Cour est amenée à se pencher sur l’exception du Gouvernement tirée d’une incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention résultant de ce que l’article 11 de la Convention ne serait pas applicable aux « membres (…) de l’administration de l’Etat ».
Elle rappelle à ce propos que le paragraphe 2 in fine de l’article 11 implique nettement que l’Etat est tenu de respecter la liberté d’association de ses employés sauf à y apporter, le cas échéant, des restrictions légitimes s’il s’agit de membres de ses forces armées, de sa police ou de son administration (Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, § 37, série A no 20).
2. La Cour considère à cet égard que les restrictions pouvant être imposées aux trois groupes de personnes cités par l’article 11 appellent une interprétation stricte et doivent dès lors se limiter à l’« exercice » des droits en question. Elles ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser. Sur ce point, la Cour ne partage pas l’avis de la Commission suivant lequel le terme « légitimes » de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 11 signifie simplement que les restrictions en cause doivent avoir une base en droit interne et ne pas être arbitraires, et non qu’elles doivent être proportionnées (Council of Civil Service Unions et autres c. Royaume uni, no 11603/85, décision de la Commission du 20 janvier 1987, Décisions et rapports 50, p. 256). Pour la Cour, il incombe en outre à l’Etat concerné de démontrer le caractère légitime des restrictions éventuellement apportées au droit syndical de ces personnes. La Cour estime par ailleurs que les fonctionnaires municipaux, dont les activités ne relèvent pas de l’administration de l’Etat en tant que tel, ne peuvent en principe être assimilés à des « membres de l’administration de l’Etat » et voir limiter sur cette base l’exercice de leur droit de s’organiser et de former des syndicats (voir, mutatis mutandis, Tüm Haber Sen et çınar c. Turquie, §§ 35 – 40 et 50).
3. La Cour constate que ces considérations trouvent un appui dans la plupart des instruments internationaux pertinents ainsi que dans la pratique des Etats européens.
4. Même si le paragraphe 2 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui porte sur le même objet, englobe les membres de la fonction publique dans les catégories de personnes pouvant être soumises à des restrictions, l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont le libellé est similaire à celui de l’article 11 de la Convention, dispose-t-il uniquement que les Etats peuvent restreindre le droit syndical des membres des forces armées et de la police, sans faire aucune référence aux membres de la fonction publique.
5. La Cour rappelle que l’instrument principal garantissant, au plan international, le droit pour les agents de la fonction publique de former des syndicats est la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale, dont l’article 2 déclare que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations (voir le paragraphe 37 ci-dessus).
6. La Cour observe que le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer a été plusieurs fois réaffirmé par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Celle-ci, dans ses observations rédigées à l’intention du gouvernement turc au titre de la Convention no 87, a estimé que la seule exception au droit syndical envisagée par ce texte concernait les membres des forces armées et de la police (voir le paragraphe 38 ci-dessus).
7. La Cour prend note aussi de ce que la Commission de la liberté syndicale de l’OIT a également maintenu la même ligne de raisonnement en ce qui concerne les fonctionnaires municipaux. Selon cette commission, les travailleurs des administrations locales doivent pouvoir constituer effectivement les organisations qu’ils estiment appropriées et ces organisations doivent posséder pleinement le droit de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs qu’elles représentent (voir le paragraphe 39 ci-dessus).
8. Les textes émanant des organisations européennes montrent aussi que le principe accordant le droit fondamental de se syndiquer aux fonctionnaires a été très largement accepté par les Etats membres. Par exemple, l’article 5 de la Charte sociale européenne garantit la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d’adhérer à ces organisations. Les législations nationales peuvent imposer des limitations partielles à la police et des limitations totales ou partielles aux membres des forces armées, mais aucune possibilité de restriction n’a été prévue pour les autres membres de l’administration.
9. Le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer a également été reconnu par le Comité des Ministres dans sa Recommandation R (2000) 6 sur le statut des agents publics en Europe, dont le Principe no 8 déclare qu’en principe, les agents publics doivent jouir des mêmes droits que tous les citoyens et que leurs droits syndicaux ne doivent être légalement restreints que dans la mesure où des limitations sont nécessaires pour le bon exercice des fonctions publiques (voir le paragraphe 46 ci-dessus).
10. Toujours au plan européen, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adopte une approche ouverte du droit syndical en déclarant, dans son article 12(1), entre autres, que « toute personne » a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts (voir le paragraphe 47 ci-dessus).
11. Quant à la pratique européenne, la Cour rappelle que le droit pour les travailleurs de la fonction publique de se syndiquer est désormais reconnu par tous les Etats contractants (voir le paragraphe 48 ci-dessus). Ce droit s’applique aux fonctionnaires de carrière, aux fonctionnaires sous contrat et aux travailleurs des entreprises industrielles ou commerciales nationales ou municipales qui sont propriétés publiques. Les fonctionnaires, tant ceux qui appartiennent à l’administration centrale que ceux qui relèvent d’une administration locale, peuvent généralement adhérer au syndicat de leur choix. La Cour prend aussi note de ce que la densité syndicale est généralement plus élevée dans le secteur public que dans le secteur privé, ce qui constitue un signe manifeste d’un environnement juridique et administratif favorable créé par les Etats membres. Dans la majorité des Etats membres, les quelques restrictions existantes restent limitées aux membres des organes judiciaires, de la police et du corps des pompiers, les restrictions les plus importantes, qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de se syndiquer, étant réservées aux membres des forces armées.
12. La Cour en conclut que les « membres de l’administration de l’Etat » ne sauraient être soustraits du champ de l’article 11. Tout au plus les autorités nationales peuvent-elles leur imposer des « restrictions légitimes » conformes à l’article 11 § 2. En l’espèce, toutefois, le Gouvernement n’a pas démontré en quoi la nature des fonctions exercées par les requérants, fonctionnaires municipaux, appelle à les considérer comme « membres de l’administration de l’Etat » sujets à de telles restrictions.
13. Dès lors, les requérants peuvent légitimement invoquer l’article 11 de la Convention, et l’exception soulevée par le Gouvernement sur ce point doit donc être rejetée.
b) Principes généraux
14. La Cour rappelle que l’article 11 § 1 présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particuliers de la liberté d’association (Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, § 38, série A no 19, et Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, précité, § 39). La Convention n’opère aucune distinction entre les attributions de puissance publique des Etats contractants et leurs responsabilités en tant qu’employeurs. L’article 11 ne fait pas exception à cette règle. Bien au contraire, son paragraphe 2 in fine implique nettement que l’Etat est tenu de respecter la liberté d’association de ses employés sauf à y apporter, le cas échéant, des « restrictions légitimes » s’il s’agit de membres de ses forces armées, de sa police ou de son administration (Tüm Haber Sen et Çnar, précité, § 29). Aussi l’article 11 s’impose-t-il à l’Etat employeur, que les relations de ce dernier avec ses employés obéissent au droit public ou au droit privé (Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, précité, § 37).
15. La Cour rappelle également que si l’article 11 a pour objectif essentiel de protéger l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l’exercice des droits qu’il consacre, il peut impliquer en outre l’obligation positive d’assurer la jouissance effective de ces droits. En l’espèce, la responsabilité de la Turquie doit être engagée si les faits dénoncés par les requérants – à savoir, principalement, la non‑reconnaissance de leur syndicat par l’Etat à l’époque des faits – résultaient d’un manquement de sa part à garantir aux requérants en droit interne la jouissance des droits consacrés par l’article 11 de la Convention (Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41, CEDH 2002‑V ; Gustafsson c. Suède, § 45, Recueil 1996-II).
16. Toutefois, ainsi que la Cour l’a dit dans le contexte de l’article 8 de la Convention, que l’on aborde l’affaire sous l’angle d’une obligation positive, à la charge de l’Etat, d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans l’article en cause ou sous celui d’une ingérence d’une autorité publique à justifier sous l’angle de son paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 98, CEDH 2003-VIII).
c) Effets produits sur les activités de Tüm Bel Sen par l’action ou l’inaction de l’Etat
17. La Cour doit vérifier en premier lieu si la thèse du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de cassation du 6 décembre 1995 n’a eu aucun effet sur les activités syndicales de Tüm Bel Sen est confirmée par les faits de la cause.
18. Elle observe à cet égard que ledit arrêt, dans la mesure où il y était jugé que le syndicat requérant n’avait pas acquis le statut de personne morale lors de sa création et n’était, de ce fait, pas habilité à ester en justice, a eu deux effets sur les activités de celui-ci, l’un rétroactif l’autre prospectif.
19. L’arrêt en question a emporté comme effet rétroactif la nullité ab initio de toutes les activités et démarches accomplies par Tüm Bel Sen auprès de la mairie de Gaziantep entre 1991 et 1993 afin de protéger les intérêts de ses membres, y compris la convention collective en cause dans la présente affaire. Cet effet s’est trouvé accentué par les décisions de la Cour des comptes exigeant le remboursement rétroactif des avantages obtenus par des membres du syndicat à l’issue des négociations avec l’administration employeur.
20. Quant à l’effet prospectif de l’arrêt de cassation en cause, la Cour estime crédible la thèse des requérants selon laquelle le syndicat Tüm Bel Sen a vu ses activités largement se restreindre en raison de la réticence des responsables des administrations locales à entrer en négociations avec lui. Il ressort du dossier, d’une part, que les responsables des municipalités ayant accepté d’accorder des avantages aux fonctionnaires par la voie de conventions collectives ont dû faire face à des poursuites administratives, financières et judiciaires jusqu’à l’adoption de la loi no 4688 en date du 25 juin 2001, et, d’autre part, que même après cette dernière date ils ont dû rembourser eux-mêmes à l’Etat les sommes supplémentaires versées à l’époque des faits et se retourner à leur tour contre les fonctionnaires bénéficiaires.
21. Ainsi que la Cour l’a relevé au paragraphe 88 ci-dessus, la chambre a conclu non seulement qu’il y avait eu une ingérence injustifiée dans l’exercice par les requérants de leurs droits découlant de l’article 11 mais aussi que, en refusant de reconnaître la personnalité juridique au syndicat des requérants, l’Etat avait manqué à son obligation positive d’assurer aux intéressés la jouissance de ces droits. A l’instar de la chambre, la Grande Chambre considère que, compte tenu du mélange d’action et d’inaction des autorités qui la caractérise, la présente espèce peut s’analyser aussi bien sous l’angle d’une ingérence de l’Etat défendeur dans l’exercice par les requérants des droits garantis par l’article 11 que sous l’angle d’un manquement de sa part à l’obligation positive qu’il avait d’assurer aux intéressés la jouissance de ces droits. Elle choisit d’examiner cette partie de la cause sous l’angle d’une ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits, mais elle tiendra compte, ce faisant, des obligations positives de l’Etat.
d) Observation de l’article 11
i. Prévision par la loi et poursuite d’un but légitime
22. Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs buts légitimes et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
23. La Cour relève que l’ingérence litigieuse était conforme à la loi nationale telle qu’interprétée par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’arrêt litigieux, dans la mesure où il visait à empêcher une disparité entre la loi et la pratique, tendait à défendre l’ordre (Tüm Haber Sen et Çınar, précité, §§ 33-34).
ii. Nécessité dans une société démocratique
24. Quant à la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle que des restrictions légitimes peuvent être imposées à l’exercice des droits syndicaux par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. Cependant, il faut aussi tenir compte de ce que les exceptions visées à l’article 11 appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à la liberté d’association. Pour juger en pareil cas de l’existence d’une « nécessité », et donc d’un « besoin social impérieux », au sens de l’article 11 § 2, les Etats ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite, laquelle se double d’un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, y compris celles de juridictions indépendantes (voir, par exemple, Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, § 40, Recueil 1998-IV). La Cour doit aussi considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés dans la disposition concernée de la Convention et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, par exemple, Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, § 51, CEDH 2002‑II).
25. En ce qui concerne la question de savoir si, en l’espèce, la non‑reconnaissance du syndicat des requérants était justifiée par un « besoin social impérieux », la Grande Chambre fait sienne l’appréciation suivante de la chambre :
« il n’a pas été démontré devant elle que l’interdiction absolue de fonder des syndicats qu’imposait le droit turc, tel qu’il était appliqué à l’époque des faits, aux fonctionnaires (…) correspondait à un « besoin social impérieux ». Le seul fait que « la législation ne prévoyait pas une telle possibilité » ne saurait suffire à justifier une mesure aussi radicale que la dissolution d’un syndicat ».
26. La Cour estime également qu’à l’époque des faits plusieurs arguments supplémentaires militaient en faveur de la thèse selon laquelle la non-reconnaissance aux requérants, fonctionnaires municipaux, du droit de fonder un syndicat ne correspondait pas à une « nécessité ».
27. D’une part, le droit pour les fonctionnaires de fonder des syndicats et de s’y affilier était déjà reconnu par des instruments de droit international, tant universels (voir les paragraphes 98-102 ci-dessus) que régionaux (voir les paragraphes 103-105 ci-dessus). De plus, l’examen de la pratique européenne montrait que le droit pour les travailleurs de la fonction publique de se syndiquer était généralement reconnu dans la totalité des Etats membres (voir le paragraphe 106 ci-dessus).
28. D’autre part, la Turquie avait déjà, à l’époque des faits, ratifié (instrument déposé le 12 juillet 1993), la Convention no 87 de l’OIT, le texte fondamental garantissant, au plan international, le droit pour les agents de la fonction publique de former des syndicats. Cet instrument avait déjà, en vertu de la Constitution turque, force de loi au plan national (voir le paragraphe 34 ci-dessus).
29. Enfin, la Turquie, par sa pratique ultérieure, a confirmé sa volonté de reconnaître aux fonctionnaires le droit de s’organiser, volonté déjà exprimée par la ratification de la Convention no 87 de l’OIT en 1993, par la modification de la Constitution en 1995 ainsi que par la pratique des organes judiciaires à partir du début des années 1990. Cette dernière pratique est illustrée par les décisions rendues en l’espèce par le tribunal de grande instance et la quatrième chambre civile de la Cour de cassation. Par ailleurs, la Turquie a signé, en 2000, les deux instruments des Nations unies reconnaissant le droit en question (voir les paragraphes 40 et 41 ci-dessus).
30. Or la Cour observe qu’en dépit de ces développements sur le plan du droit international, les autorités turques n’ont pu, à l’époque des faits, reconnaître aux requérants le droit de fonder un syndicat, et ce principalement pour deux raisons. Premièrement, le législateur turc, après la ratification en 1993 de la Convention no 87 de l’OIT par la Turquie, est resté dans l’inertie jusqu’en 2001, année au cours de laquelle il a adopté la loi no 4688 sur les syndicats des fonctionnaires, qui régit l’application pratique de ce droit. Deuxièmement, durant cette période transitoire, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation ont refusé de suivre la solution proposée par le tribunal de grande instance de Gaziantep, qui s’inspirait des développements du droit international, et ont procédé à une interprétation restrictive et formaliste des textes de droit interne concernant la fondation des personnes morales. Cette interprétation a empêché les chambres civiles réunies de procéder à une évaluation des circonstances spécifiques de l’affaire et de rechercher si un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts respectifs des requérants et de l’administration employeur, la municipalité de Gaziantep (voir, mutatis mutandis, Sørensen et Rasmussen, précité, § 58).
31. La Cour considère ainsi que l’effet combiné de l’interprétation restrictive de la Cour de cassation et de l’immobilité du législateur entre 1993 et 2001 a empêché le gouvernement défendeur de remplir son obligation positive d’assurer aux requérants la jouissance de leurs droits syndicaux et n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 11 § 2 de la Convention.
32. Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention à raison de la non-reconnaissance aux requérants, fonctionnaires municipaux, du droit de fonder des syndicats. »
48 – L’interdiction totale imposée aux militaires français en activité de service de s’organiser est dépourvue de raisons objectives. Elle n’est pas nécessaire. Elle est arbitraire.
Il est évident que le refus de reconnaître l’existence d’une association régulièrement déclarée, ayant pour but la défense des intérêts professionnels et moraux des militaires et l’interdiction d’y adhérer, ne sont pas nécessaires, dans la société française, à la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d’autrui.
Elles ne sont pas non plus nécessaires au maintien de la discipline militaire dans l’armée française.
En effet, le dialogue avec une organisation professionnelle permet un mode de règlement des conflits sociaux pacifique, légal et légitime.
Le Conseil d’Etat rejette ce principe et indique que l’existence d’une association qui défend les intérêts des militaires constitue en soi un acte d’indiscipline en raison de son incompatibilité avec la discipline proclamée par le code de la défense.
Dans les faits, les actions de l’Adefdromil n’ont jamais débouché sur des actes d’indiscipline. Bien au contraire, la requérante a toujours pris soin de prôner un strict respect de la légalité républicaine et démocratique. En particulier, elle n’a jamais appelé à des manifestations de militaires, d’ailleurs pénalement sanctionnables. Elle ne s’est jamais livrée à des distributions de tracts à la porte des casernes.
Il appartient donc à la France de démontrer en quoi l’existence de l’Adefdromil et ses actions peuvent menacer la discipline militaire.
A défaut, l’interdiction totale est arbitraire (CEDH Rekvenyi c Hongrie du 20/05/1999. Req. N°25390/94.
Le problème a d’ailleurs été bien analysé par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions (pièce n°39) : « Avec l’article L.4121-4 du code de la défense, vous êtes confrontés à une situation a priori différente, qui appelle une réponse moins implicite mais aussi moins évidente, compte tenu, entre autres, de la rédaction du texte qui, littéralement, n’interdit pas le syndicalisme militaire mais le proclame « incompatible avec la discipline militaire ».
On peut certes y voir une périphrase de l’interdiction – c’est le sens des débats parlementaires même s’ils n’expliquent pas le choix des termes employés– et par suite en déduire, comme le ministre, l’incapacité de l’association à agir pour défendre son objet. Il y aurait là l’effet de cette loi conjugué avec l’idée que la légalité et la licéité ne doivent faire qu’une seule et même chose au regard de la recevabilité de l’action en justice.
Mais ce n’est pas la seule lecture ni la seule construction juridique possibles. L’existence formelle d’une personne morale – ici la déclaration de l’association et l’accomplissement des formalités de publicité ou même sa seule existence – pourraient suffire pour agir en justice, d’autant plus que cette action pourrait en l’espèce n’être pas regardée par principe comme « incompatible avec la discipline militaire ».
En effet, tant que l’association n’a pas été dissoute, elle existe légalement et ce qui est incompatible avec la discipline militaire, ce sont, pour reprendre les propos de la commission de révision « l’ingérence dans l’activité des forces, la remise en question de la cohésion des unités, voire de la disponibilité et du loyalisme des militaires » et non le recours pour excès de pouvoir.
Le motif invoqué par le législateur français pour refuser tout droit de s’organiser aux militaires est : « l’incompatibilité des groupements professionnels avec les règles de la discipline militaire ».
Il s’agit évidemment d’un postulat -non démontré, par définition- qui relève de la pure idéologie et non d’une motivation objective.
Les contradictions de la position française apparaissent clairement dans le rapport du Sénat n°271 d’avril 2008 sur l’avenir de l’organisation et des missions de la gendarmerie, (pièce n°52).
C’est ainsi qu’à la page 40 du rapport la chambre haute du parlement français analyse le fonctionnement des instances de concertation : « 2. Le dialogue social et les instances de concertation
En l’absence de syndicats, incompatibles avec le statut militaire, des mécanismes de concertation ont été mis en place au sein de la gendarmerie, comme d’ailleurs au sein des armées en général.
Depuis les crises de 1989 et de 2001, le dialogue social a beaucoup évolué au sein de la gendarmerie. Des mesures législatives et réglementaires ont amélioré la représentation des personnels et renforcé les instances de concertation.
A l’échelle des compagnies ou des escadrons, des présidents de catégorie, élus par leurs pairs, participent régulièrement à des réunions qui concernent les conditions de travail ou de vie des personnels. Ils donnent des avis au commandant d’unité sur tous les problèmes d’ordre professionnel, social ou moral qui intéressent les militaires qu’ils représentent.
Au niveau des groupements et des régions, des commissions de participation, composées des présidents de catégorie, se réunissent régulièrement pour évoquer les questions relatives aux conditions de vie et de travail des personnels de la gendarmerie.
Sur le plan national, le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG), composé de 79 membres titulaires tirés au sort, après volontariat, est chargé d’étudier toute question concernant les conditions de vie, d’exercice du métier militaire ou d’organisation du travail. Il donne également un avis sur tous les textes législatifs ou réglementaires relatifs à la gendarmerie. Le groupe de travail a auditionné le colonel Michel Robiquet, Secrétaire général du CFMG. Il existe sept conseils de la fonction militaire (gendarmerie nationale, armée de terre, armée de l’air, marine nationale, service de santé des armées, délégation générale de l’armement et service des essences des armées), qui fonctionnent selon les mêmes principes.
Enfin, la gendarmerie est représentée au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), qui est l’instance nationale supérieure de concertation du personnel militaire au sein des armées. Depuis la loi du 24 mars 2005, les membres du CSFM sont élus (et non plus tirés au sort) par et parmi les membres des CFM. Le CSFM traite davantage de questions statutaires générales.
Si le fonctionnement des instances de concertation au niveau local ne semble pas soulever de difficultés particulières, le mode de désignation des représentants siégeant au sein du CFMG semble, en revanche, perfectible.
Une réforme du mode de désignation de ces représentants, afin qu’ils soient élus et non plus tirés au sort, serait, en effet, de nature à renforcer leur légitimité.
Le principal obstacle à cette réforme tient cependant à l’attitude très réservée des autres armées, dont les instances de concertation fonctionnent sur les mêmes principes, et qui considèrent que cette réforme entraînerait une tendance vers une sorte de « syndicalisation » de ces instances.
Conclusion : revoir les mécanismes de représentation et de concertation au sein de la gendarmerie.
Compte tenu des lacunes existantes dans le fonctionnement des instances de concertation au niveau national, les associations de retraités et d’anciens élèves, ainsi que les associations de familles de gendarmes, jouent souvent un rôle important pour l’expression des revendications des personnels d’active.
Des associations telles que la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie (FNRG), l’Union nationale des personnels en retraite de la gendarmerie (UNPRG), la société d’entraide des élèves et anciens élèves de l’école des officiers de la gendarmerie nationale (« le Trèfle »), ou encore la société nationale des anciens et des amis de la gendarmerie (SNAAG), exercent, plus ou moins, notamment à travers leurs publications ( « l’Essor dela gendarmerie nationale » pour l’UNPRG ou « « Avenir et gendarmerie » pour la FNRG), une telle fonction.
Le groupe de travail a auditionné les représentants de ces associations. Ceux-ci ont exprimé leurs principales préoccupations et leurs attentes concernant les perspectives de la gendarmerie.
Les membres du groupe de travail se sont également entretenus avec Mme Murielle Noëlle, Présidente de l’association d’aide aux membres et familles de gendarmes. Celle-ci a souligné la difficulté de concilier la mobilité professionnelle des gendarmes et l’activité professionnelle des conjoints, notamment en zone rurale, ainsi que l’état dégradé de certaines casernes, qui pèse lourdement sur les conditions de vie des gendarmes et de leur famille.
Les mêmes contradictions ressortent des recommandations des sénateurs, page 79 :
« 2. Revoir les mécanismes de représentation et de concertation au sein de la gendarmerie
Le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur aura pour conséquence de juxtaposer deux systèmes de participation très différents : le système syndical de la police nationale et les instances de concertation de la gendarmerie nationale.
Si le fait syndical est par nature incompatible avec le statut militaire, il semble indispensable de rénover les mécanismes actuels de représentationdes personnels et de concertation au sein de la gendarmerie, afin d’aboutir à unsystème plus représentatif et à un dispositif de concertation plus cohérent.
La représentativité des membres du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG), qui sont actuellement tirés au sort, pourrait être grandement renforcée par l’élection de ces représentants, soit parmi les présidents de catégorie, soit directement.
Afin de limiter le risque de « professionnalisation » de ces représentants, on pourrait limiter la durée de leur mandat à deux mandats consécutifs.
La qualité et la durée de la formation des membres de cette instance (5 jours actuellement) pourraient être améliorées.
On pourrait également envisager de créer une sorte de bureau au sein du CFMG, composé du secrétaire général du CFMG et de plusieurs de ses membres, qui serait chargé d’assurer la continuité des travaux entre deux sessions.
Une campagne de sensibilisation des personnels de la gendarmerie aux enjeux de la concertation pourrait également être lancée.
Enfin, le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur nécessite de définir de nouvelles modalités de participation de ce ministère aux instances de concertation de la gendarmerie.
Le ministre de l’Intérieur devrait, en effet, participer ou être représenté au sein du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie, avec le ministre de la Défense (par un système de coprésidence par exemple), voire au Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) pour les sujets relatifs à la gendarmerie ou à une nouvelle instance propre à la gendarmerie.
En tout état de cause, la rénovation des mécanismes de participation et des instances de concertation au sein de la gendarmerie doit se faire dans le respect du statut militaire. »
Par ailleurs, Madame Marie Dominique Charlier Dagras, docteur en droit public, auteur d’un article de doctrine intitulé « Vers le droit syndical des personnels militaires ? » et publié dans la revue de droit public de 2003/n°4 (pièce n°54) rappelle que selon les critères définis par votre cour, « les restrictions à la liberté d’expression, dont la liberté de réunion est un aspect particulier doivent répondre à des motifs objectifs et s’avérés nécessaires dans une société démocratique ».
Elle ajoute : « Il semble néanmoins délicat de penser que la situation politique et sociale actuelle en France puisse être de nature à justifier l’interdiction qui est faite aux personnels militaires de créer ou d’adhérer à des groupements professionnels de défense des intérêts professionnels et encore plus de démontrer que l’interdiction de toute forme d’association professionnelle est la seule mesure appropriée pour parer ce type de désordre éventuel ».
Selon la jurisprudence de votre cour qui résulte de l’arrêt du 26/11/1991 Sunday Times c Royaume Uni, les motifs invoqués doivent être « pertinents et légitimes ». En l’espèce, ils ne le sont pas.
Pour parfaire l’information de votre cour, Madame Marie Dominique Charlier sert actuellement comme officière en activité de service avec le grade de lieutenant-colonel dans l’armée de terre. Son recrutement sous contrat par le ministre de la défense semble indiquer que c’est moins le principe du droit syndical dans les armées dela République Françaiseque l’action dérangeante de l’Adefdromil, qui explique la position du ministre de la défense.
Les débats parlementaires relatifs au statut général des militaires voté en 2005 montrent parfaitement que l’incompatibilité du droit syndical et de la discipline militaire relève, chez ses supporters, de l’idéologie pure et simple et non d’une position fondée sur un raisonnement objectif (pièce n°28).
Tout d’abord, il est patent que les militaires n’ont pas besoin d’être organisés en association ou en syndicat pour désobéir ou refuser d’exécuter les ordres.
L’histoire de nombreux pays abondent de tels exemples. Le plus souvent les mouvements d’insurrection, d’insubordination ou de mutinerie cachent des motivations politiques : insurrection des marins du cuirassier Potemkine en 1905, révolte des cadets de l’académie Kronstadt en 1921, putsch des généraux français en Algérie en 1961, prise d’otages aux Cortès à Madrid en 1981, etc.
La requérante se limitera à citer trois exemples tirés de l’histoire dela France concernant des mouvements sociaux dans les armées, survenus sans arrière-pensées politiques et dont l’origine se trouve uniquement dans des problèmes de condition militaire.
Ainsi, en 1815 à Strasbourg, après la défaite de Waterloo, les militaires de l’armée commandée par le général Rapp ont refusé d’être démobilisés sans avoir été intégralement payés de leur solde. En raison de l’impuissance de leurs officiers à obtenir l’argent nécessaire, ils se sont organisés sous le commandement d’un simple sergent nommé Dalousi. Celui-ci, après avoir exigé une stricte discipline de ses camarades insurgés obtint finalement que les fonds soient avancés par les personnes les plus fortunées de Strasbourg. Les militaires furent ainsi soldés et renvoyés dans leurs foyers. Le sergent Dalousi, quant à lui, ne fut nullement inquiété. Il devint même quelques années plus tard officier et pris sa retraite à l’âge de 50 ans comme capitaine (pièce n°55).
Plus près de nous, en 1989 et en 2001, les militaires de la gendarmerie française ont exprimé leur malaise par des manifestations d’indiscipline, faute d’instances représentatives dignes de ce nom. Elles sont rapportées dans le rapport du Sénat n°271 (pièce n°52) précité : « Ces dernières années, la gendarmerie, corps traditionnellement silencieux et obéissant, a connu à plusieurs reprises des crises, dont certaines ont eu un grand écho dans l’opinion. Une des premières crises de la gendarmerie à avoir eu un large retentissement a été la crise de l’été 1989.
LA CRISE DE L’ÉTÉ 1989
Survenue peu après l’assassinat de quatre gendarmes lors des évènements de Nouvelle-Calédonie en 1988, cette crise s’est manifestée par l’envoi de nombreuses lettres anonymes adressées aux plus hautes autorités de l’Etat et communiquées à la presse mettant en cause les conditions de travail des militaires de la gendarmerie.
Ces lettres dénonçaient tout à la fois la pénibilité du travail, notamment les horaires de travail et les astreintes, les conditions de logement et le manque de considération dont leurs auteurs estimaient être les victimes.
Cette première crise fut résolue par des « états généraux de la gendarmerie », et le lancement d’une « rénovation du service public de la gendarmerie », qui se traduisit par une réforme profonde de l’organisation, des conditions de travail et des mécanismes de concertation au sein de la gendarmerie.
La gendarmerie a connu une rechute en 2000, mais elle a été largement contenue grâce à un certain nombre de mesures visant à alléger le service, comme la préservation des périodes de récupération physique.
Toutefois, ce répit n’a été que de courte durée, puisque la gendarmerie a connu un véritable traumatisme avec la crise de décembre 2001.
LA NOUVELLE CRISE DE DÉCEMBRE 2001
Annoncée par diverses manifestations d’indiscipline, cette crise a connu son paroxysme du 4 au 7 décembre 2001, avec des manifestations ayant amené plusieurs milliers de gendarmes en tenue, avec leurs véhicules de service, à converger vers leurs états-majors nationaux, puis à se prêter à des manifestations sur la voie publique, notamment à Paris, le 7 décembre, où un demi millier de gendarmes rassemblés Porte Maillot ont été empêchés par un cordon de CRS de descendre l’avenue des Champs-Élysées.
Dans un contexte marqué par la mise en place des 35 heures, ce mouvement de contestation avait pour origine des conditions de travail jugées exorbitantes, l’insuffisance des effectifs et le manque de moyens, la vétusté des locaux et des matériels, ainsi que le sentiment de décrochage social et indiciaire des personnels de la gendarmerie.
Même si la crise de décembre 2001 a pu être résolue, elle semble avoir laissé un grand traumatisme au sein de la gendarmerie et un certain ressentiment de la part des armées. »
Dans les trois cas précités, ces graves violations de la discipline militaire n’ont pas été provoquées par des organisations professionnelles, mais par des problèmes de condition militaire non ou insuffisamment pris en compte par la hiérarchie. Dans les trois cas également, aucune sanction n’a été prise contre les mutins, ce qui peut être interprété comme une reconnaissance implicite de responsabilité de la part de la chaîne hiérarchique.
Il est évident que l’existence d’associations professionnelles dans la gendarmerie en 1989 et en 2001 aurait permis d’initier un dialogue et probablement d’éviter de telles violations de la discipline militaire.
A contrario, les mouvements sociaux dans les armées européennes où le droit de s’organiser est reconnu semblent extrêmement rares.
49 – L’interdiction totale de la liberté de s’organiser et de constituer des associations professionnelles et d’y adhérer ne peut faire partie des restrictions « légitimes ».
D’un point de vue sémantique, une restriction n’est pas une interdiction. L’interdiction va, de toute évidence bien au-delà de la restriction. Ensuite, cette interdiction sous-entend que les militaires sont des êtres immatures dépourvus de jugement, incapables de distinguer ce qui relève de leur mission opérationnelle et de leur devoir en tant que soldat, de ce qui concerne leur condition matérielle de citoyen en uniforme. Elle leur refuse la qualité de citoyen et le droit inaliénable de penser et de s’exprimer sur leur propre condition en dehors du système contrôlé, encadré et peu représentatif des conseils d’armée, institué parla France.
La formulation même de l’article L4121-4 qui englobe aussi bien les syndicats proprement dit que les associations démontre que la France entend supprimer tout droit d’expression et de réunion pour les militaires. Elle leur interdit de s’organiser et de discuter de leur condition en dehors des instances des conseils d’armée, instances de concertation dont les membres sont tirés au sort, ne disposent pas d’une disponibilité et de moyens particuliers pour remplir leur fonction auprès de leurs camarades. Cette situation est d’autant plus aberrante que l’armée française est totalement professionnalisée depuis 1997.
50 – De plus, la France ne peut prétendre que le système de concertation qu’elle a institué permet aux militaires de s’organiser et de faire valoir leurs droits (pièces n°52 et 53).
En effet, l’instance de concertation placée auprès du ministre, le Conseil supérieur de la fonction militaire est l’émanation des conseils de la fonction militaire de chaque armée ou service. Les membres de ces conseils sont tirés au sort et ne sont donc pas ou très peu représentatifs. De plus, ils n’ont pas de disponibilité particulière pour remplir leur fonction et leur formation juridico-administrative est réduite. C’est ainsi que le Conseil supérieur de la fonction militaire a émis des avis favorables aux projets de décrets imposant une condition d’ancienneté de trois ans aux militaires ayant contracté un pacte civil de solidarité. Le fait que ces membres élisent leurs représentants au conseil supérieur de la fonction militaire ne modifie pas la non-représentativité de cet organisme, puisqu’il est en fait représentatif de personnels tirés au sort. De même, la protection accordée aux militaires en tant que membres des conseils reste limités et symbolique. Les conseils d’armée et le CSFM ne sont pas maîtres de leur ordre du jour et ils n’ont pas la personnalité juridique qui leur permettrait d’ester en justice contre des textes réglementaires lésant les intérêts des militaires. Les conseils de la fonction militaires de chaque armée sont présidés par les chefs d’état-major ou équivalent. Quant au CSFM, il est présidé par le ministre.
L’existence de ces organismes qui servent plus à informer, voire à désinformer qu’à dialoguer ne justifie en rien l’interdiction totale faite aux militaires français de s’organiser.
51 – La jurisprudence de votre cour tient compte du contexte social et des prises de position d’autres institutions européennes et internationales.
C’est ainsi que le Conseil de l’Europe a eu, à plusieurs reprises l’occasion de recommander l’adoption de textes autorisant le droit d’association pour les militaires (pièce n°56). Il en est ainsi de la résolution n°903 du 30 juin 1988 (page 38 de la pièce visée), de la recommandation n° 1572 du 3 septembre 2002 (page 39 de la pièce visée) et de la recommandation 1742 du 11 avril 2006. Dans sa réponse à la recommandation n°1572, le comité des ministres (paragraphe 5) « prend note de la position de l’assemblée selon laquelle il conviendrait d’intégrer les droits susmentionnés aux règlements et codes militaires des Etats membres. Il doit néanmoins ajouter que cela ne peut se faire que dans la mesure où ces droits sont garantis ». Or, en France, le droit d’association est garanti parla Constitution comme l’a confirmé la décision du 16 juillet 1971 du Conseil Constitutionnel.
L’OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe a publié en 2008 en anglais un manuel sur les droits de l’homme dans les forces armées (pièce n°57) dans lequel elle expose les bases juridiques fondant le droit d’association.
Enfin, dans de très nombreux pays européens, signataires de la Convention européenne des droits de l’homme et membres du Conseil de l’Europe, l’exercice du droit d’association, lato sensu, c’est-à-dire incluant le droit syndical- dans les forces armées est reconnu. Sa pratique ne menace en rien la discipline des forces armées de ces pays. A titre illustratif, le droit d’association est désormais reconnu pour la Garde civile espagnole (pièce n°58) et pour la Garde nationale républicaine portugaise (pièce n°59).
L’interdiction totale imposée aux militaires français en activité de service de s’organiser, de créer et d’adhérer à des associations professionnelles viole manifestement les dispositions de l’article 11 dela Convention. Cette interdiction absolue ne se fonde sur aucun motif légitime. Elle est en tout cas disproportionnée au but recherché : le maintien de la discipline dans les armées.
***
Il est donc demandé à votre haute juridiction d’étendre aux membres des forces armées en activité de service, mutatis mutandis, sa jurisprudence relative à la liberté de réunion et en conséquence de constater que la Francea violé les termes de la Convention en imposant une interdiction totale de s’organiser aux militaires en activité de service.