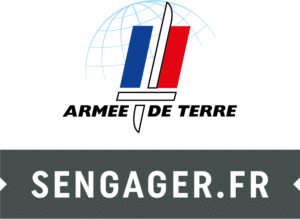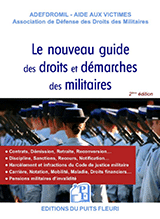Commission de la défense nationale et des forces armées
Présidence de Mme Patricia Adam, présidente
La séance est ouverte à neuf heures trente.
Mme la présidente Patricia Adam. Je suis heureuse d’accueillir l’amiral Marin Gillier, qui va nous présenter l’activité de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD), que nous suivons relativement peu directement – même si, lors de nos visites dans la zone sahélienne, nous avons eu l’occasion de rencontrer des personnes qui travaillaient sous ses ordres et d’apprécier leur travail et leur disponibilité. Amiral, il nous a paru d’autant plus nécessaire de vous entendre que commence à se poser la question de la sortie de crise au Mali.
Amiral Marin Gillier, directeur de la coopération de sécurité et de défense. Il est important, pour les quelque 400 agents français qui œuvrent en faveur de la coopération un peu partout dans le monde, de savoir que la représentation nationale s’intéresse à eux, car ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas toujours aisées – bien que souvent ensoleillées – et ils se sentent parfois isolés.
Je vous présenterai successivement la direction de la coopération de sécurité et de défense, l’action qu’elle mène en Afrique et les perspectives ouvertes en décembre dernier par le sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique.
La DCSD est une direction politique et opérationnelle du ministère des Affaires étrangères, qui découle des conclusions du Livre blanc de 2008, lequel avait affirmé le continuum sécurité-défense. Elle a pris en 2009 la suite de la direction de la coopération militaire et de défense, en incluant dans son champ d’action les coopérations de sécurité intérieure menées auparavant par la direction générale de la coopération internationale et du développement (aujourd’hui devenue la direction générale de la mondialisation) du ministère des Affaires étrangères. Elle est aujourd’hui chargée de la coopération structurelle avec les États étrangers dans les domaines de la défense, de la sécurité intérieure et de la protection civile. Notre objectif est de mettre en place, de renforcer et de pérenniser les capacités régaliennes des pays partenaires, afin de les aider à faire face aux menaces et à prévenir les crises et, plus généralement, afin d’accroître leur stabilité.
Pour ce faire, nous utilisons plusieurs modes d’action.
La coopération structurelle de défense française procède traditionnellement d’une approche bilatérale : conseil auprès des hautes autorités civiles et militaires du pays, formation de cadres, formations techniques spécifiques, par exemple dans le domaine de la police scientifique et technique.
Depuis quelques années, y est associée une approche multilatérale, notamment par l’intermédiaire des écoles nationales à vocation régionale (ENVR), qui drainent des étudiants de plusieurs pays africains, voire de l’ensemble du continent. Certaines dispensent des enseignements généraux – comme l’école de guerre de Yaoundé, au Cameroun –, d’autres des formations plus spécifiques ; par exemple, le centre de Ouidah, au Bénin, forme au déminage humanitaire. Dans tous les cas, les formations sont l’occasion de nouer des liens entre des personnes d’origines différentes, qui pourront ensuite parler le même langage et coopérer entre elles.
Le Quai d’Orsay dispose en outre d’autres outils de coopération multilatérale, comme les projets du fonds de solidarité prioritaire (FSP). Ainsi, le programme Asaca – Appui à la sécurité de l’aviation civile en Afrique –, qui vise à lutter contre l’utilisation de l’aviation civile par les terroristes, concerne vingt-deux pays.
Nous nous rapprochons également de l’Union africaine et des organisations sous-régionales, comme la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), et nous travaillons de plus en plus avec l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies (ONU).
Enfin, certains pays font appel à la France parce qu’ils veulent engager des actions de coopération ou de développement en Afrique, mais indirectement. Il nous revient alors de mettre en œuvre leurs projets.
Par le passé, nous pouvions également céder du matériel d’équipement, mais nous ne le faisons plus, faute de moyens – sauf pour les ENVR. Par exemple, une ENVR qui voudra former au maintien de l’ordre – ou à la « gestion démocratique des foules », comme on dit maintenant – aura besoin de boucliers et de matraques.
Notre budget est d’une centaine de millions d’euros par an, répartis sur deux programmes.
Le programme 105, « Action de la France en Europe et dans le monde », nous alloue quelque 80 millions d’euros. Les deux tiers sont dévolus aux rémunérations et aux charges sociales, le tiers restant allant aux crédits d’intervention ; depuis la création de la DCSD, il y a cinq ans, ceux-ci ont été divisés par deux et, sur le budget triennal 2013-2015, la baisse est de 15 %.
Au titre du programme 209, « Solidarité à l’égard des pays en développement », nous disposons de deux types de ressources : les financements issus du FSP, à hauteur de 13 millions d’euros l’année dernière, et les crédits de sortie de crise – quatre millions d’euros l’an passé. Je pourrai vous donner des exemples précis d’emploi de ces crédits si vous le souhaitez.
La DCSD regroupe environ 400 personnes : 229 coopérants militaires sont déployés dans le monde entier, mais principalement en Afrique – qui représente à peu près 80 % des efforts de la DCSD ; s’y ajoutent une 41 gendarmes, 48 policiers, 9 experts de la sécurité civile et 63 agents en administration centrale : militaires, diplomates, policiers, spécialistes de la sécurité civile.
Quelle est la différence entre la coopération opérationnelle et la coopération structurelle ? Les opérations, y compris la formation pour préparer les engagements en opérations, relèvent de l’État-major des armées et de la direction de la coopération internationale du ministère de l’Intérieur ; pour notre part, nous sommes chargés de mettre en place, de renforcer et de pérenniser les institutions régaliennes dans les pays partenaires. Cela signifie que, lorsqu’il y a une crise, comme actuellement en République centrafricaine, nous ne nous occupons pas de sa gestion – vue la situation, nous serions bien en peine de le faire ; nous n’en sommes qu’au stade de la réflexion sur la manière de réorganiser les forces armées, la police et la gendarmerie.
Nos relations avec l’État-major des armées sont excellentes. Lorsque la crise a éclaté en République centrafricaine, nous avons retiré nos coopérants, sauf quelques-uns qui, grâce à leurs réseaux et à leur connaissance du pays, ont facilité l’implantation de nos troupes. Réciproquement, lorsque nous nous réimplantons dans un pays en sortie de crise, nous bénéficions du soutien des formes armées et des détachements d’instruction opérationnelle (DIO) viennent à l’appui des formations que nous délivrons. Un comité de pilotage avec l’État-major des armées se réunit deux fois l’an. Bref, tout se passe en bonne intelligence.
Les relations sont plus difficiles avec le ministère de l’Intérieur, sans doute pour des raisons historiques : alors que le dispositif de coopération des trois armées et de la gendarmerie est unifié depuis les origines, la coopération policière n’a rejoint le dispositif commun qu’en 2009. Il faut du temps pour que les mentalités évoluent. En outre, les décrets et les arrêtés du ministère de l’Intérieur et du ministère des Affaires étrangères sont parfois contradictoires, ce qui ne facilite pas les choses. Enfin, les services policiers français sont très mobilisés sur leurs missions de sécurité intérieure et ne peuvent pas toujours garantir la disponibilité de leur ressource. Il suit de là que le taux d’exécution des missions de coopération, dépassant 90% pour les militaires, n’est que de 40% pour les agents civils.
Les priorités politiques de la DCSD sont fixées par la présidence de la République et par le cabinet du ministre des Affaires étrangères. Nous avons une priorité géographique très claire, le Sahel, et une priorité thématique, la lutte contre le terrorisme et contre les grands trafics transfrontaliers. J’y ai ajouté d’autres priorités liées à l’action à long terme de la DCSD, qui est nécessairement déconnectée de l’actualité politique, puisqu’elle a vocation à installer des institutions pérennes.
Traditionnellement, la DCSD contribue ainsi à l’extension de l’influence de la France dans le monde. Pour favoriser l’apprentissage du français, nous avons développé, d’abord en interne, puis en relation avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), des méthodes d’apprentissage du français en milieu militaire et en milieu sécuritaire ; nous sommes en train de les ouvrir à l’ONU. L’objectif est non seulement de promouvoir la connaissance de notre langue, mais également de contribuer à la formation de contingents susceptibles de se déployer dans des pays où l’on a besoin de Casques bleus francophones. Aujourd’hui, 55 % des opérations de maintien de la paix se déroulent dans des zones francophones, alors que 30 % seulement des troupes sont francophones. Nous organisons également des séminaires internationaux.
J’en viens à l’action que mène la DCSD en Afrique.
Nous avons conduit un processus de retour d’expérience (RETEX) pour savoir pourquoi l’action de la France et de la communauté internationale avait porté si peu de fruits au Mali et en République centrafricaine.
Une première série de causes est liée aux États eux-mêmes. Ceux qui se sont effondrés étaient sujets à un fort clientélisme et à une corruption généralisée ; ils souffraient à la fois d’un manque de volonté politique, notamment à l’endroit du dispositif de défense, et d’une faiblesse des administrations, incapables d’assimiler l’apport des actions de coopération. Sur le plan politique, le radicalisme gagnait les cœurs et les esprits.
Deuxième série de causes : la faiblesse des forces armées dans les pays concernés, avec une gestion des ressources humaines défaillante et une rupture du lien entre l’encadrement et la base, les officiers généraux vivant dans l’aisance alors que les troupes manquaient de tout. Il s’agissait bien souvent d’armées faites de bric et de broc, qui pouvaient bénéficier d’une aide importante, mais provenant de pays multiples, et dont le matériel était hétéroclite ; du coup, elles n’arrivaient pas à l’entretenir et à mettre en place une action opérationnelle cohérente. Enfin, on pouvait parfois noter une faible combativité liée aux cultures de certaines populations.
Dernière série de causes : les insuffisances de l’assistance internationale. Il ne semble malheureusement pas évident pour tout le monde qu’il n’y a pas de sécurité sans développement, et réciproquement. À la direction générale « Développement et coopération » (DEVCO) de la Commission européenne, par exemple, on ne veut pas entendre parler d’uniformes ! D’autre part, le manque de coordination de l’aide internationale a conduit à une véritable gabegie. Certains pays se sont fait financer trois fois les mêmes programmes sans que les bailleurs le sachent ! Une ambassadrice française me disait encore récemment : « Surtout, ne donnez pas de matériel ; des halls entiers sont remplis de véhicules qui ne servent à rien ! » Il convient de mettre fin à ce gaspillage.
Pour ce faire, nous avons conçu une méthodologie. Cela a été fait avant mon arrivée, mais j’ai souhaité la formaliser et je la présente systématiquement aux chefs d’État et de gouvernement auxquels je rends visite.
Premier point : les Africains demandent des réponses africaines aux problèmes africains ? Prenons-les au mot ! Nous répondons exclusivement aux sollicitations des pays partenaires, sans leur dire ce qu’ils doivent faire ; nous leur demandons ce dont ils ont besoin, nous analysons avec eux leurs demandes et, si nous les jugeons pertinentes, nous essayons d’y répondre.
Deuxième point : nous ne faisons plus, comme auparavant, de la coopération de substitution. Nous envoyons des spécialistes dans les pays partenaires afin qu’ils les aident à bâtir ce dont ils ont besoin, mais sans agir à leur place. Nos experts donnent des conseils, mais c’est à nos partenaires de s’approprier les actions et de les adapter aux réalités du terrain.
Mais cela ne suffit pas : il faut ensuite passer de l’appropriation à l’autonomisation. L’objectif final de la coopération, c’est que, à terme, les experts puissent se retirer et que le pays partenaire soit capable d’agir seul – quitte à lui apporter encore un peu d’aide de temps en temps.
C’est pourquoi nos actions de coopération s’appuient désormais sur des projets contractualisés. Pour chaque action, nous exigeons que soient précisés l’objectif, ce que chacun s’engage à faire, et les indicateurs de gestion utilisés. Nous acceptons de répondre à la sollicitation du pays partenaire, à condition que celui-ci s’engage à fournir les moyens matériels, humains et financiers nécessaires au projet ; en échange de quoi, nous lui procurons l’ingénierie de formation et les spécialistes. Dans la mesure où l’on constate tous les six mois ou tous les ans qu’il poursuit son effort, nous renforçons notre soutien ; dans le cas contraire, si, de toute évidence, il ne s’agit pas d’une priorité pour le pays – ce dont la France n’a pas à juger –, nous nous désengageons. J’espère que cela incitera les autres pays partenaires à assumer leurs responsabilités et que la coopération deviendra ainsi plus vertueuse.
Dernier point – sur lequel je ne m’attarderai pas : nous privilégions de plus en plus une approche internationale.
Quant à la « Françafrique », je dois dire qu’elle ne m’intéresse pas. Je suis pour ma part avant tout spécialiste des pays arabes, et non de l’Afrique – même si j’ai participé à des opérations aux quatre coins du continent. Que la France ait laissé un héritage historique et culturel dans une partie de l’Afrique n’est pas pour moi une motivation pour agir, mais un gage d’efficacité : il est plus facile de coopérer quand on partage la même langue et les mêmes systèmes administratifs. C’est un atout sur lequel nous nous appuyons pour assurer la sécurité de l’Europe – qui est indissociable de celle de l’Afrique. Toutefois, nous ne nous cantonnons pas à cette Afrique-là ; au contraire, nous menons de plus en plus d’actions de coopération en direction de l’Afrique anglophone, de l’Afrique lusophone et de l’Afrique arabophone.
En revanche, nous ne produisons pas le même effort suivant les régions. Au Sahel, nous luttons surtout contre le terrorisme et le narcotrafic. Dans le golfe de Guinée, nous œuvrons en priorité à la sécurité maritime et à la consolidation des démocraties. En Afrique du Nord, nous souhaiterions nous intéresser au terrorisme, aux migrations clandestines et à la bonne gouvernance, mais nous nous heurtons à des obstacles de nature politique ou opérationnelle. En Afrique de l’Est, nous concentrons nos efforts sur la sécurité maritime et le renforcement des capacités de maintien de la paix. Le point commun avec l’action des forces armées françaises, c’est que notre objectif est de renforcer les Africains, et non de tout faire à leur place, afin que, à terme, ils soient capables de gérer eux-mêmes leurs crises et que nous n’ayons plus qu’à leur prêter appui. C’est pourquoi la DCSD a envoyé, dans vingt-trois pays africains, soixante conseillers auprès des plus hautes autorités politiques et militaires.
Enfin, quelles sont nos perspectives ? À l’issue du sommet de l’Élysée, les chefs d’État africains ont décidé de porter les efforts dans trois directions : la sécurité au Sahel, en mettant tout particulièrement l’accent sur les frontières, la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et la consolidation de l’architecture de paix et de sécurité africaine. Ce sommet nous a donné un cadre d’action politique, une visibilité internationale et une légitimité, notamment vis-à-vis de l’Union européenne et des Nations unies. Il a aussi permis de relancer la dynamique partenariale.
D’autre part, nos ressources budgétaires déclinant, nous nous efforçons de trouver des ressources autres. Nous modulons l’assistance que nous apportons en fonction de la situation financière du pays partenaire : s’il est riche, nous la lui faisons payer ; s’il est pauvre, nous fournissons les ressources. Nous apportons un appui croissant aux entreprises françaises, en particulier pour répondre aux appels d’offres à Bruxelles ou à New York ; en retour, nous leur demandons de soutenir nos efforts, notamment en Afrique – par exemple, en nous fournissant des formateurs. Nous répondons aux appels d’offres de l’Union européenne, en notre nom propre ou via des opérateurs publics ou parapublics tels que France Expertise Internationale, l’opérateur du Quai d’Orsay, CIVI.POL, celui du ministère de l’Intérieur, ou Défense Conseil International (DCI), celui du ministère de la Défense. Nous montons aussi des opérations triangulaires, financées par des pays tiers et mises en œuvre par la France, ce qui nous donne l’occasion de soutenir les entreprises françaises grâce à l’achat de matériel. Bref, nous essayons d’œuvrer intelligemment pour essayer de compenser la diminution de nos ressources.
Mme la présidente Patricia Adam. Merci, amiral, pour l’honnêteté de vos propos.
Quand nous nous sommes rendus sur le terrain, mes collègues et moi avons été choqués par la disparité entre les moyens de l’Union européenne et de l’ONU et ceux de nos services, ainsi que par un certain gâchis que nous avons observé. Il serait bon de coordonner l’action au moins entre Européens, car tout cela est contre-productif et entretient la corruption que vous avez dénoncée.
Travaillez-vous avec l’Union européenne sur ces questions ? Sur le terrain, on constate que, si les militaires français travaillent ensemble, quelle que soit leur autorité de tutelle, ils n’ont en revanche presque aucun contact avec les autres forces, civiles ou militaires, présentes au titre de l’Europe ou de l’ONU. Quand nous avons demandé à rencontrer celles-ci, cela a surpris. Pourtant, en tant qu’État membre, nous finançons ces opérations. Comment améliorer la coordination entre forces de coopération ?
Amiral Marin Gillier. Mon premier déplacement après avoir pris mon poste fut pour Bruxelles, parce que j’avais entendu dire qu’il y avait des centaines de millions d’euros de crédits disponibles pour le secteur paix et sécurité en Afrique subsaharienne, sans que l’on sache très bien comment les utiliser. Quelle ne fut pas ma surprise d’apprendre que d’autres bureaux, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et à la Commission européenne, avaient également de l’argent à dépenser ! À la DCSD, nous avons de nombreuses idées pour sécuriser et stabiliser la zone – ce qui est dans l’intérêt de tous.
D’autre part, si l’Union européenne dispose de délégations (DUE) dans plusieurs pays africains, elle n’a pas de coopérants. Elle a la vision diplomatique, mais il lui manque la connaissance intime des pays, nécessaire à la mise en œuvre d’opérations de coopération. Il en va de même pour les États-Unis d’Amérique. La France est peut-être le seul pays au monde à disposer d’une telle ressource, héritage d’un siècle d’histoire commune avec l’Afrique francophone.
Pourtant, l’Allemagne, avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement – remporte 40 % des appels d’offres européens, et la France, 5 % : cela n’est pas normal ! Il faut faire quelque chose.
Mon deuxième voyage fut pour New York, mon prochain sera pour Washington – le Département d’État dispose de crédits importants à mobiliser via les programmes ACOTA (Africa Contingency Operations Training Assistance) et AFRICAP (Africa Peacekeeping Program). Mon idée est d’appeler à une meilleure coordination afin que nous ne financions pas trois fois le même programme et que nous soyons plus efficaces. Je dirai par exemple aux Américains : « Puisque nous avons une connaissance intime du fonctionnement de l’Afrique francophone, nous pouvons imaginer une répartition des tâches où chacun investirait sa propre valeur ajoutée. Attention à préserver le modèle de ces forces africaines, par exemple en utilisant des formateurs francophones et des équipements d’origine française compatibles avec les leurs ».
M. Yves Fromion. Ne seriez-vous pas en train de rêver, amiral ?
Amiral Marin Gillier. Non, détrompez-vous : je pourrais vous citer plusieurs exemples qui montrent que c’est un langage que le Département d’État est prêt à entendre ! Notamment, certaines entités américaines ont fait appel à des sous-traitants français, précisément pour conserver une cohérence dans l’équipement des troupes.
Ensuite, il nous faut intervenir en amont de la formulation des politiques et des appels d’offres de l’Union européenne. Je suis donc allé voir le SEAE et la Commission pour leur présenter les projets retenus par le sommet de l’Élysée et pour les engager à se les approprier – ce qu’ils sont prêts à faire dans un certain nombre de domaines. Cela ne me gêne pas si ces programmes sont ensuite présentés comme étant d’origine européenne, et non pas française : le but est de stabiliser une zone cruciale pour la sécurité de l’ensemble de l’Union, et non de notre seul pays.
Au-delà, j’ai conseillé à mes interlocuteurs de prendre contact avec notre réseau de coopérants : ils sont non seulement français, mais également européens, et grâce à leur connaissance intime du pays, ils peuvent être de bon conseil. Et, lorsque je suis en visite dans un pays africain, je rencontre systématiquement le représentant de la DUE, celui des États-Unis et les ambassadeurs des pays qui soutiennent notre action, par exemple via le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).
La France se trouve à la pointe des actions de coopération dans le golfe de Guinée, avec le projet d’appui à la réforme du système de sécurité maritime (ASECMAR), lancé il y a deux ans et demi, qui vise à mettre en place un système d’Action de l’État en mer (AEM). Nous avons proposé notre aide aux dix-huit pays du golfe, avec succès : six ont déjà adopté un système administratif à la française, avec un préfet maritime ou une haute autorité maritime. L’Union européenne, de son côté, a lancé le programme CRIMGO, plus récent et bien mieux doté que le nôtre, mais qui ne fonctionne pas très bien – la conception est bonne, mais la mise en œuvre fait problème. Je suis allé défendre notre projet à Bruxelles ; ils en sont très contents et veulent même l’intégrer à CRIMGO. J’ai donné mon accord. Nous proposons à la Commission d’être l’un de ses opérateurs, ce qui nous permet de faire avancer nos idées et de donner une couverture politique à notre action, sans que l’on puisse accuser la France de vouloir placer ses pions.
M. Gilbert Le Bris. La sécurité maritime – c’est-à-dire la lutte contre le terrorisme, le brigandage ou la piraterie – est très importante. Pour l’assurer, il faut des personnels formés au sein d’institutions performantes. Le soutien que la DCSD apporte à la jeune ENVR navale de Bata, en Guinée Équatoriale, est à cet égard déterminant. Toutefois, dans ce domaine, les technologies jouent un rôle essentiel, non seulement pour la détection, mais aussi pour l’intervention. Associez-vous à vos actions la direction du développement international de la direction générale de l’armement (DGA) et, plus largement, les industriels de défense français ? En d’autres termes, envisagez-vous de « tarponner » – si vous me permettez ce clin d’œil – notre technologie de sécurité maritime dans la zone ?
M. Jean-Jacques Candelier. Tous les accords de défense ont-ils été ratifiés par le Parlement ?
Ne pensez-vous pas que le maintien de l’ordre en Afrique relève davantage des forces de sécurité intérieure que des forces militaires ?
Amiral Marin Gillier. D’abord, entendons-nous sur les termes utilisés. Pour le grand public, la sécurité maritime, c’est la lutte contre la piraterie, mais son champ d’action est en réalité bien plus large : il s’agit aussi de protéger les ressources halieutiques et les fonds marins, de lutter contre la pollution, de définir la responsabilité des États en cas d’avarie ou de pollution, de faire appliquer le code international ISPS pour la sûreté des navires et des installations portuaires, de surveiller le trafic maritime et de lutter contre les trafics de toute nature – drogue, êtres humains, armes, etc. – qui déstructurent les États et favorisent le développement des réseaux terroristes. C’est dans ce cadre global que nous nous attaquons à l’insécurité maritime.
La mer, c’est la res nullius ; pourtant, quand un navire circule, il passe d’une zone de droit à une autre sans toujours s’en rendre compte. C’est tellement compliqué que l’on ne peut pas intervenir dans ces grands espaces sans une coordination internationale très forte : cela s’est vérifié sur la côte est de l’Afrique, et c’est la même chose sur la côte ouest. En revanche, les solutions ne sont pas transposables : alors que, en Somalie, il n’y avait ni État ni richesses, dans le golfe de Guinée, les États veillent au respect de leurs prérogatives régaliennes, et il y a des richesses à protéger.
Ce n’est ni à la France ni à la communauté internationale de dire aux Africains ce qu’ils doivent faire en la matière ; ils l’ont eux-mêmes décidé lors de la conférence de Yaoundé, en juin dernier. Notre rôle est d’apporter notre soutien à la dynamique lancée à cette occasion, quitte à leur faire part de nos doutes sur certains points – par exemple, quatre niveaux de coordination de commandement, c’est un de trop.
La DCSD dispose de dix coopérants sur la côte ouest africaine ; à la suite du sommet de l’Élysée, elle va en placer trois autres auprès de la CEDEAO, de la CEEAC et de l’Union africaine. L’école navale de Bata avait été initialement créée pour développer un savoir-faire dans le domaine de l’AEM, mais il s’est avéré que les compétences de base étaient encore inexistantes ; pour l’heure, on essaie donc d’y remédier – sachant que, contrairement à Oman ou au Yémen, il n’existe pas de tradition hauturière dans la région. Les populations et les gouvernements ont donc besoin de s’approprier progressivement les compétences pour être ensuite capables de gérer seuls ces questions.
La première chose que nous les aidons à faire, c’est à mettre en place un système administratif et judiciaire : à savoir, l’AEM à la française, qui consiste à mettre en synergie toutes les institutions du pays – forces armées, marine marchande, police, gendarmerie, douanes, justice, administration des transports, de la santé, etc. En France, il nous a fallu vingt-cinq ans pour y parvenir – cela a débuté à la suite du naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978 –, mais cela marche très bien aujourd’hui.
Il faut ensuite développer des capacités de gestion interministérielle des crises et prévoir des capacités d’intervention : c’est sur ce dernier point qu’intervient l’école de Bata. Sur le premier, nous envisageons désormais de soutenir la création d’un collège international dédié à l’AEM.
Mais il faut aussi des moyens. C’est pourquoi nous incitons les marines de ces pays à s’équiper, qui avec OCEA, qui avec Constructions mécaniques de Normandie (CMN), qui avec DCNS, qui avec Piriou. Nous associons donc à notre action non seulement la DGA, mais surtout des entreprises de taille intermédiaire – qui, dans ce domaine, sont plus appropriées. Nous avons ainsi organisé le 24 janvier dernier une réunion ouverte à toutes les entreprises susceptibles d’être intéressées par ces questions ; soixante y ont participé. Nous leur avons expliqué comment obtenir ces marchés, soit directement, soit en passant par l’Union européenne.
Pour ce qui est des accords de défense, vous êtes mieux placés que moi pour savoir s’ils ont été ratifiés par le Parlement.
Plutôt que de « maintien de l’ordre », on parle désormais de « gestion démocratique des foules ».
M. Alain Rousset. Uniquement pour les manifestations parisiennes ! (Sourires.)
Amiral Marin Gillier. Pas du tout. Le glissement sémantique n’est pas qu’un euphémisme politiquement correct. La gestion démocratique des foules, ce n’est pas utiliser la matraque et le bouclier, c’est faire en sorte que les manifestants puissent se sortir d’une situation délicate : ne pas les bloquer dans un coin, leur permettre de rentrer tranquillement chez eux, respecter les droits de l’homme. Il s’agit d’une approche globale.
Nos enseignements sont délivrés par des policiers ou des gendarmes, aussi bien en France, à Saint-Astier, qu’en Afrique, notamment à l’École internationale des forces de sécurité de Yaoundé (EiForces), au Cameroun.
Lorsque les forces armées sont appelées à intervenir, il s’agit, non pas de coopération structurelle, mais de gestion des crises : ce n’est plus mon domaine.
Mme Émilienne Poumirol. L’internationalisation de la formation a-t-elle eu des conséquences sur le contenu des enseignements dispensés ? Dans les pays anglophones ou lusophones, ne sommes-nous pas considérés comme des donneurs de leçons ?
Mme Geneviève Gosselin-Fleury. Comment fait-on pour évaluer le résultat d’une action de coopération en Afrique au regard des objectifs et des missions de la DCSD ?
M. Yves Fromion. On a l’impression que vous disposez d’une grande autonomie de décision. Votre action s’inscrit-elle dans le cadre des accords de défense que nous avons conclus avec un certain nombre d’États africains ?
Amiral Marin Gillier. Les ENVR, que nous développons depuis une quinzaine d’années, sont un excellent vecteur pour l’internationalisation : un pays fournit localement l’effort, et les élèves proviennent pour un tiers du pays hôte et pour deux tiers d’autres pays africains. Leur objectif est de bénéficier d’une formation correspondant à une ingénierie française. À ma connaissance, aucun ne s’est déclaré insatisfait ; au contraire, si nous en avions les moyens, nous pourrions multiplier les effectifs par quatre ou cinq. Le jour où il s’avérera qu’une de nos ENVR n’intéresse plus personne, nous la fermerons et nous en ouvrirons une nouvelle : à chacun de mes voyages en Afrique, j’ai dix sollicitations en ce sens. Notre problème, aujourd’hui, n’est pas d’être repoussés : bien au contraire, on nous demande d’en faire davantage – et c’est ce qui contribue à notre rayonnement.
Celui-ci est également lié au fait que nous développons des capacités de traduction simultanée dans certaines ENVR et que nous dispensons de plus en plus de cours dans d’autres langues. Je demande aux pays lusophones et anglophones de nous envoyer des instructeurs, ce qui nous permet d’internationaliser l’enseignement.
Quant à être accusés d’être des donneurs de leçons, je ne crois pas que ce soit le cas – je fais bien attention, dans mes entretiens avec nos partenaires, à ne pas être perçu comme tel. Au contraire, tout le monde nous demande des conseils – du moins en Afrique francophone.
Comment fait-on pour évaluer une action de coopération ? Nous utilisons de plus en plus des indicateurs de gestion. Quant à l’évaluation à long terme, je donnerai l’exemple du Tchad, dont les forces armées étaient conçues de façon traditionnelle, avec des unités recrutées en fonction des origines ethniques. Le président Déby nous a demandé de l’aider à mettre en œuvre une politique de ressources humaines vertueuse, avec une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) : cela passe par un recrutement pertinent, la promotion au mérite, l’affectation en fonction des compétences et des qualifications, la valorisation des acquis, etc. Quand un pays décide de se lancer dans une telle démarche, même si cela demandera encore des années d’efforts, nous considérons que notre action est couronnée de succès.
Je vais vous donner un autre exemple de coopération qui a très bien marché. Au Bénin, nous avons créé le Centre de documentation de la sécurité publique (CDSP). Un coopérant a mis en place un système sécurisé qui permet de regrouper dans un même lieu les fichiers électroniques de la police, de la gendarmerie et de la douane, et cela en liaison avec les représentants de l’ensemble des administrations, dont celui du ministère des Finances, et avec un représentant de la justice, chargé du contrôle. Au bout de trois ans, le coopérant s’est retiré, et cela continue à très bien fonctionner. Voilà un modèle pour toute la CEDEAO !
Les accords de défense portent sur le soutien que la France est susceptible d’apporter en cas de crise : ce n’est pas de mon domaine de compétence. En revanche, les accords de coopération en matière de défense nous concernent davantage. Ils sont publics, se contentent de fixer de grands cadres d’action, et ne sont pas contraignants. Nous les mettons en œuvre en développant leur contenu.
Pour accompagner nos actions, nous travaillons surtout avec les directions géographiques du Quai d’Orsay. La DCSD fait elle-même partie de la direction générale des affaires politiques et de sécurité : tout ce que nous faisons est soumis au directeur général.
M. Daniel Boisserie. Amiral, nous avons bien compris que la France était généreuse, qu’elle enseignait le français, luttait contre les trafics, apportait son appui à la sûreté maritime et à la protection civile. Vous dites vouloir en sus soutenir les entreprises françaises et que vous recherchez l’efficacité. Je ne mets pas en doute votre bonne volonté : vous êtes de toute évidence quelqu’un de volontaire et de dynamique. Toutefois, je n’ai pas l’impression que les résultats soient à la hauteur de vos espérances, alors que d’autres pays, comme l’Allemagne, sont présents un peu partout par l’intermédiaire de leurs ambassades. Bref, il ne me semble pas que l’on vous ait donné les moyens de votre mission. C’est dommage, car vous disposez d’un réseau exceptionnel et d’un personnel très compétent. Ne pourriez-vous pas trouver vous-même les financements nécessaires ? Au-delà, ne faudrait-il pas revoir complètement la politique française en la matière ?
M. Christophe Guilloteau. Amiral, sauf le respect que je vous dois, plus je vous écoute et moins je comprends ce que vous faites. La DCSD serait-elle une sorte de diplomatie parallèle ? Quelles sont vos relations avec les attachés de défense ? Vous n’avez pas du tout évoqué votre budget : d’où vient-il, et à combien s’élève-t-il ?
M. Sylvain Berrios. Votre enthousiasme, ainsi que la diversité et le caractère très pratique de vos actions ne peuvent que nous ragaillardir !
Le conseil aux gouvernements pour assurer la sécurité de nos entreprises dans les pays partenaires fait-il partie de votre spectre d’intervention ? Ce serait nécessaire, si nous voulons y développer nos activités économiques.
M. Michel Voisin. Il y a quelques années, j’étais rapporteur spécial pour les crédits de la coopération militaire. À ce titre, j’ai assisté au lancement du programme de renforcement des capacités africaines de maintien de la paix (RECAMP), qui s’est beaucoup développé depuis et dont le budget reste important. Les grandes manœuvres multilatérales existent-elles toujours ? J’avais assisté aux manœuvres « Tanzanite », que j’avais trouvées intéressantes, même si certains exercices de parachutage avaient été assez… mouvementés.
En matière de formation à la gestion démocratique des foules, n’existe-t-il pas des actions de coopération avec le Burkina-Faso, notamment avec l’école des sous-officiers de gendarmerie, à Bobo-Dioulasso ?
Amiral Marin Gillier. L’appui de l’État aux entreprises françaises n’est pas du ressort de la DCSD. Notre rôle, je le répète, est d’aider les Africains à mettre en place ou à renforcer des institutions régaliennes pérennes qui leur permettront d’éviter les crises ou de les surmonter. Notre objectif premier est qu’un État comme, par exemple, la Mauritanie ne s’écroule pas et qu’il gère ses problèmes d’une façon que nous estimons être de bonne gouvernance, en respectant les populations et en favorisant le développement du pays ; accessoirement, nous faisons aussi en sorte que ce soient des entreprises françaises plutôt que d’autres qui remportent les marchés.
Pour la DCSD, il ne s’agit que d’une activité marginale : comme nous avons accès à nombre de marchés et d’institutions, nous en profitons pour pousser les entreprises françaises. En revanche, il existe au Quai d’Orsay une direction dont la mission est précisément de soutenir les entreprises : la direction des entreprises et de l’économie internationale (DEEI). Lorsque nous organisons des réunions sur le sujet, c’est toujours en présence de son directeur.
Si vous trouvez que nous n’en faisons pas assez, sachez que j’ai proposé d’envoyer, à partir de l’été prochain, un coopérant de la DCSD à Bruxelles, de façon à suivre la rédaction et l’émission des appels d’offres.
Sommes-nous une diplomatie parallèle ?
Notre activité n’a rien de parallèle : tout passe par les télégrammes diplomatiques, qui sont largement diffusés. Nos échanges avec les coopérants transitent, selon le projet, soit par l’attaché de défense, soit par l’attaché de sécurité intérieure, et les grandes décisions sont prises en accord avec les chefs de poste que sont les ambassadeurs.
Notre budget, je vous l’ai déjà présenté : il est de 80 millions d’euros sur le programme 105 et de 13 plus quatre millions d’euros sur le programme 209 – ces deux programmes relevant des Affaires étrangères.
RECAMP est un programme déjà ancien, qui a été poursuivi et mis à jour, et qui intéresse aussi bien l’État-major des armées que la DCSD. Les grandes manœuvres multilatérales concernent exclusivement le premier. La DCSD, elle, ne s’occupe que des aspects institutionnels ; elle n’a pas les moyens de faire de la formation de gros bataillons et encore moins de l’entraînement. En revanche, nous formons des cadres, en leur transmettant des savoir-faire français ; par exemple, nous organisons en ce moment au Cameroun, avec un financement de l’Union européenne, une formation à destination de policiers et de gendarmes afin de renforcer les contingents africains qui participent aux opérations de maintien de la paix dans les pays francophones.
Quant à la gestion démocratique des foules, il existe en effet une ENVR spécialisée dans ce domaine, mais nous prodiguons aussi de très nombreux enseignements à titre bilatéral.
M. Michel Voisin. L’ENVR en question est une réplique de Saint-Astier ?
Amiral Marin Gillier. Exactement.
M. Philippe Folliot. N’y en avait-il pas une autre au Mali ?
Amiral Marin Gillier. Oui, à Bamako, mais c’est une école purement nationale, que nous soutenons par ailleurs. Nous avons créé deux ENVR au Mali, l’une spécialisée dans le maintien de la paix, qui a pour vocation de former les contingents africains francophones aux opérations de maintien de la paix, et l’autre qui forme à l’administration militaire.
La France produit donc de nombreux efforts et incite d’autres pays, ou institutions, comme l’ONU, à agir dans le même sens qu’elle.
Mme la présidente Patricia Adam. Amiral, je vous remercie.
La séance est levée à onze heures.
*
* *
Membres présents ou excusés
Présents. – M. Ibrahim Aboubacar, Mme Patricia Adam, M. François André, M. Olivier Audibert Troin, M. Nicolas Bays, M. Sylvain Berrios, M. Daniel Boisserie, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Isabelle Bruneau, M. Jean-Jacques Candelier, Mme Nathalie Chabanne, M. Guy Chambefort, Mme Catherine Coutelle, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Guy Delcourt, Mme Marianne Dubois, M. Philippe Folliot, M. Jean-Pierre Fougerat, M. Yves Foulon, M. Yves Fromion, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Christophe Guilloteau, M. Francis Hillmeyer, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Patrick Labaune, M. Marc Laffineur, M. Charles de La Verpillière, M. Gilbert Le Bris, M. Christophe Léonard, M. Maurice Leroy, M. Alain Marleix, M. Alain Marty, M. Philippe Meunier, M. Jacques Moignard, M. Paul Molac, M. Alain Moyne-Bressand, Mme Sylvie Pichot, Mme Émilienne Poumirol, M. Joaquim Pueyo, Mme Marie Récalde, M. Alain Rousset, M. François de Rugy, M. Stéphane Saint-André, M. Jean-Michel Villaumé, M. Michel Voisin, Mme Paola Zanetti
Excusés. – M. Claude Bartolone, M. Sauveur Gandolfi-Scheit, Mme Edith Gueugneau, M. Éric Jalton, M. Laurent Kalinowski, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Frédéric Lefebvre, M. Bruno Le Roux, M. Philippe Nauche, M. Philippe Vitel
Assistait également à la réunion. – M. François Loncle
Lire le compte rendu au format pdf:
Source: Assemblée nationale