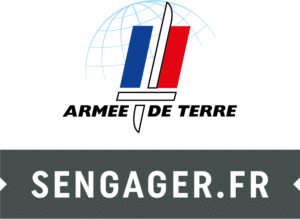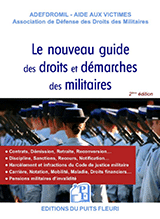COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
23
15.1.2009
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
ORBAN ET AUTRES c. FRANCE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Orban et autres c. France (requête no 20985/05).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de la condamnation des requérants pour, notamment, apologie de crimes de guerre à la suite de la publication du livre Services Spéciaux Algérie 1955-1957.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 33 041 euros (EUR) pour dommage matériel et 5 000 EUR pour frais et dépens. La Cour dit en outre que le constat de violation de l’article 10 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les intéressés. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Les requérants sont Olivier Orban et Xavier de Bartillat, deux ressortissants français nés respectivement en 1944 et 1954 et résidant à Paris, et la société des Editions Plon, dont le siège social se trouve à Paris. A l’époque des faits, MM. Orban et de Bartillat étaient respectivement président directeur général et directeur général des Editions Plon.
En mai 2001, la société requérante publia un livre intitulé Services Spéciaux Algérie 1955-1957, dans lequel le général Aussaresses, auteur de l’ouvrage et ancien membre des services spéciaux, évoque la torture et les exécutions sommaires pratiquées durant la guerre d’Algérie. Un premier tirage à 25 000 exemplaires environ fut suivi de plusieurs réimpressions.
La quatrième de couverture décrit l’auteur comme un « ancien de la France libre » qui fut « envoyé par le général de Gaulle dans les opérations secrètes les plus délicates ». Et d’ajouter que « c’est en Algérie que Paul Aussaresses […] a dû accomplir la mission la plus douloureuse » et que « même si son nom est encore inconnu du grand public, dans les cercles très fermés des services spéciaux, cet ancien parachutiste de la France Libre […] était déjà considéré comme une légende vivante ». Le texte du récit est quant à lui précédé d’un « avertissement de l’éditeur », précisant notamment : « Il nous a semblé important de publier le récit d’un acteur mal connu, mais central, de ce conflit ».
En juin 2001, le procureur de la République de Paris fit citer Olivier Orban, Xavier de Bartillat et le général Aussaresses devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre du délit d’apologie de crimes de guerre quant à M. Orban, et de complicité de ce délit s’agissant de M. de Bartillat et du général. La citation visait plusieurs passages de l’ouvrage.
Par un jugement du 25 janvier 2002, le tribunal déclara les prévenus coupables. Il condamna les requérants à des amendes de 15 000 EUR, le général Aussaresses à une amende de 7 500 EUR, et accorda notamment 1 EUR de dommages-intérêts à chacune des trois associations parties civiles (la Ligue des Droits de l’Homme, le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié des Peuples et l’association Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). La société requérante fut quant à elle déclarée civilement responsable.
Ce jugement fut confirmé en appel par un arrêt du 25 avril 2003, dans lequel la cour d’appel de Paris, relevant certains passages de l’ouvrage, conclut que l’objectif de l’auteur avait été de persuader le lecteur de la légitimité, de l’inévitabilité de la torture et des exécutions sommaires pratiquées durant la guerre d’Algérie. Elle constata notamment que, si l’auteur indiquait être conscient d’avoir accompli une « pénible besogne », avoir agi par devoir et ne pas avoir eu le choix, et formulait le vœu que de jeunes officiers n’aient jamais à faire ce que, pour son pays, il avait dû faire en Algérie, il ne se démarquait pas pour autant de ce passé. La cour d’appel souligna également que, nonobstant son « très bref ‘avertissement’ », l’éditeur n’avait pris aucune distance vis-à-vis de ce texte, glorifiant au contraire l’auteur en le qualifiant de « légende vivante » et en présentant sa mission comme « la plus douloureuse ».
En décembre 2004, la Cour de cassation rejeta un pourvoi formé par les requérants.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 juin 2005.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Peer Lorenzen (Danemark), président,
Rait Maruste (Estonie),
Jean-Paul Costa (France),
Karel Jungwiert (République tchèque),
Renate Jaeger (Allemagne),
Mark Villiger (Liechtenstein),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt2
Griefs
Invoquant l’article 10, les requérants se plaignaient de leur condamnation.
Décision de la Cour
Article 10
La Cour estime que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, ingérence qui était prévue par la loi française et avait pour buts légitimes la défense de l’ordre et la prévention du crime. Elle souligne avant tout qu’elle n’a pas à se prononcer sur les éléments constitutifs du délit d’apologie de crimes de guerre, son rôle se limitant à vérifier si la condamnation des requérants à raison de la publication du livre litigieux peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
Sur le point de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour observe tout d’abord que les autorités ne jouissaient que d’une marge d’appréciation restreinte, circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, et garantir le droit du public à en recevoir. Ces principes sont applicables en matière de publication de livres, dès lors qu’ils portent sur des questions d’intérêt général.
La Cour estime que la conclusion de la cour d’appel selon laquelle l’objectif de l’auteur aurait été de persuader le lecteur de la légitimité, de l’inévitabilité de la torture et des exécutions sommaires pratiquées durant la guerre d’Algérie, n’est pas décisive pour l’appréciation des faits litigieux au regard de l’article 10. Elle voit avant tout dans l’ouvrage litigieux le témoignage d’un ancien officier des services spéciaux missionné en Algérie, « acteur central du conflit », directement impliqué dans des pratiques telles que la torture et les exécutions sommaires dans l’exercice de ses fonctions. La publication d’un témoignage de ce type s’inscrivait indubitablement dans un débat d’intérêt général d’une singulière importance pour la mémoire collective : fort du poids que lui confère le grade de son auteur, devenu général, il conforte l’une des thèses en présence et défendue par ce dernier, à savoir que non seulement de telles pratiques avaient cours, mais qui plus est avec l’aval des autorités françaises. Selon la Cour, le fait que l’auteur ne prenne pas de distance critique par rapport à ces pratiques atroces et que, au lieu d’exprimer des regrets, il indique avoir agi dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, est un élément à part entière de ce témoignage. Par conséquent, le reproche fait par la cour d’appel aux requérants, en leur qualité d’éditeur, de ne pas avoir pris de distance par rapport au récit du général, ne saurait être justifié.
En outre, la Cour ne perçoit pas en quoi le fait de qualifier la mission du général Aussaresses en Algérie de « la plus douloureuse » équivaut à une glorification de l’auteur ou des faits dont il témoigne. Quant au recours à l’expression « légende vivante » pour qualifier le général, elle n’y discerne pas davantage une volonté de glorification de celui-ci. Outre le fait qu’une telle expression peut recevoir plusieurs acceptions, y compris négatives, elle renvoie manifestement à la réputation que le général avait « dans les cercles très fermés des services spéciaux » au moment où il avait été envoyé en Algérie.
Par ailleurs, la Cour observe que bien que les propos litigieux n’aient pas perdu leur capacité à raviver des souffrances, il n’est pas approprié de les juger avec le degré de sévérité qui pouvait se justifier dix ou vingt ans auparavant ; il faut au contraire les aborder avec le recul du temps. Elle rappelle à cet égard que la liberté d’expression au sens de l’article 10 vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Par conséquent, sanctionner un éditeur pour avoir aidé à la diffusion du témoignage d’un tiers sur des événements s’inscrivant dans l’histoire d’un pays entraverait gravement la contribution aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses.
La Cour rappelle également que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Or Olivier Orban et Xavier de Bartillat ont chacun été condamnés à payer une amende de 15 000 EUR, somme pour le moins élevée et qui est deux fois supérieure à celle infligée à l’auteur des propos incriminés.
Dès lors, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions françaises ne suffisent pas pour la convaincre que la condamnation des requérants était « nécessaire dans une société démocratique ». Elle conclut en conséquence à la violation de l’article 10.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
1 L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
2 Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Soure: Site http://www.echr.coe.int