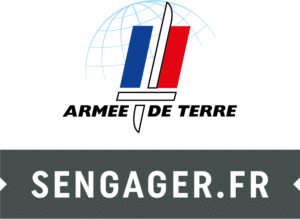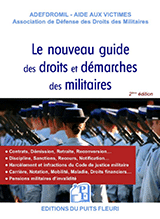Engagée depuis dix ans en Afghanistan et trois mois en Libye, l’armée française s’inquiète de l’indifférence dans laquelle ses soldats se battent à des milliers de kilomètres du territoire national et de la distance qui se crée entre les militaires et la société civile.
Colères, coups de gueule et colloques : l’affaiblissement du lien armée-Nation agite depuis des mois la communauté militaire.
« La Nation n’est pas convenable avec ses soldats », assène le chef d’état-major de la marine, l’amiral Pierre-François Forissier, invité mi-juin de l’Association des Journalistes de Défense (AJD).
Avec 62 soldats morts en Afghanistan depuis le déploiement des forces françaises dans le cadre de la coalition sous mandat de l’ONU, les armées subissent des pertes importantes dans un conflit de plus en plus impopulaire.
Et l’annonce jeudi d’un début de retrait des troupes françaises ne devrait guère accélérer leur désengagement, prévu pour 2014 dans le cadre de l’Otan.
Des morts qui, au-delà des honneurs officiels, ne suscitent que peu d’écho dans la presse et la société. « On n’en parle pas ou mal, parce qu’on traite ça comme des faits divers », regrette l’amiral Forissier.
Le lien armée-Nation est l’un des piliers du contrat républicain. La Nation délègue aux armées le droit d’utiliser la force pour assurer sa sécurité et défendre les valeurs et les intérêts nationaux quand ils sont menacés.
L’amiral Forissier rejette les termes mêmes de « lien armée-Nation » qui, selon lui, séparent au lieu de rapprocher. « Les armées sont au coeur de la Nation, dit-il. On ne vit pas à côté, on vit dedans. Nous sommes au coeur de la Nation ».
Les rapports parfois difficiles des Français avec leur armée, semblent distendus depuis la suspension du service national, en 1997. Les militaires apparaissent de plus en plus comme des professionnels qui, certes, exerçent un métier à risques, mais comme beaucoup d’autres.
Le patron des forces terrestres, le général Elrick Irastorza, dont les hommes sont déployés en Afghanistan, préfère parler d’une armée de « volontaires ».
« Il ne faut pas généraliser le sentiment de manque de considération que nos soldats peuvent parfois ressentir », souligne-t-il : « Il y a de fortes différences régionales, dans certaines villes il y a une véritable ferveur ».
« Quand on regarde les sondages, la perception que les Français ont de leur armée est bonne. On vit une sorte d’indifférence affectueuse », note-t-il.
Le général Irastorza pointe en revanche l’éloignement des zones de conflit et la difficulté de beaucoup de gens à « situer l’Afghanistan sur une carte », contrairement à la période de la Guerre froide, quand l’ennemi potentiel était proche.
Comme d’autres officiers expérimentés, il rappelle « la situation beaucoup plus inconfortable » des armées dans les années 1970, marquées par un fort courant pacifiste. Quand les slogans farouchement anti-militaristes barraient les murs des casernes.
Un tournant dans l’appréciation des armées qu’il situe dans les années 1980, avec le début de la participation des soldats français à des opérations de maintien de paix sous mandat de l’ONU.
D’autres regrettent aussi le manque de soutien des élus locaux aux familles des soldats tués ou blessés en opération.
De hauts gradés soulignent ainsi la différence du rapport entre la population et son armée en France et dans les pays anglo-saxons. Comme en Grande-Bretagne, où les autocollants « Nous sommes fiers de nos soldats et nous les soutenons » fleurissent, selon eux, sur les pare-brise des voitures.
Source: AFP